I-J
Métamorphosées

1996. Après avoir beaucoup insisté auprès de sa mère, Mikael, dit Mikimus ou encore Miki, devient pensionnaire d’un internat du Seeland. Ce n’est pas une institution avec des brimades récurrentes, façon Jan Guillou (La Fabrique de violence), loin de là, plutôt un lieu un peu expérimental dans sa pédagogie et son projet. Miki (son père est mort quand il était petit, mais il conserve une photo de lui dans son portefeuille) vit cette scolarité avec les autres, ça se passe plutôt bien, il tombe amoureux de Laura, une jeune fille de son âge. Mais il ne veut plus parler à sa mère. « Miki, je sais que c’est toi », lui dit-elle alors qu’il a composé son numéro de téléphone sans dire un mot ; « Si tu veux, on peut simplement rester là en silence, un petit peu ? » Beaucoup, beaucoup plus tard, précisément en 2132, Vibeke Marslund, la mère, du haut de ses cent soixante-treize ans, prend la parole pour expliquer le pourquoi de son attitude distante avec son fils. « Miki n’était pas ce qu’on appelle un enfant souhaité. Il était plutôt quelque chose que son père voulait avoir le temps d’accomplir avant qu’il ne soit trop tard. Essentiellement par principe, je crois. » Un long poème conclut ce récit. Nous ne dirons pas que nous avons été emballé par Métamorphosées !
* Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Métamorphosées (Dafnesyndromet, 2021), trad. Andreas Saint Bonnet, Grasset (En lettres d’ancre), 2024
Île

Marita partira bientôt en voyage « et ceci est son point de départ : Suðdroy, l’île méridionale des Féroé ». À Copenhague, elle rejoindra Fritz, son mari. Ce sera une tout autre vie, se doute-t-elle. Mais ici, que laisse-t-elle ? Un monde, que sa petite-fille, curieuse de tout, va découvrir en faisant le voyage dans l’autre sens, des décennies plus tard. « Nous dépassâmes les hauts soubassements de l’église, l’arbre peint en noir, les tombes contenant mon ADN. » Les îles Féroé font-elles partie de l’Europe ? Pour ses habitants, ou tout au moins pour certains d’entre eux, la question se pose. À l’Europe géographique, oui, mais à l’Europe politique et économique ? Différemment, la question s’est aussi posée à Marita lorsqu’elle a débarqué à Copenhague au moment où le pacte germano-soviétique était signé. Elle s’apprête à exercer un emploi de fille de salle dans un hôpital ; lui, n’entamera pas des études d’ingénieur, comme il le souhaitait, mais deviendra enseignant. La guerre bouleverse tout, ils la subissent sans trop en souffrir. Île est le premier roman de Siri Ranva Hjelm Jacobsen (née en 1980). Si elle a grandi à Copenhague, elle est elle-même originaire des îles Féroé et cet ouvrage est autobiographique, ainsi qu’elle le précise dans ses remerciements. « Mes propres grands-parents étaient heureusement de vraies personnes, et non des personnages de roman ». Les îles Féroé apparaissent comme un monde à part, au paysage sauvage et déchiqueté, peuplées d’êtres hors du temps, des pêcheurs dépassés par la guerre, même si leur emplacement stratégique intéresse tour à tour l’Angleterre, l’Allemagne nazie, l’URSS, les États-Unis, puis l’OTAN, voire l’Europe. Traitée de façon très poétique, la narration est lente, soumise aux saisons qui, ici, déterminent plus le cours des choses que ne le fait la folie des humains. « Une joie sucrée comme la chair d’une pomme, des picotements dans les jambes, il faut qu’elle coure, elle court, et les pies de mer s’élancent, ses bras s’envolent dans l’air étincelant – île, où étais-tu ? »
* Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Île (Ø, 2016), trad. Andreas Saint Bonnet, Grasset (En lettres d’ancre), 2021
La Première pierre
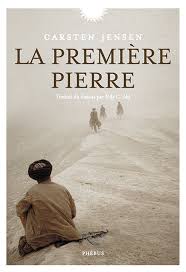
L’engagement militaire des pays européens en Syrie, en Iraq ou en Afghanistan, ces dernières années, suscite, chose logique, son lot d’ouvrages. Songeons, récemment, à Anne-Cathrine Riebnitzsky avec Les Guerres de Lisa, roman auquel celui de Carsten Jensen (né en 1952), La Première pierre, fait immanquablement écho (Anne-Cathrine Riebnitzsky est d’ailleurs citée dans la liste des remerciements). Question montée en puissance et intensité de la dramaturgie, on peut également penser à Week-end à Zuydcotte de Robert Merle. La Première pierre relate le périple, de nos jours, d’un groupe de soldats danois en Afghanistan, cette « plaine infinie recouverte de souffrances ». Tous les membres de cette 3e section ont de bonnes raisons de s’engager, sans toujours avoir vraiment conscience de ce que leur geste signifie. « Tu n’es pas dans l’armée pour jouer au héros. Tu n’es pas ici pour gagner toutes les guerres auxquelles ton arrière-arrière-grand-père et ses descendants n’ont jamais pris part. Tu es dans l’armée pour apprendre à être un type normal. Pour faire ton devoir, prendre les ordres au sérieux, utiliser ta tête autrement que comme un mégaphone pour ta propre connerie. » Voilà ce qu’ils apprennent en préambule, par la voix de leur chef, Rasmus Schrøder. L’Afghanistan est en guerre : les talibans contre les troupes étrangères, les seigneurs de guerre contre les talibans et les troupes étrangères. Tous contre tous, autrement dit, au gré des alliances qui ne durent jamais bien longtemps. On se souvient peut-être du témoignage de Åsne Seierstad, Le Libraire de Kaboul, une quinzaine d’années auparavant. La situation semble ne pas avoir changé, sinon en pire. La violence est omniprésente, elle atteint indistinctement les soldats et les civils, les vieux et les enfants, elle ne semble pas devoir s’éteindre de sitôt. La Première pierre fait entrer le lecteur dans la vie quotidienne d’un bataillon, qui se soude au fur et à mesure que les événements dramatiques s’accumulent autour de lui. Bravoure, trahison, amitié, amour, manipulation, tout est là, dans ce chaos indescriptible et au-delà de l’humain qu’aucun de ces soldats n’avait cru avoir à subir. L’Afghanistan dévoile ses paysages, majestueux ; ses rites, ancestraux aux yeux des Occidentaux. L’Afghanistan est un piège. Ces soldats danois l’apprennent à leurs dépens avec, dans les rôles principaux, plusieurs personnages marquants : Schrøder, le traître converti à l’islam (ou pas), ancien concepteur de jeux vidéos ; Hannah, femme soldat, qui oscille entre l’amour et la révolte ; Sara, afghane énigmatique qui aurait voulu être libre ; et les autres, nombreux. La Première pierre n’est pas qu’un roman de guerre. C’est, beaucoup plus fort, le roman d’un groupe d’hommes (et d’une femme, Hannah, plus éventuellement Sara) embringués dans une situation dont ils ne saisissent pas tous les enjeux et qui les dépasse complètement. Et dont, pour ceux qui survivront, ils souffriront comme jamais ils ne l’auraient imaginé. « Ce n’est pas l’harmonie des sphères, ce sont les explosions qui sont le mode d’existence de l’univers. » Costaud.
* Carsten Jensen, La Première pierre (Den første sten, 2015), trad. Nils C. Ahl, Phébus, 2017
Maurice et Mahmoud
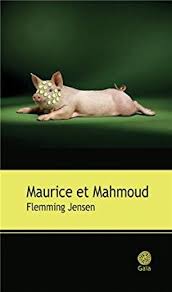
Le thème est peut-être un peu éculé, une histoire d’amitié entre deux individus que de grandes différences culturelles séparent a priori, et pourtant, le roman de Flemming Jensen (né en 1948), Maurice et Mahmoud, de par son humour, est d’actualité. Maurice Johanssen est comptable. Quand il divorce, après vingt-huit ans de vie commune, sa femme, récupère l’entreprise, qui était si judicieusement à son nom, et le voilà à la porte : de sa maison et de son emploi ! Heureusement, son jeune employé Mahmoud Abusaada, une vingtaine d’années plus jeune, lui propose de l’héberger dans son modeste appartement d’un quartier modeste de la banlieue de Copenhague. Et les gags, dès lors, de se succéder. Mahmoud est musulman. Pour Maurice, c’est une découverte, il n’y avait jamais fait attention puisque ce n’était pas un musulman qu’il recherchait lorsqu’il l’avait embauché. « Quand j’y pense, c’était idiot de considérer Mahmoud comme un étranger. Il était né et avait grandi au Danemark, était allé à l’école au Danemark et parlait bien évidemment sans le moindre accent. Grammaticalement, il s’en sortait bien mieux que n’importe quel présentateur sportif. » Les situations cocasses s’enchaînent, puis les quiproquos lorsqu’une impossible histoire d’amour se noue entre Mahmoud et une voisine pas franchement gagnée. On imagine sans mal une version BD de ce roman, avec Charb comme dessinateur, mais voilà, l’attentat contre Charlie-hebdo nous rappelle que les cons, les cons de toutes sortes, supportent mal l’humour. S’ils ne le comprennent pas, ils devinent combien celui-ci peut les déstabiliser et répondent par la violence, plus dans leurs cordes. La lecture de ce petit roman pourrait leur être recommandée, sans trop d’espoir toutefois, elle leur apprendrait au moins l’humilité – autrement dit, qu’il est vain de combattre l’humour, arme anti-cons par excellence. « …Certains sujets sont si sérieux et délicats qu’on ne devrait pas laisser des personnes dépourvues d’humour y toucher », note d’ailleurs, malicieusement, Flemming Jensen en introduction de son roman.
* Flemming Jensen, Maurice et Mahmoud (Mogens og Mahmoud, 2012), trad. Andréas Saint Bonnet, Gaïa, 2013
« Le rire est une approche intellectuelle qui redonne souvent aux désagréments de la vie leurs proportions objectives. » (Flemming Jensen, Maurice et Mahmoud)
La Volonté de Ran
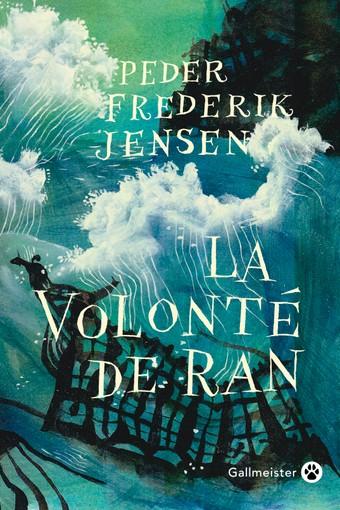
« Dans un pays qui, à y regarder de près, n’est qu’un banc de sable posé sur des écueils entre la mer du Nord, le détroit du Skagerrak et la sinistre mer Baltique, coincé entre le socle nordique et le continent européen, on craint l’eau plus que tout. » L’eau qui irrigue les terres fertiles ou l’eau qui déferle soudain et n’est plus maîtrisable. Comme « lors de ces sombres journées du 12 au 14 novembre 1872 », quand une tempête et un raz-de-marée frappèrent le Danemark. Pour s’en préserver, Roar, dit le Marin, un homme aux riches expériences de par le monde et revenu de tout, construit sa propre maison sur une toute petite île au large d’une petite ville, sur Lolland. « Quand il s’est installé ici, c’était pour que le passé et le présent se rencontrent. » Un jeune garçon, Tête-de-bois, un Gitan peut-être, l’observe puis vient l’aider, jusqu’à ce que le Marin le confie à l’un de ses lointains voisins pêcheurs pour l’assister dans son travail. Lorsque la tempête s’abat, tout est ravagé, il lui semble être le seul survivant. La découverte d’une « boite à pain » contenant une très jeune fillette vivante l’oblige à modifier son existence solitaire. « Mon enfance n’a été qu’un long adieu à ceux que j’aimais », songe-t-il, se souvenant de ses frères et sœurs morts très tôt. La fillette change son rapport à la solitude, qu’il apprécie tant. Elle lui donne des responsabilités. Elle lui fournit un avenir. Lui qui ne parlait guère se met à chanter pour elle, à lui raconter sa vie, à la dorloter. Le misanthrope devient tendre. Mais des survivants apparaissent bientôt et menacent leur sécurité. C’est « le progrès qu’on entrave », s’il refuse de quitter son île et sa maison. Car des travaux d’envergure sont programmés pour éviter les conséquences d’une nouvelle tempête. Ses relations avec les habitants revenus s’enveniment, ils se liguent contre lui, le soupçonnent de ne pas vivre seul, comme il le clame, mais en compagnie d’une petite fille recueillie après la catastrophe, sur laquelle il n’a aucun droit. Ne parlons pas de la fin de ce superbe roman, âmes sensibles s’abstenir, mais conseillons-en la lecture. Né à Copenhague en 1978, Peder Frederik Jensen a publié quatre romans, récompensés au Danemark par des prix. Celui-ci, La Volonté de Ran, à l’écriture minutieuse, place son auteur parmi les grands noms des Lettres danoises. Dans l’attente de la traduction de ses autres titres...
* Peder Frederik Jensen, La Volonté de Ran (Rans vilje, 2023), trad. du danois Françoise Heide, Gallmeister, 2025
L’Art de pleurer en chœur
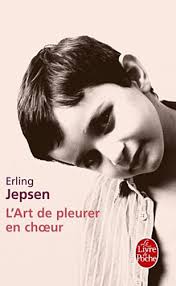
L’idée n’est pas nouvelle, divers psychologues et psychiatres se sont déjà employés à démontrer que la famille, en tant qu’institution, est une véritable fabrique à maladies mentales. Un cinéaste comme Thomas Vinterberg s’y est exercé dans Festen. Avec L’Art de pleurer en chœur et Sincères condoléances, l’écrivain danois Erling Jepsen reprend le flambeau, maniant pour cela un humour aussi noir que convaincant.
Les parents d’Allan, écrivain et dramaturge, résident dans le sud du Jutland. Il n’a plus de relations avec eux. Jusqu’au jour où il apprend la mort de son père. Il décide d’envoyer une couronne mortuaire ornée des paroles d’usage, « sincères condoléances », puis de se rendre auprès de sa mère pour l’assister dans le chagrin qui, croit-il, la ravage. Mais la femme qu’il découvre se ravit d’être enfin veuve. Elle n’est guère si vieille, espère déménager et disposer enfin d’une salle de bain, c’est une nouvelle vie, affirme-t-elle, qui récompense ses années de malheur auprès d’un époux acariâtre. Allan est décontenancé. Ce père qu’il avait longtemps considéré comme une sorte de bourreau qui terrorisait sa femme et violait sa fille, voilà qu’il va se prendre d’affection pour lui et douter des causes de sa mort : l’affreux bonhomme n’aurait-il pas été assassiné ? Une affection à rebours, difficile à assumer, en opposition totale avec le personnage qu’il croit être devenu. « Il mangeait un peu comme son père, à part qu’il ne posait pas le journal à côté de son assiette, comme le faisait le laitier. Pour le reste, on aurait pu s’y tromper. (…) Allan s’était mis à ressembler à son père avec l’âge. » Terrifiant, à vrai dire.
* Erling Jepsen, L’Art de pleurer en chœur (Kunsten at graede i kor, 2002), trad. Caroline Berg, Sabine Wespieser, 2010 et Sincères condoléances (Med venlig deltagelse, 2006), trad. Caroline Berg, Sabine Wespieser, 2011