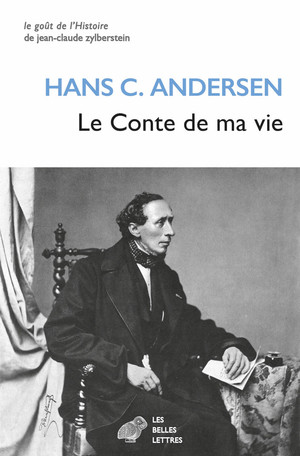A-B
Si la mort t’a pris quelque chose rends-le

Le Livre de Carl est la seconde partie du titre de ce volume signé Naja Marie Aidt : Si la mort t’a pris quelque chose rends-le. Il s’articule autour de la mort de Carl, vingt-cinq ans lorsque sa mère, la narratrice, apprend son décès dans un accident – il s’est défenestré du quatrième étage d’un immeuble du centre de Copenhague, suite à l’absorption de champignon hallucinogène. « Il n’est pas possible d’écrire de manière artistique et esthétique sur le deuil et le chagrin. Il n’y a pas de forme qui y soit adaptée. (…) Écrire sur ce grand inconnu, ce mutisme que nous allons tous rencontrer un jour – comment ? (…) Les mots d’une accablante nullité pendouillent sur les lignes. Les lignes s’arrêtent d’elles-mêmes, abruptement. » Construit en boucles, avec des phrases, des images qui reviennent parce qu’elles sont obsédantes, écrit dans différentes polices de caractères, le deuil d’une mère est ici conté. Des poètes (Stéphane Mallarmé, Inger Christensen, Walt Whitman...) sont conviés, par l’un ou l’autre de leurs propres textes, à donner leur version de la mort d’un être proche et aimé. Face à la mort, il n’y a rien à faire, sinon se souvenir, atteste Naia Marie Aidt (née en 1963 au Groenland). Il y a des livres qu’on n’a pas le cœur à conseiller en dépit de leur qualité. Celui-ci en fait assurément partie.
* Naja Marie Aidt, Si la mort t’a pris quelque chose rends-le – Le Livre de Carl (Har døden taget noget dig så giv det tilbage – Carls bog, 2017), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Do, 2020
Le Conte de ma vie
« Ma vie est un beau conte, riche et heureux. » Une nouveauté, Le Conte de ma vie de H. C. Andersen ? Pas vraiment, bien entendu, mais sa réédition par les Belles lettres n’est pas pour déplaire, tant cette autobiographie romancée fait figure de classique des Lettres nordiques dont la lecture est à recommander. Andersen s’attelle là à retracer une vie largement connue de ses lecteurs et pourtant surprenante. Il commence à écrire du théâtre très jeune, sous les auspices de Holberg et de Shakespeare, que son savetier de père lui lisait. Puis il gagne Copenhague et rencontre des personnes cultivées et fortunées, qui l’incitent à écrire plutôt qu’à tenter de monter sur scène au théâtre. Effectuant des voyage à travers l’Europe, il rencontre les personnalités de son temps et petit à petit gagne la reconnaissance de ses contemporains danois. « Les plus hautes personnalités de mon époque m’ont reçu amicalement et ma foi dans l’humanité n’a pas été trompée. Les jours de détresse et de peine portent quand même en eux des germes de bénédiction », conclut-il. Et comme il en était persuadé, cette autobiographie, Le Conte de ma vie, est un véritable condensé des contes qui ont fait sa gloire.
* Hans Christian Andersen, Le Conte de ma vie (Mit livs eventyr, 1877), trad. Cecilie Lund, Les Belles lettres (Le Goût de l’Histoire), 2019
Le Volume du temps, I

On connaît le film Un Jour sans fin (ou plus exactement Groundhog day, Le Jour de la marmotte) de l’Américain Harold Ramis (1993). Dans Le Volume du temps, la Danoise Solvej Balle (née en 1962 à Bovrup, on ne trouvait d’elle en français qu’un ouvrage, En vertu de la loi. Quatre récits sur l’homme, Gallimard/L’Arpenteur, 1997) part de la même idée, une bifurcation temporelle dans la vie quotidienne. « Le temps pouvait se détraquer, les journées se répéter, des événements s’effacer de votre mémoire. Et la poussière se redéposer sur des objets qu’on était certain d’avoir essuyés. » La narratrice, Tara, par ailleurs bouquiniste avec son mari, Thomas, au nom de T. & T. Selter, vit à Clairon-sous-Bois une petite ville du nord de la France. Le 17 novembre, elle est allée à Bordeaux, faire l’emplette de livres anciens pour des clients, puis à Paris, où elle a passé la nuit, après avoir dîné avec un couple d’amis numismates. Le 18 novembre est une journée semblable à beaucoup d’autres, consacrée à l’achat de vieux volumes. Sauf que le lendemain, elle s’aperçoit que le calendrier lui indique la même date. « ...Deux jours de suite, je m’étais réveillée le dix-huit novembre. Tout ce qui m’arrivait était absolument identique à ce que j’avais vécu le jour précédent ; ma journée était la copie conforme de celle que j’avais archivée dans ma mémoire. » Elle appelle son mari, qui bien sûr ne comprend pas mais accepte ce qu’elle dit. Quelque chose s’est produit. « Hallucinations, paramnésie, malentendus, erreurs d’interprétation, boucles temporelles, univers parallèles. » D’abord avec Thomas auquel elle se confie, puis seule quand elle s’aperçoit qu’il ne sont plus dans le même monde, Tara explore toutes ces hypothèses, des plus crédibles aux plus farfelues, et finit par s’enfermer dans leur chambre d’amis. « Je devais trouver des réponses, une explication, un moyen de m’en sortir. Si j’arrivais à percer les mécanismes du temps, je parviendrais peut-être à remettre la journée sur ses rails. » Si la course du temps angoisse l’être humain depuis, disons la nuit des temps, on peut parier que son immobilisation achèverait de le démolir. Dans ce remarquable ouvrage (le premier d’une série de sept), Solvej Balle ne répond pas à toutes les questions que son intrigue suscite. Continuerions-nous, par exemple, à vieillir ? Ne pas voir passer le temps nous exempterait-il d’en subir les conséquences ? Autant les voyages dans le temps chers à nombre d’auteurs de science-fiction apparaissent, tout au moins aujourd’hui, avec nos connaissances scientifiques, voire philosophiques, comme intrinsèquement irréalisables, autant la disparition du temps ou sa fixation sur un instant ou un jour donné nous semble-t-elle peut-être plus plausible, mais pourtant non moins déstabilisante. « Le temps n’est pas l’étalon qui convient à la vie », affirmait l’écrivain suédois Stig Dagerman (Notre besoin de consolation...). Il n’est pas l’étalon idoine, mais sans la notion du temps, l’être humain se dépouillerait du premier de ses repères. Il serait plus que jamais un animal sans conscience (et que sait-on de la conscience minimale chez l’animal ?), une sorte de minéral doté de croissance. L’enfer à l’état brut ? Les prisonniers condamnés à perpétuité le connaissent-ils ? Tara Selter occupe une position désagréable, affreuse, plongée dans le monde de ses contemporains et toutefois à l’écart, sans prise réel sur celui-ci. Elle tente par tous les moyens de trouver la faille pour récupérer le cours du temps, elle fait même « des projets ». Observons qu’elle ne lit pas de journaux, n’écoute pas la radio, ne regarde pas la télévision, ne consulte pas les réseaux sociaux, médias qui évidemment s’inscrivent dans le temps. Volonté délibérée de l’auteure, sans doute, pour donner à voir un personnage en pleine errance dans un monde qui ressemble fort au nôtre, bien que les lieux mentionnés, ce Paris populeux ou cette commune proche de Lille, soient fictifs. Ce premier volume est une très belle réussite. Nous sommes très curieux de découvrir la suite.
* Solvej Balle, Le Volume du temps, I (Om udregning af rumfang, I), trad. du danois Terje Sinding, Grasset (En lettres d’ancre), 2024
Mikaël

L’écrivain et critique littéraire Herman Bang (1857-1912) a laissé une œuvre variée, que les éditeurs français prennent le temps de nous présenter (parmi une dizaine de titres disponibles en français, signalons Les Corbeaux et Franz Pander aux éditions de l’Élan). Témoin ce roman, Mikaël, publié initialement en 1904, qui n’avait jamais été traduit ici. S’inscrivant dans la veine impressionniste, le personnage central (avec le fameux Mikaël), Claude Zoret, est un peintre français qui n’est pas sans évoquer Claude Monet. Il voue une grande affection à celui qu’il donne pour son fils ou son héritier, Mikaël, Ce roman prenant un milieu très aisé pour cadre (« Ainsi, nous faisons partie des riches, ici en France ») relate leur relation, en réalité une liaison homosexuelle, jusqu’à ce que Mikaël s’éprenne d’une aristocrate russe et trahisse à plusieurs reprises son mentor. « Mort de fatigue – voilà mon état depuis quinze ans », se lamente ce dernier. « Épuisé par cette course perpétuelle contre moi-même. (…) Une course pour créer de grandes œuvres, suivies d’autres œuvres encore plus grandes, suivies d’œuvres plus grandes que toutes les précédentes… jusqu’à cette œuvre suprêmement grande que je ne créerai jamais. » S’inscrivant dans la « percée moderne » chère au critique Georg Brandès, ce livre (à lire, pour ce bouillonnant portrait de peintre, peut-être à la suite de L’œuvre de Zola) a fait l’objet de deux adaptations cinématographiques : par Mauritz Stiller en 1916 et par Carl Theodor Dreyer en 1924.
* Hermang Bang, Mikaël (Mikaël, 1904), trad. et prés. Elena Balzamo, préf. Klaus Mann), Phébus, 2012
Existences silencieuses
Désuet, ce recueil de nouvelles, Existences silencieuses ? Assurément et c’est ce qui fait son charme. L’écrivain danois Hermang Bang (1857-1912) est édité en France sporadiquement. Un titre de temps en temps, comme s’il avait la volonté posthume de ne pas être oublié des lecteurs. Au Danemark, il est l’un des grands noms de la littérature, ainsi que le rappelle Christian Bank Pedersen, professeur de littérature et de civilisation scandinave à l’université de Caen, dans sa préface. Dénigré par beaucoup de son vivant, pour son dandysme et parce qu’il était homosexuel, Bang a signé une œuvre variée, qui fait de lui, selon le mot du peintre Claude Monet, « le premier écrivain impressionniste ». Il met en scène dans ces nouvelles un monde révolu, le quotidien d’une époque pourtant guère si lointaine où bien des rapports entre les individus paraissent excessivement feutrés : « Il atteint le chœur. Les têtes se redressent un peu, on s’assoit, le silence s’établit. Les chaises sont majoritairement occupées par les dames : de vieilles amies de la famille, des jeunes filles qui trouvent délicieux de voir des noces, des bavardes qui viennent là passer le temps, des existences oisives pour qui l’église est comme une scène de théâtre, de jeunes couturières étudiant les modes, des servantes voulant admirer ou envier ; toutes apportent avec elles la poussière de la rue, la saleté des pavés, le babillage de la vie quotidienne. » Le ton est juste, toujours, jamais précieux, les descriptions sont soignées. L’ironie pointe (cf. « Parias »). L’écrivain ne prête pas d’intentions à ses personnages, issus de tous les milieux sociaux bien que surtout de l’aristocratie, et ce sont les agissements de ceux-ci qui emportent le récit. L’amour, au centre de nombre de ces nouvelles, l’amour et le « dépit amoureux » jusqu’au suicide... Bonne idée, que de publier encore Herman Bang, méconnu, à l’instar d’autres grands écrivains nordiques, de la plupart des lecteurs français.
* Herman Bang, Existences silencieuses, trad. Jacques Privat et Christian Bank Pedersen, préface Christian Bank Pedersen, La Reine blanche, 2019
À la recherche de la reine blanche

Il y a des livres, des romans, qu’on laisse passer parfois, manque de temps ou raison particulière, jusqu’au moment où l’on se dit que c’est bien dommage. Ainsi, À la recherche de la reine blanche, de Jonas T. Bengtsson (né en 1976 et qui se réclame, question littérature, de Per Olov Enquist, Camus et Hemingway). Nous avions lu Submarino, du même auteur, avec une certaine réserve, avions vu le film qui en avait été adapté en 2010 par Thomas Vinterberg, avec plus d’enthousiasme. Et ce roman, À la recherche de la reine blanche, était sorti, sans retenir notre attention. Jusqu’à ce que, donc, nous le prenions en main et commencions à en tourner les pages. Et surprise, Peter, le jeune garçon au centre de l’intrigue, nous touche immédiatement par son regard simultanément naïf et pertinent sur le monde qui est le sien. Il vit seul, dans le Danemark des années 1980, avec son père, un homme qui déménage régulièrement et exerce divers métiers, qui est loin d’être un rustre, qui compte nombre d’amis çà et là, qui sait parler, qui sait embobiner ceux qui peuvent le servir, une sorte d’aristocrate de la marginalité. Un homme qui possède des secrets, comme le découvre peu à peu son fils. « Chaque fois que nous déménageons, j’espère que les cauchemars ne nous suivront pas. (…) Nous emménageons, et pendant un certain temps, ils nous laissent tranquilles. Pendant une semaine, un mois. C’est variable. » L’enfant ne va pas à l’école, il apprend les rudiments de la vie en compagnie de son père et des personnes rencontrées au fil de leurs pérégrinations. Le paternel travaille, au noir peut penser le lecteur. « Ton père est quelqu’un de très intelligent », lui révèle un jour une vieille dame chez qui ils ont élu domicile contre de menus travaux. « J’ai un tiroir entier de coupures de presse, des articles qu’il a écrits pour des journaux et des magazines. Il n’a pas toujours taillé des haies. » Quand la vieille dame meurt, le père récupère les économies qu’elle possédait et déménage de nouveau. Le voilà à présent videur dans un peep-show de la capitale. Peter et lui logent dans la chambre d’un hôtel voisin. Cette première partie du roman n’est pas sans évoquer le chef d’œuvre de Martin Andersen Nexø, Pelle le conquérant, avec cette relation père-fils aussi tendre, aussi chaleureuse que peu conventionnelle. Toujours au Danemark, on peut songer également, pour la proximité affective entre les deux personnages principaux, à Printemps précoce de Tove Ditlevsen, Mais le père finit par être arrêté. Le lecteur retrouve Peter des années plus tard, il habite maintenant chez sa mère et son beau-père. C’est un jeune homme, qui essaie de comprendre l’engrenage familial. Il se rend à l’enterrement de son grand-père, découvre que celui-ci aurait abusé de son père. Rien n’est vraiment dévoilé dans ce roman et le lecteur n’en sait finalement pas plus que Peter, lequel, quand il entre dans sa vie d’adulte, décide de changer de nom. C’est avec un patronyme turc qu’il va obtenir un statut dans le monde artistique. Il dessinait lorsqu’il était enfant, il peint à présent, et la reconnaissance vient. Il retrouve son père, toujours emprisonné, considéré comme irrémédiablement fou. « Il n’est sans doute pas le premier à être devenu un peu zinzin à force de passer son temps la tête dans les livres. » Tout est ici en intelligence et en sensibilité. Un très beau roman initiatique avec une fin un rien déconcertante.
* Jonas T. Bengtsson, À la recherche de la reine blanche (Et eventyr, 2011), trad. Alex Fouillet, Denoël (& d’ailleurs), 2013
La Fille hérisson

Âgée de dix-neuf ans mais d’allure si chétive qu’elle en paraît douze, Suz est une jeune fille qui vit seule dans un petit appartement, quelque part dans une cité de Copenhague. Quand elle apprend que son père va être libéré prématurément de prison pour bonne conduite, elle décide de faire justice elle-même. L’homme ne s’est jamais occupé de ses enfants (Suz a un frère aîné, qui n’apparaît pas) et a laissé mourir sa femme, toxicomane, attachée aux montants du lit conjugal. Pour gagner l’argent qui lui permettra de trouver une arme, Suz vend des joints dans les collèges des alentours. Avec La Fille hérisson, Jonas T. Bengtsson (né en 1976 et auteur de Submarino et de l’excellent roman À la recherche de la reine blanche), présente quelques journées dans la vie de Suz, un moment charnière. Il montre combien tout peut être extrêmement difficile pour certains individus : quand les événements s’enchaînent dès avant votre naissance et vous mènent là où vous n’auriez pas forcément envie d’être. Suz va tester ses limites. Quelle violence, sur elle et sur autrui, est-elle capable d’assumer ? Un coup de poing littéraire. (Mais le titre... bof !)
* Jonas T. Bengtsson, La Fille hérisson (Suz, 2017), trad. Alex Fouillet, Denoël (& d’ailleurs), 2018
La Vie est pleine d’hippopotames
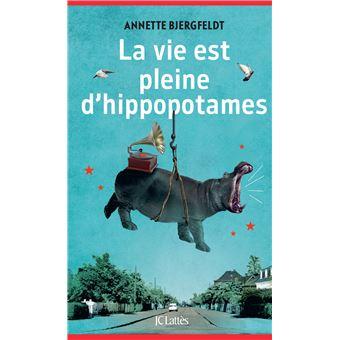
La Vie est pleine d’hippopotames, de Annette Bjergfeldt (par ailleurs peintre, musicienne, compositrice, chanteuse...), est un roman qui se passe en famille. Une fresque, qui commence peu avant la Première Guerre mondiale en Russie et se termine de nos jours au Danemark et en Suède. Un roman attachant, avec des personnages singuliers (dont le chien Igor, à la personnalité très marquée), notamment trois sœurs. « ...Olga n’aspire qu’à une seule chose : l’Amour du Siècle. Pour ma part (Esther), je prie de devenir la grande coloriste de ma génération. Le vœu de Filippa, hormis d’être cosmonaute dans un vaisseau spatial russe, reste un secret. » Tous possèdent un caractère trempé et le lecteur peut se demander comment font-ils pour cohabiter dans la bonne humeur constante qui imprègne cette histoire. Si le ton est plutôt léger, en effet, les tragédies s’accumulent, sans qu’aucun membre de cette famille hétéroclite ne sombre bien longtemps dans le désespoir. En toile de fond plus ou moins lointaine, la Première Guerre mondiale, donc, la révolution russe, puis la Deuxième Guerre, jusqu’à nos jours ou pratiquement. Le roman débute par le voyage pour affaires d’un jeune Suédois, Hannibal, en Russie. À Saint-Pétersbourg, alors nommée Petrograd, il assiste à la représentation d’un cirque et tombe amoureux de sa contorsionniste, Varinka, dont le compagnon, un trapéziste, est mort récemment, tombé dans la gueule d’un hippopotame. « La vie est pleine d’hippopotames qui répandent leur merde, alors qu’en fait ils veulent juste être amis. Cet animal en forme de tonneau n’y peut rien si sa morsure est aussi fatale. » Hannibal et Varinka s’installent dans la maison qu’il a achetée sur l’île d’Amager, à Copenhague. Très différents l’un de l’autre, ils fondent toutefois une lignée, ou ce qui s’y apparente : l’une deviendra cantatrice, l’autre peintre, une autre encore entretiendra le rêve de voler dans l’espace. Les enfants et les petit-enfants vont s’évertuer à trouver leur place dans un monde où l’hippopotame n’est pas le seul à « répandre sa merde ». Un roman à lire non pas pour se détendre, il est trop riche, trop dérangeant pour cela, mais pour se redonner la pêche les jours où le moral n’est pas au plus haut.
* Annette Bjergfeldt, La Vie est pleine d’hippopotames (Højsangen fra Palermovej, 2020), trad. Catherine Renaud, JC Lattès, 2022
Agathe
Le narrateur de ce roman de Anne Cathrine Boman (« douze fois championne de tennis de table », nous apprend le rabat intérieur du livre), Agathe, est un psychanalyste de bientôt soixante-douze ans. À une époque indéterminée (la France des années 1940 ?), il s’apprête à prendre sa retraite sans regret, lorsqu’une patiente s’impose dans son cabinet. D’origine allemande, Agathe Zimmermann va vite le bouleverser. « Je suis venue (…) parce que j’ai de nouveau perdu l’envie de vivre. Je ne nourris aucune illusion d’aller bien, j’aimerais simplement pouvoir fonctionner. » D’abord réticent, il accepte de la recevoir, puis se prend à attendre ses visites et même, à la surveiller de loin. Leurs solitudes ne se ressemblent-elles pas ? « Je crois que la vie elle-même est devenue dangereuse », dit encore Agathe. « J’ai maintenant peur de jouer de la musique, peur de ne pas le faire, peur de m’approcher de quelqu’un, peur d’être seule. Nulle part il n’y a de place pour moi ! » Heureuse petite surprise, ce roman nous montrent deux êtres esseulés qui se rencontrent... Sympathique, quoi que dans l’air du temps.
* Anne Cathrine Bomann, Agathe (Agathe, 2017), trad. Inès Jorgensen, La Peuplade (Roman), 2019
En lisant Saxo Grammaticus
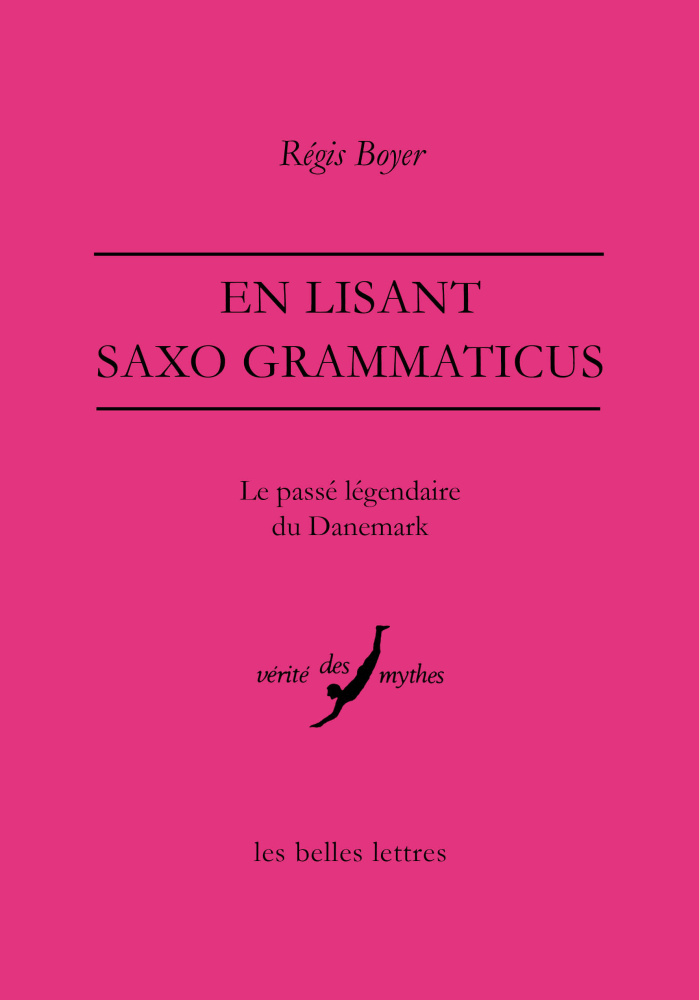
Qui d’autre que Régis Boyer pouvait consacrer une étude à Saxo Grammaticus ? Auteur d’un chef d’œuvre en latin et, de ce fait, méconnu d’une bonne part de la gent lettrée, l’écrivain s’inscrit toutefois pleinement dans l’histoire littéraire de son pays. « …Il y a beau temps que j’avais envie de consacrer un petit travail à ce Danois », explique Régis Boyer en introduction, soulignant que La Geste des Danois, œuvre principale de Saxo Grammaticus, est disponible en français depuis 1995, et replaçant l’écrivain au début d’une tradition de conteurs (« le génie conteur du Nord ») qui comprendra H. C. Andersen, Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, William Heinesen, Zacharias Topelius, et quelques autres. À l’instar du Kalevala ou, en France, du Roman de Renart, La Geste des Danois est une épopée qu’il ne s’agit pas de prendre au pied de la lettre mais qui se révèle capitale pour comprendre les mœurs, plus que les faits historiques, d’une époque et d’une région du monde. Bien que peu lu même de son vivant en raison de la complexité de sa langue, Saxo Grammaticus (ses dates de naissance et de mort sont approximatives : 1150-1206 ou 1216) est « LE plus grand écrivain danois de son temps et, assurément, l’un des plus grands écrivains européens du Moyen Âge » note encore Régis Boyer.
* Régis Boyer, En lisant Saxo Grammaticus, Les Belles lettres (Vérité des mythes), 2016
Le Château des étoiles
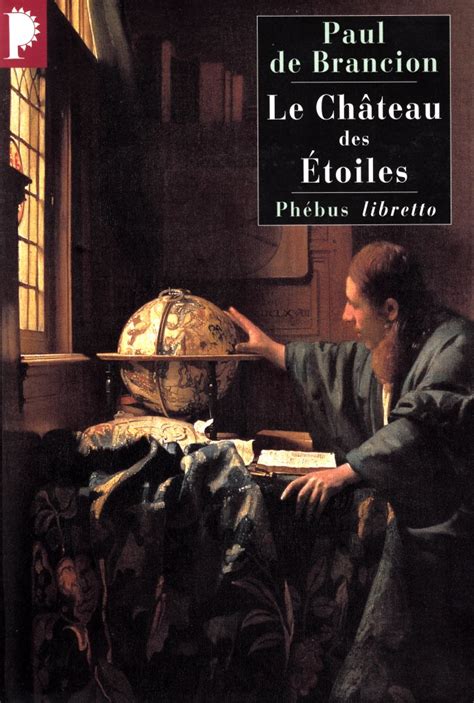
Les images, celles qui accompagnent les grands de ce monde, supportent mal la réalité, nous démontre Paul de Brancion dès les premières pages de son roman Le Château des étoiles. L’astronome Tycho Brahé (1546-1601), dont il retrace la biographie, finit détesté par sa femme, qui lui donnera treize enfants – que des garçons : il « la dégoûtait avec ses poils puant la graisse de phoque dont il s’enduisait le corps pour se protéger du froid, et ses ongles longs, sales et cassés ». Il y a heureusement beaucoup d’autres choses à retenir de cet homme certes pas des plus sympathiques mais hors du commun, qui révolutionna la façon d’observer le ciel et les astres et fit l’inventaire de plusieurs centaines d’étoiles. Dans un récit linéaire, Paul de Brancion (né en 1951 et auteur français de plusieurs romans) nous présente d’abord le jeune Tycho Brahé étudiant à Copenhague. Son enthousiasme pour des matières réputées difficiles étonne ses professeurs. Jørgen, son père adoptif, pense en revanche qu’il serait temps qu’un tel jeune homme « à l’esprit éveillé » songe à une véritable carrière, c’est-à-dire entrer dans « le droit, l’administration et la religion ». Tycho Brahé préfère quitter le pays, trop étroit selon lui pour sa curiosité intellectuelle. En Allemagne, il suit des études de droit avant de replonger dans l’astronomie, osant s’affronter aux plus grands esprits : « Il avait longtemps cherché à élaborer un système qui pût intégrer les théories de Copernic sans pour autant abandonner la fixité de la Terre qui était à ses yeux indiscutable. » Il retourne au Danemark et, sous les auspices du roi Fredrik II qui lui est très favorable, s’établit sur l’île de Vaine (Hveen), face à Helsingør, dans le détroit de l’Öresund. Là, il fait bâtir un château et un observatoire, que l’on peut encore visiter aujourd’hui, et se livre à des supputations sur les étoiles et le mouvement des astres et s’interroge sur la réfraction de la lumière, avant de passer le flambeau à Johannes Kepler. « Le ciel grâce à Tycho Brahé s’est largement étendu… » Dans une langue à la fois riche et fluide, Paul de Brancion restitue dans ce roman, Le Château des étoiles, le portrait d’un homme auquel l’astronomie est toujours redevable en dépit de sa persistance à croire que « le Soleil tourne autour de la Terre et non l’inverse » et à voir en tout phénomène la main de Dieu.
* Paul de Brancion, Le Château des étoiles, Phébus, 2005