Q-R-S
Leona/La Fin justifie les moyens
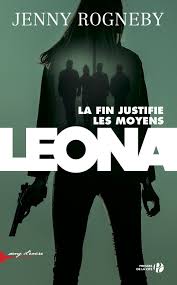
« La plupart des gens me décriraient comme une banale mère divorcée, âgée de trente-cinq ans, occupant un poste peut-être légèrement original, mais autrement ne se distinguant en rien de ses semblables. Mes collègues voyaient en moi une inspectrice compétente. (…) J’étais une citoyenne responsable qui défendait les valeurs de l’institution et les lois qui régissaient notre société. Rares étaient ceux qui connaissaient ma véritable identité. » Ainsi se présente l’inspectrice Leona Lindberg dans le deuxième roman de Jenny Rogneby, La Fin justifie les moyens, ajoutant : « J’étais bien consciente que mes choix allaient à l’encontre de tout ce que la société escomptait d’une femme, d’une mère et d’une policière. » Mais Leona est comme elle est et d’ailleurs, sa hiérarchie en est bien consciente (jusqu’à un certain point) et n’hésite pourtant pas à lui demander d’interroger le survivant d’une action terroriste devant le siège du Riskdag, le parlement suédois. Ce que la hiérarchie ne sait pas, c’est que, pour arrondir ses fins de mois, Leona donne carrément des cours à des malfrats : comment réussir son coup sans se faire ensuite pincer par la police, explique-t-elle, dans l’espoir de récolter les bénéfices de leur professionnalisation. Personnage de femme forte et double à l’image, finalement, de Lisbeth Salander dont les émules jouent aujourd’hui des coudes (jusqu’aux références, ici, à Pippi Långstrump/Fifi Brindacier, le personnage d’Astrid Lindgren), Leona se voit concurrencer par d’autres héroïnes de romans policiers – songeons, par exemple, à Jana Berzelius, procureure, dans Marquée à vie de Emelie Schepp. Leona comme Jana n’ont guère de morale et ne défendent la justice que lorsque cela les arrange. Comme dans Les Dés sont jetés, premier volume de la série Leona, on se laisse emporter par le récit sans pourtant jamais y adhérer. Une lecture divertissante, sans plus, hélas, tant, nous semble-t-il, la crédibilité du personnage principal n’est pas le souhait premier de l’auteure.
-
Jenny Rogneby, Leona – La Fin justifie les moyens (Leona. Alla medel tillåtna, 2016), trad. Lucas Messmer, Presses de la Cité, 2017
L’Été des loups
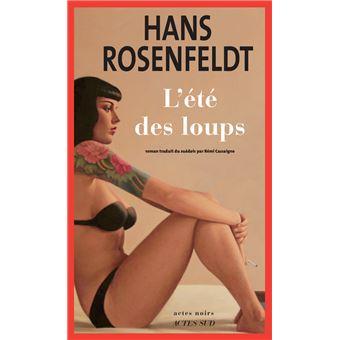
De nos jours. Deux loups sont retrouvés morts, dans la région frontalière entre la Suède et la Finlande, avec de la viande humaine dans l’estomac. La policière Hannah Wester, du commissariat de Haparanda, mène l’enquête avec ses collègues. Dans le même temps, Katya, une jeune femme particulièrement douée pour se fondre dans son environnement et capable de tuer sans éprouver le moindre sentiment, est à la recherche, pour le compte des mafieux russes, d’une livraison de drogue et d’une grosse somme d’argent disparues, pour lesquelles des hommes se sont entre-tués. Le roman de Hans Rosenfeldt, L’Été des loups, est un peu laborieux : beaucoup de personnages, diverses actions qui s’entrecroisent, des malfrats russes omniprésents et peu convaincants... La région du Tornedalen est au centre de plusieurs livres parus ces derniers temps (pensons à Tove Alsterdal, Nina Wähä ou Mikael Niemi...). La voici présentée comme une plaque tournante du trafic de drogue. Pourquoi pas ? L’intérêt de ce roman est d’ailleurs de faire voyager le lecteur au nord du golfe de Botnie, la ville de Haparanda prenant même la parole de temps à autre, comme un personnage à part entière. « C’est une ville. Les hommes meurent chez elle, comme partout ailleurs. Vieillesse, maladie, suicide, overdose, accident, les causes sont nombreuses. Mais rarement la violence. Plus rarement encore le meurtre. Du haut de son expérience, elle constate que c’est ça qu’il lui faut désormais pour qu’on s’intéresse à elle : des tragédies et des morts violentes. » Cela ne va pas au-delà. Hans Rosenfeldt (né en 1964, en Suède) livre ici son premier roman écrit en solitaire. Avec Michael Hjorth, il avait cosigné la série axée sur le profiler Sebastian Bergman. L’Été des loups est ce qu’on appelle un honnête roman policier, sitôt oublié une fois refermé. Une série est pourtant annoncée avec cette policière tourmentée, Hannah Wester. Il faudra s’accrocher !
* Hans Rosenfeldt, L’Été des loups (Vargasommar, 2020), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noirs), 2022
Qui est là ?
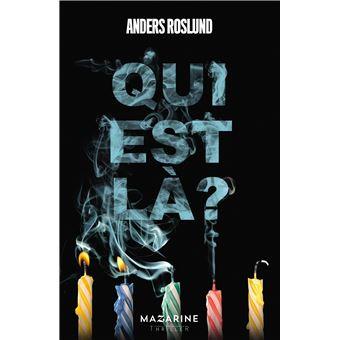
Après 3 secondes, puis 3 minutes et 3 heures, voici, toujours avec le commissaire Ewert Grens comme personnage principal, un nouveau roman de Anders Roslund (seul cette fois-ci), Qui est là ?, qui pourrait s’intituler 3 jours. Comme les précédents, celui-ci est un thriller ancré dans les questions géo-politiques du moment. « ...Les violences par armes à feu avaient explosé ces dernières années dans les grandes villes suédoises. (…) Actuellement, en Europe, il n’y avait que le sud de l’Italie qui était comparable à la Suède en nombre de fusillades. » Un jour, Ewert Grens intervient à Stockholm, Dalagatan, pour un quadruple meurtre : le mère, la mère, leur fille et leur fils ; seule leur petite fille de cinq ans est retrouvée en vie, après avoir passé plusieurs jours dans l’appartement avec les cadavres. Dix-sept ans plus tard, une infraction est commise au même endroit et le commissaire se questionne : quel lien ? Dans le même temps, Piet Hoffmann, aujourd’hui à la tête d’une boîte de sécurité, est retrouvé par les membres d’une mafia qu’il avait infiltrée et dénoncée pour le compte de la police suédoise. Outre la sienne, la vie de sa femme et celles de leurs trois enfants sont en jeu. Deux autres meurtres, dans des conditions similaires se produisent. À présent à six mois de la retraite, Ewert Grens est appelé à enquêter. « Comment une personne trouve-t-elle l’ivresse, un sens à sa vie, quelque chose d’autre quand elle ne s’est jamais donné la peine d’apprendre où et comment elle devait le chercher ? » Comme dans les autres romans du duo Börge Hellström/Anders Roslund, l’enquête est ici tarabiscotée au possible. Plusieurs pistes s’entrecroisent et le lecteur peut perdre de vue le pourquoi des agissements des uns et des autres – flics et bandits. Avouons que ce n’est pas le genre de romans que nous préférons. Anders Roslund arrive toutefois à retomber sur ses pieds avec brio. La situation sociale et politique actuelle de la Suède est présentée, avec les enjeux qui dépassent une analyse purement locale. Machiavélique, son intrigue se tient et il parvient presque à nous arracher une larme dans les dernières pages.
* Anders Roslund, Qui est là ? (Jamåhonleva, 2019), trad. Catherine Renaud, Mazarine (Thriller), 2022
Made in Sweden
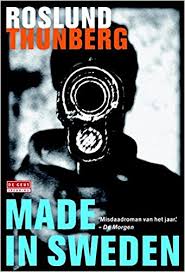
Rien à voir avec les précédents romans signés Anders Roslund et Börge Hellström. Celui-ci, Made in Sweden, signé cette fois-ci Anders Roslund et Steffan Thunberg, se lit d’une traite en dépit de ses plus de six cents pages. Et se révèle intelligemment construit. En Suède, dans les années 1990, un gang familial se livre, après avoir dérobé un très important stock d’armes de l’armée, à une série de braquages tous plus audacieux les uns que les autres. « La même bande qui surgit de nulle part et qui disparaît sans laisser de traces. » John Broncks, un policier du commissariat de Stockholm, tient à se charger de l’enquête. Pour lui, c’est évident que les braqueurs ont un lien entre eux, un lien affectif fort. Anders Roslund (né en 1961) et Stefan Thunberg (né en 1968, auteur et metteur en scène, réalisateur de diverses séries télévisées dont des adaptations de Mankell/Wallander) ont écrit là un excellent roman, pas tout à fait un roman policier (l’enquête est assez succincte et d’ailleurs, les coupables sont connus dès les premières pages), plutôt une sorte de saga familiale rocambolesque. Stefan Thunberg affirme s’être inspiré de ses trois frères, auteurs de braquages. Outre le titre, Made in Sweden(Björndansen,La Danse de l’ours, mot pour mot, en suédois) regrettons juste que les mobiles des braqueurs, et notamment du chef, Leo, soient assez peu exposés. Empocher illégalement un maximum d’argent, pour être tranquille après ? Nous aurions aimé connaître un peu plus la personnalité de ces individus qui font usage, si besoin est, d’une grande violence, et que les deux auteurs parviennent néanmoins à rendre relativement sympathiques. « Les quatre braqueurs cagoulés n’avaient pas seulement forcé la police à revoir ses méthodes, ils avaient modifié le comportement des criminels dans leur ensemble. » Un bon livre, avec des descriptions réalistes des préparatifs et du cours des hold-up, qui semble conçu pour une adaptation cinématographique. Une suite existe, Blodsbrörs (Frères de sang), qui verra l’alliance criminelle de Leo et de Sam, le frère de... John Broncks.
* Anders Roslund & Stefan Thunberg, Made in Sweden(Björndansen, 2014), trad. Frédéric Fourreau, Actes sud (Actes noirs), 2018
Si tu me balances
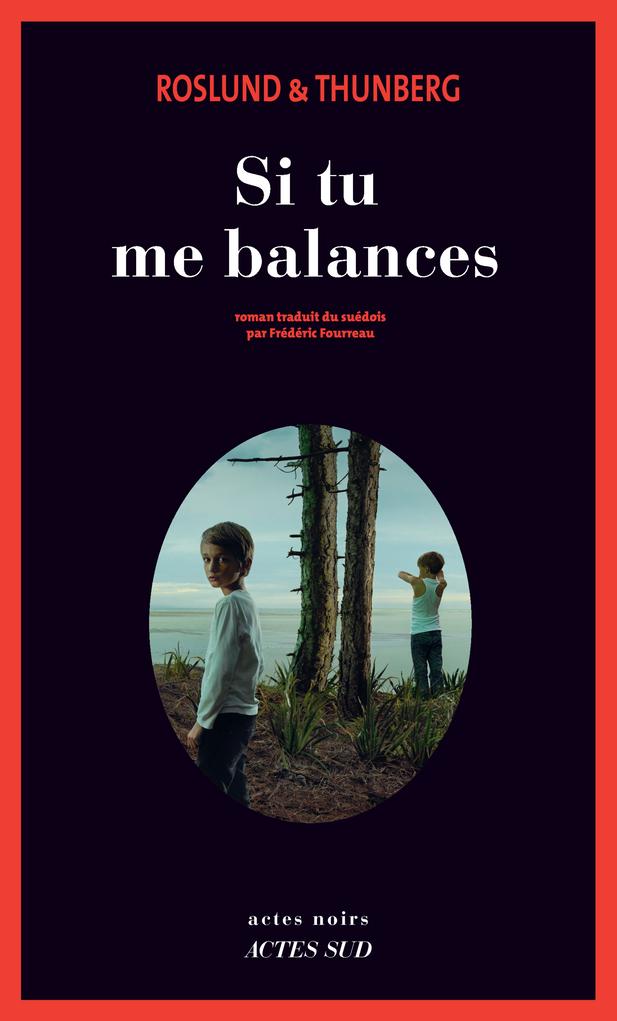
Si tu me balances, de Anders Roslund et Stefan Thunberg, s’inscrit après Made in Sweden, roman dans lequel les deux auteurs relataient l’épopée d’une famille de malfrats de haut niveau, si l’on peut dire, dans la Suède de la fin du XXe siècle. Un très bon roman. À présent, le personnage principal, Léo Dûvnjac, à peine sorti de prison, entend réaliser une série de gros coups avant de quitter le pays. Un premier braquage dans un centre commercial tourne mal, l’un de ses complices est tué et la police, vu le mode opératoire, comprend qu’il en est à la tête. Assisté d’Elisa Cuesta, policière très méthodique, John Broncks, le policier qu’il l’avait conduit en prison, se remet en chasse, sans d’abord se douter que son propre frère est devenu le bras droit de Léo alors qu’il était derrière les barreaux. Commence un jeu de je sais que tu sais que je sais... au cours duquel chacun tente de berner l’autre. « Quand il repartira d’ici », se dit John lors d’un interrogatoire de Léo, « il faudra qu’il soit suffisamment sûr de lui pour ne rien changer à ses projets ». Léo tente d’embringuer son père et ses frères, une nouvelle fois, mais ceux-ci déclarent respecter à présent la loi. Si tu me balances est un roman policier bien conçu, donné pour « inspiré de faits réels » en partie. Made in Sweden possédait une autre dimension, entre le roman familial, le roman d’aventure et le roman policier. Un prochain volume semble envisagé. À voir...
* Anders Roslund/Stefan Thunberg, Si tu me balances (En bror att dö för, 2017), trad. Frédéric Fourreau, Actes sud (Actes noirs), 2021
3 minutes
Après 3 secondes, voici 3 minutes, toujours du duo Roslund et Helström. Piet Hoffmann s’est évadé de Suède et, réfugié en Colombie, travaille à présent pour le compte des services de renseignements américains. Il a infiltré la mafia afin de lutter contre les trafics de cocaïne. Mais le Cartel enlève le responsable de la Chambre des représentants et le voici malgré lui propulsé au-devant de la scène. Sa vie est en jeu. Son vieil ennemi d’hier, le policier Ewert Grens, va devoir quitter la Suède et venir le sauver. « Au centre du grand écran, il y avait maintenant une cible, ou du moins quelque chose qui y ressemblait, à savoir des anneaux concentriques. Au centre de ceux-ci apparut une maison. Lorsque le drone, et donc la caméra, s’en approcha, il apparut clairement que quelque chose bougeait, devant la maison, sans doute trois êtres humains... » De l’action, beaucoup d’action et des situations inextricables qui soudain se résolvent... C’est bien construit mais... À petites doses seulement ! Et cette fois-ci, avec ce deuxième volume, c’est encore six cents pages de rebondissements que le lecteur est censé avaler.
* Anders Roslund et Börge Helström, 3 minutes (Tre minuter, 20161), trad. Philippe Bouquet et Catherine Renaud, Mazarine, 2019
3 heures
Après 3 secondes, puis 3 minutes, voici 3 heures. Terminé le duo Roslund et Helström, avec la mort de ce dernier. Anders Roslund est à présent seul à l’écriture. Un cadavre est retrouvé dans la morgue d’un hôpital. « Qui était venu par ses propres moyens. Qui était dépourvu d’identité et d’histoire. Qui n’était personne. » Un homme de peau noire. Peut-être un Africain de l’ouest. D’autres cadavres non identifiés surgissent mystérieusement dans d’autres morgues. Les enquêteurs relèvent une empreinte digitale sur un téléphone portable dissimulé dans la doublure de la veste d’un mort, elle appartient à Piet Hoffmann, autrefois l’ennemi juré du commissaire Ewert Grens (cf. 3 secondes), aujourd’hui (cf. 3 minutes) son ami ou tout comme. Que vient-il faire dans cette histoire ? Des dizaines de morts dans des containers, dont deux semblent former un couple. Ewert Grens file au Niger, où Piet Hoffman exerce comme mercenaire, lui explique la situation et le contraint à lui rendre un service, promis lorsqu’il lui a sauvé la vie en Colombie : « Je veux (…) que tu infiltres l’organisation qui a fait payer ce couple de réfugiés. Que tu t’informes du nom de leur membre suédois qui s’engraisse sur le dos de ceux qui meurent étouffés dans des containers, chez nous. (…) C’est comme ça que tu paieras ta dette... » Réticent, car affirmant vouloir vivre une vie paisible dorénavant, en Suède, avec sa femme et leurs enfants, Hoffmann finit par accepter. Le voici aux premières loges pour observer comment fonctionnent les trafics d’êtres humains au départ du continent africain en direction du l’Europe. Comme les deux précédents, 3 heures est un roman dense, centré sur les deux personnages de Ewert Grens et de Piet Hoffman. Deux personnages d’exception, tant par leur force physique que par leur ingéniosité, des super-héros qui prétendent ressembler à n’importe qui, au point que l’intrigue est très peu crédible. « Toujours, le divertissement en premier lieu », explique Anders Roslund dans sa postface, expliquant la conception de la trilogie et se vantant, quelque peu abusivement, d’avoir renouvelé le genre du roman policier nordique. Quelque part entre le roman policier, le roman d’espionnage, le roman d’action, surtout, 3 heures : bien trop épais pour être divertissant, à vrai dire. Pour les longues nuits d’insomnie, peut-être.
* Anders Roslund, 3 heures (Tre timmar, 2018), trad. Philippe Bouquet et Catherine Renaud, Mazarine, 2019
Jusqu’au dernier battement
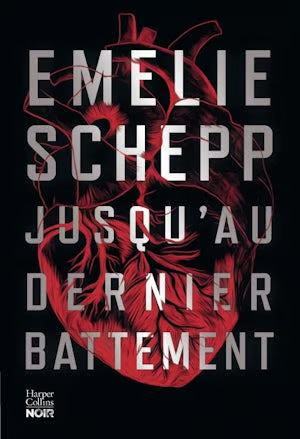
Dans ce roman, Jusqu’au dernier battement, Emelie Schepp abandonne l’héroïne de ses volumes précédents, la procureure Jana Berzelius, pour une enquêtrice peut-être plus classique. Maia Bohm, « mère célibataire dans une ville inconnue », à qui son ex a « rendu la vie infernale », est mutée à Motala. « Maia (…) promena son regard de Peppe à Noomi avant de revenir à Greg. C’était donc là l’équipe dans laquelle elle avait atterri. Arriverait-elle à collaborer avec eux. Réussirait-elle seulement à recommencer à zéro, à reconstruire une vie nouvelle ?... » Un an auparavant, une jeune femme, Amanda Sundin, a disparu. Elle était au téléphone avec Johan, son mari, lorsqu’elle semble avoir été victime d’une agression en rentrant sa voiture dans leur garage. Depuis, aucune nouvelle. Le jour de l’arrivé de Maia à son nouveau poste, Johan est la cible d’une violente attaque. Survivra-t-il ? Ne serait-il pas l’assassin de sa femme ? Assistée de Greg, collègue pas toujours très dégourdi (« Il habitait ce deux-pièces depuis deux ans, avec pour toute compagnie les maquettes en Lego qu’il collectionnait depuis qu’il était petit. »), Maia, qui rougit vite, se décarcasse avec ses deux enfants, Tim et Ella, et sa mère peu amène à la rescousse. « La fatigue, la culpabilité, la peur, tout lui déferlait dessus. » Son fils de treize ans est hospitalisé, en attente d’un donneur de cœur, au point qu’elle en vient à souhaiter la mort de ce Johan, dont l’organe pourrait être compatible. « Elle était passée en coup de vent à la maison après l’hôpital afin de changer de T-shirt et boire le demi-bol de chocolat qu’Ella avait laissé traîner sur la table de la cuisine. Il fallait qu’elle soit à l’heure pour récupérer sa fille au centre de loisirs aujourd’hui. » Les coïncidences se multiplient, les rebondissements incitent le lecteur à tourner les pages. Emelie Schepp maîtrise bien ses personnages et leur enquête. Jusqu’au dernier battement est un roman policier agréable à lire mais ce coté course contre la montre pour sauver son fils (la famille, les enfants, décuplent les forces et suffisent à expliquer tous les comportements !) a un air de déjà lu cent fois. Attendons la suite.
* Emelie Schepp, Jusqu’au dernier battement (Hungra dagar i juli, 2024), trad. du suédois Rémi Cassaigne, HarperCollins (Noir), 2025
L’Appel de la sirène
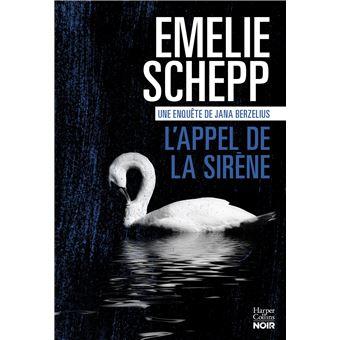
Un cadavre de femme, les jambes cousues ensemble, est retrouvée dans un cours d’eau à Nörkkoping. La procureure Jana Berzelius est en charge de l’enquête. Puis un deuxième cadavre, un troisième... À chaque fois, même mode opératoire. Qu’ont en commun ces victimes ? Le coupable souffrirait-il de « dysphorie de genre, c’est-à-dire le sentiment d’être né avec le mauvais sexe » ? Mia Molander et Henrik Levin assistent Jana Berzelius, laquelle va être amenée à demander de l’aide à... son frère honni, Danilo Peñas, incarcéré à vie dans un centre psychiatrique pénitentiaire. Comme les autres volumes de la série, L’Appel de la sirène est d’une lecture aisée et ne devrait pas laisser trop de traces dans les mémoires. Les enquêtes de Jana Berzelius sont en cours d’adaptation pour la télévision, nous apprend par ailleurs l’éditeur.
* Emelie Schepp, L’Appel de la sirène (Broder Jakob, 20129), trad. Rémi Cassaigne, HarperCollins (Noir), 2021
Les Griffes du silence
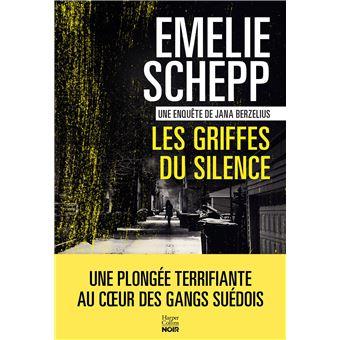
À Norrköping, trois jeunes hommes sont tués au couteau dans une forêt – des dealers. Un survivant est assassiné à son tour, avec une ceinture d’explosifs autour du torse. Tous appartenaient au gang dit Komados, extrêmement brutal et en voie de contrôler les divers trafics de la région. Dans ce nouveau volume, Les Griffes du silence, Emelie Schepp convie ses personnages habituels, à commencer par la policière Mia Bolander et son assistant Patrik Wiking, et surtout la procureure Jana Berzelius, pour tenter de faire avancer l’enquête. Mais Jana n’est pas neutre. Les trois dealers ont tenté de la violer, c’est elle qui les a tués. Son père adoptif, Karl Berzelius, magistrat à la retraite, l’a deviné. Danilo Peña, son frère, va être libéré de prison et revenir la harceler. Comment vivre sereinement sa nouvelle relation avec l’avocat Per Åström ? Comme les précédents volumes de la série, Les Griffes du silence est plutôt agréable à lire mais que de situations saugrenues, que d’invraisemblances ! Difficile de voir là « une plongée terrifiante au cœur des gangs suédois », comme l’indique le bandeau sur la couverture. Nous sommes surtout chez les petits voyous de banlieue, trafiquants en tout genre, sans envergure, assassins à l’occasion pour protéger leurs intérêts. Et Jana Berzelius n’est pas un instant crédible, à présent « rongée par la culpabilité » d’avoir envoyé un innocent en prison à sa place et poursuivie par les soupçons de Henrik, un policier qui pense avoir compris le rôle qui a été le sien. Elle perd pied, hésite. « Beaucoup d’éléments de ce livre sont réels », écrit Emelie Schepp dans ses « remerciements », « mais j’ai aussi ajouté une bonne dose de fiction pour mieux coller au récit ». On s’en doute un petit peu.
* Emelie Schepp, Les Griffes du silence (Nio liv, 2020), trad. Rémi Cassaigne, HarperCollins (Noir), 2022
Ne réveille pas l’ours qui dort
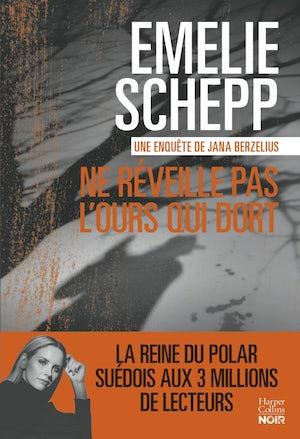
On ne peut pas reprocher à Emelie Schepp de proposer des histoires sans lien avec la réalité. « Norrköping connaissait ces dernières années une escalade de la violence de plus en plus aveugle.. » La Suède est en proie à une guerre des gangs et ses romans en tiennent compte. Mais dans Ne réveille pas l’ours qui dort, septième volume de la série centrée sur le personnages de Jana Berzelius, la criminalité s’exerce jusque dans les plus petites communes. Un homme, ancien policier, est retrouvé assassiné dans sa maison isolée au milieu de la forêt, un nounours en peluche enfoui dans l’estomac. Apparemment, l’une de ses collègues, qui vit à présent sous « identité protégée », est également visée, peut-être pour avoir autrefois enquêté sur un trafic d’être humains dirigé par le sinistre Serkar. La procureure Jana s’efforce, elle, de vivre pour le mieux sa relation amoureuse avec Per, ne lui révélant que des bribes de sa vie antérieure. « Elle n’était en rien coupable de ce qui s’était passé, et l’organisation était depuis longtemps démantelée. Mais il était impossible de raconter à Per qu’elle avait jadis été entraînée à tuer, qu’elle avait effectivement tué, et que les réflexes et l’instinct demeuraient en elle, même après toutes ces années. » Cette série n’est absolument pas crédible et pourtant, les faits s’enchaînent, les personnages prennent leur place. Au final, un bon divertissement.
* Emelie Schepp, Ne réveille pas l’ours qui dort (Björnen sover, 2022), trad. du suédois Rémi Cassaigne, HarperCollins (Noir), 2023
Délivrez-nous du mal
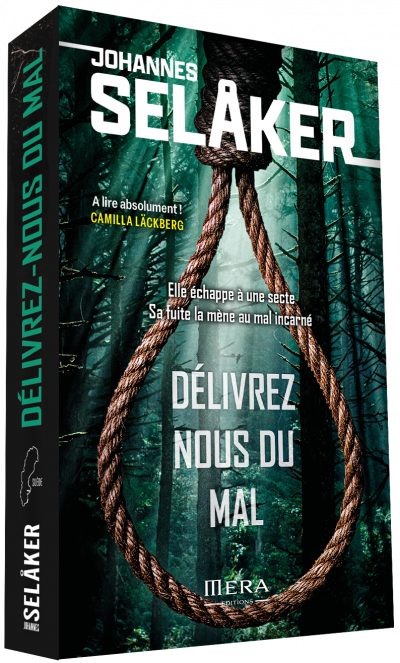
Que de notes de bas de page, dans ce roman de Johannes Selåker, Délivrez-nous du mal ! Quelques-unes utiles, mais beaucoup superfétatoires – le tout aurait pu être relégué en fin de volume. Et que de réflexions au cours du récit qui ne peuvent qu’interloquer : comme, page 34, ce portrait de Greta Thunberg « dont le message était aussi profond qu’un biscuit de fortune » ! (On croirait entendre Trump se moquer de l’adolescente !) Ou, page 311, « Selma propulsa la voiture de location à cent kilomètres heure sur l’autoroute entre Umeå et Vindeln » : on peut se dire que « cent kilomètres heure » ce n’est pas énorme pour une voiture « propulsée » sur une autoroute, sauf que la partie autoroute sur ce trajet de l’E12 est court... ! Ou, page 52, la puanteur comme « l’odeur d’un relais routier bosniaque » ! L’héroïne, Selma Halilovic, est certes présentée comme d’origine bosniaque, mais cela l’autorise-t-il à prononcer n’importe quelle ineptie ? Celle-ci, journaliste free-lance, enquête sur un groupe de féministes radicales qui aurait causé l’accident d’un bus dans la région de Vindeln, au nord de Umeå. Mais bientôt, d’autres pistes sont envisagée : « Les sabotages étaient devenus plus audacieux, et il ne s’agissait plus de dénoncer l’hypocrisie de l’église, ou l’injustice qui régnait au sein de la petite ville. » Né en 1987, journaliste et auteur de romans policiers, Johannes Selåker a déjà signé des best-sellers. Il relate ici l’emprise d’un homme d’église et de son groupe sur une adolescente – on peut penser aux romans de Åsa Larsson à Kiruna ou à d’autres, le sujet a été largement traité. Le ton est rapide, rien ne tient debout dans ce roman policier sans quasiment de policiers, ce n’est pas grave, le lecteur acquiesce – ou pas.
* Johannes Selåker, Délivrez-nous du mal (Fräls oss från ondo, 2023), trad. du suédois Mara Bergsson, Mera, 2024
La Fille dans les serres de l’aigle

En dépit des critiques qui avaient accompagné leurs parutions (notamment à propos de leur traduction effectuée à la va-vite), les trois premiers volumes de la saga policière Millénium, signés Stieg Larsson, étaient bien construits et de bonne qualité. Le quatrième, signé David Lagercrantz, avait étonné, tellement il s’inscrivait bien dans leur univers. Les cinquième et sixième volumes, toujours de Lagercrantz, décevaient quelque peu. Voici qu’un septième volume signé à présent Karine Smirnoff est proposé aux lecteurs. Aïe ! Karin Smirnoff est ici connue pour son roman Mon frère, présenté comme le premier tome de La Trilogie de Jana. Un titre plutôt séduisant (cf. critique sur ce site). Mais La Fille dans les serres de l’aigle est un roman plutôt déconcertant. Non pas parce qu’il surprend, mais au contraire parce qu’il reprend nombre de codes du roman policier habituel sans rien proposer de bien nouveau. Bien sûr, les volumes de Stieg Larsson jouaient déjà avec les rebondissements et les fausses pistes, les invraisemblances et les descriptions ultra-crédibles. Mais ici, tout cela se cumule. À Gasskas, une petite ville minière du Norrland, pas très loin de Jokkmokk, un projet de gigantesque parc éolien, « le plus grand d’Europe », permettant de produire une électricité à bas coût attise la convoitise de plusieurs groupes maffieux. Comme par hasard, c’est là que Pernilla, la fille de Mikael Blomkvist, dont il n’a jamais eu le temps de s’occuper, va se marier avec le principal adjoint à la mairie chargé de la réalisation du projet. Et là aussi que Lisbeth Salander, dans le même temps, doit récupérer la garde de sa nièce de treize ans, gamine apparemment dotée d’un très haut potentiel intellectuel, et dont elle a tué le père, un affreux truand. Les vilains maffieux et les successeurs des « enfoirés de motards » du MC Svavelsjö déjà actifs dans les premiers volumes s’allient pour imposer leur loi. Les violences faites aux femmes sont un des ressorts du livre, avec la question écologique et la corruption de certains élus, sans oublier l’extrême droite – un livre de Stieg Larsson et de Mikael Ekman (tous deux écrivaient dans Expo, qui a servi de modèle au magazine Millénium), Les Démocrates suédois, le mouvement national, est ainsi cité. De bonnes causes, mais déjà plus qu’abondamment traitées dans la littérature suédoise et ailleurs ! Sans révéler l’intrigue, relevons que le vieillissant Mikael Blomkvist entre à la rédaction du poussif Gaskassen, le quotidien local, maintenant que Millénium n’est plus accessible que sur le Net, et que Lisbeth Salander joue avec une relative assurance la tata poule. Notons, page 208, que l’écrivaine et sexologue Katerina Janouch, bien réelle, est présentée en aparté comme une « sacrée femme », « très sous-estimée dans le débat public suédois », alors qu’elle se prononce régulièrement contre la politique migratoire de la Suède (pourquoi pas, il y a un réel problème) sur des médias... d’extrême droite : Stieg, pourquoi tu tousses ?
* Karin Smirnoff, La Fille dans les serres de l’aigle (Millénium 7) (Havsörnens skrik, 2022), trad. du suédois Hege Roel-Rousson, Actes sud (Actes noirs), 2023
La Fille dans les griffes du lynx
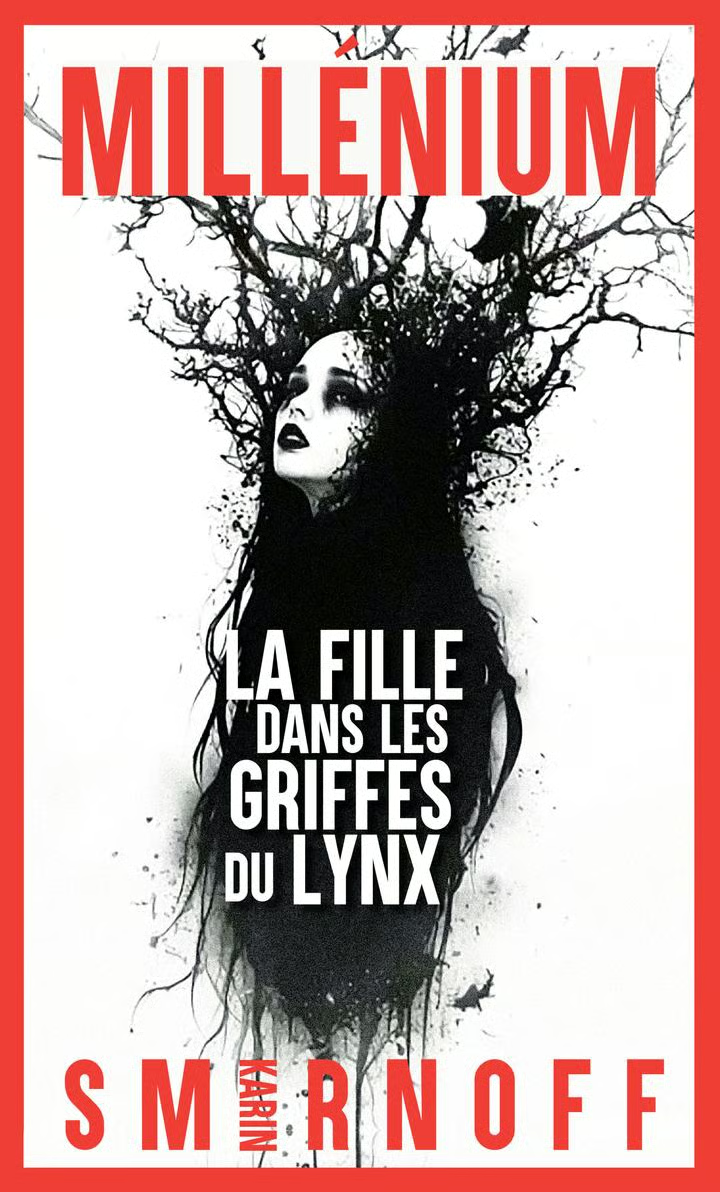
Le septième volume de Millénium, série écrite à présent par Karin Smirnoff (après Stieg Larsson, puis David Lagercrantz), nous avait laissé pour le moins sceptique. Qu’en est-il du huitième, La Fille dans les griffes du lynx ? Eh bien... disons que nous avons rarement lu un roman aussi barbant ! Comme précédemment, nous retrouvons Lisbeth Salander, sauf que là, mal en point, elle crache « des glaires visqueuses » au moment de répondre au téléphone à Plague, « son bon vieux pote hacker », « une créature de l’ombre terrée dans sa grotte ». Que lui veut-il ? Simplement prendre de ses nouvelles ? Lisbeth n’est plus aujourd’hui « qu’une façade : solide comme un blindé, et un visage presque dépourvu d’expression ». On lui a connu des jours meilleurs. Il est vrai que la période n’est pas des plus joyeuses : « Le monde est ravagé par les guerres, les catastrophes naturelles et les Démocrates suédois mais, l’espace d’un instant la vie est parfaite. » L’action continue de prendre la région fictive de Gasskas, quelque part vers Gällivare, pour cadre. Le corps d’une femme est retrouvé, un SDF est assassiné. Puis Lisbeth constate la disparition de Plague. Tout est long à démarrer, Mikael Blomkvist, rédacteur en chef du journal local, se traîne, il est à présent un vieil homme. Son cancer de la prostate suscite l’humour sarcastique de Lisbeth. Ou plutôt, de l’auteure, qui lâche par ailleurs une pique contre sa collègue Camilla Läckberg. Ainsi, une réflexion pertinente n’est « pas du Läckberg ». Par exemple : « Coucher avec l’ennemi est un thème récurrent dans la vie de Lisbeth. Quoi qu’on en dise, c’est bien plus simple que de coucher avec des amis. » Le caractère froid de Lisbeth évolue, elle est gagnée au fil de ses rencontres par une empathie qui la désarçonne : lors d’un enterrement elle ressent « quelque chose d’émouvant qu’elle n’arrive pas à saisir » Mais elle aussi est dépassée : « Tante Lisbeth. Ton mascara a coulé... » Que les personnages s’émancipent de leur créateur Stieg Larsson, pourquoi pas, mais l’intrigue perd sa crédibilité même si celle-ci, depuis le premier volume, reposait sur beaucoup de connivence de la part du lecteur. Rien ne tient, ici, difficile d’adhérer. Il faut bien du courage pour tourner les pages et l’on se dit que la série, si elle demeure confiée à Karin Smirnoff, peut bien s’arrêter là, les amateurs de Millénium ne s’en plaindront pas.
* Karin Smirnoff, La Fille dans les griffes du lynx (Millénium 8) (Lokkatens klor, 2024), trad. du suédois Hege Roel-Rousson, Actes sud (Actes noirs), 2025
Dictionnaire Sjöwall et Wahlöö
L’idée était intéressante : consacrer une étude, sous forme de dictionnaire comme il existe des Dictionnaire amoureux de..., aux parents du roman policier nordique, les Suédois Maj Sjöwall et Per Wahlöö. De Roseanna à Les Terroristes, les dix volumes qui composent le Roman d’un crime ne sont pas que de très bons romans policiers (un crime, une énigme, une enquête). Contextualisés, ils révèlent beaucoup de choses sur la société suédoise des années 1960-1970. Mais ce Dictionnaire Sjöwall et Wahlöö est loin de remplir ce qui aurait pu être son objectif, et se contente de délivrer quelques anecdotes à partir de mots-clés. D’un point de vue formel, regrettons, déjà, que l’on ne sache pas qui s’exprime dans les « quelque 500 articles », l’utilisation de deux polices de caractères ou des italiques aurait été pratique. Souvent, l’auteur donne une explication, puis suivent des extraits de tel ou tel roman (dont le titre est rarement précisé) : qui parle ? La rigueur attendue d’un dictionnaire est ici absente. Passons sur les manques (la prise d’otages de la RAF à l’ambassade américaine de Stockholm en 1975 ; la figure du diplomate et secrétaire général des Nations unies Dag Hammarskjöld évoquée en quatre lignes, alors que sa mort est à elle seule une véritable affaire d’espionnage ; l’île de Ven, où s’était retirée Maj Sjöwall, mentionnée sans citer le nom de son habitant le plus illustre, l’astronome Tycho Brahe ; l’enquête de Stieg Larsson sur le meurtre d’Olof Palme passée aux oubliettes – cf. Jan Stocklassa, La Folle enquête de Stieg Larsson, Flammarion, 2019 ; comme le roman de Kurt Salomonson disponible en français, Les Grottes, Plein chant, 1987 ; et ces affirmations discutables, ici ou là (« Il y aurait eu des traductions dans 40 langues et 30 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Les contrats, vieux de 50 ans, n’ont pas été mis à jour : pas de quoi, donc, d’enrichir (sic) une Maj Sjöwall qui préfère largement, de toute façon, être libre. » Quel rapport ?) Des mots, noms propres et noms communs, prélevés dans les dix volumes du Roman d’un crime, une très brève anecdote autour, une citation... À part Maria Lang, expédiée en quatre lignes et demi, aucune mention de Olov Svedelid ni de Stieg Trenter ou de Olle Högstrand, pourtant de grands prédécesseurs de Sjöwal-Wahlöö, traduits en français qui plus est. En bref, ce Dictionnaire nous semble passer, hélas, à côté de ce qui aurait pu être son objectif, montrer en quoi l’œuvre du couple de Suédois s’inscrit avec force et originalité tant dans la littérature de son pays, que dans le genre du roman policier.
* Yann Liotard, Dictionnaire Sjöwall et Wahlöö, L’Harmattan (Sang maudit), 2020
Se taire à jamais
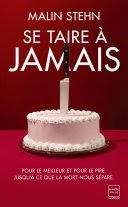
« ...Il faut être naïf pour croire qu’on peut contrôler sa destinée. La vie fait tout ce qu’elle veut, et pour celui ou celle qui chercherait à tout planifier, c’est la déception assurée. » Plutôt décevant, ce roman de Malin Stehn (née en 1969), Se taire à jamais. En gros, une énième version d’un quasi huis-clos familial, guère si éloignée du film Festen de Thomas Vinterberg. Pourtant, l’idée de départ, les conséquences d’un acte qui dépasse complètement ses protagonistes, n’était pas mauvaise. William et Erik, deux jeunes hommes, amis et néanmoins rivaux dans leur équipe de foot, sont victimes de ce qui ressemble à un accident de la circulation. Version officielle. Si le premier est légèrement blessé, le second se retrouve en fauteuil roulant. Un procès tente de répartir les responsabilités mais les non-dits prospèrent. Les faits ne se sont manifestement pas déroulés comme ils l’affirment. Pourtant, huit ans plus tard, Emily, la sœur d’Erik, épouse William. Lors de la fête dans le parc d’un château, la tension monte, la rancœur dégénère. Erik meurt. Un accident, un suicide, un crime ? La réponse vient bien sûr en son temps, de manière très classique.
* Malin Stehn, Se taire à jamais (Lycka till, 2023), trad. du suédois Élodie Coello, Hauteville (Suspense, poche), 2025
Sa dernière nuit
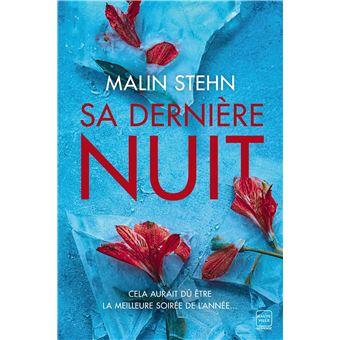
31 décembre 2019, Fredrik, Nina Andersson et leurs deux jeunes garçons s’en vont passer le réveillon chez des amis, Max et Lollo Wiksell, tandis que dans leur maison leur fille Smilla, une adolescente, se prépare à recevoir ses amis. Sa soi-disant meilleure copine, la jeune Jennifer, fille du couple Wiksell, boit beaucoup, s’ennuie et décide de rentrer chez elle. Elle ne réapparaîtra plus. Que s’est-il passé ? « ...Je suis en panique et m’attends à recevoir un coup de fil de la police à tout moment. Ou à voir passer un bulletin d’information spécial sur la disparition d’une jeune fille de dix-sept ans », s’inquiète Fredrik, qui menait une liaison ambiguë avec elle. Un doute plane sur lui. Qu’a-t-il fait exactement ? Les premiers chapitres sont assez exténuants, avec des personnages bardés de leurs certitudes et fort peu sympathiques, mais rapidement tout se met en place et le roman est un turn-over efficace. Le principal suspect est remplacé par d’autres et dans cette affaire, la culpabilité finit par concerner tous les membres de ce panier de crabes. Mensonges, trahisons... Leur amitié qui ne repose pas sur grand-chose résistera-t-elle ? Signé Malin Stehn (née en 1969 en Suède, éditrice, puis auteure de romans pour la jeunesse), Sa dernière nuit est un roman bien ficelé.
* Malin Stehn, Sa dernière nuit (Ettt gott nytt år, 2021), trad. du suédois Élodie Coello, Hauteville (Suspense), 2023
Le Manoir des glaces
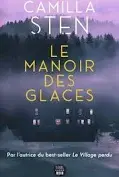
Le Manoir des glaces : c’est un roman somme toute bien classique que nous propose là Camilla Sten, qui a signé auparavant des ouvrages plutôt pour adolescents. Un huis-clos censé être effrayant d’un bout à l’autre, une histoire d’héritage maléfique sans grand intérêt, sinon de se laisser emporter par l’intrigue et la narration rapide. Eleanor arrive d’abord chez sa grand-mère, Vivianne, dans un quartier chic de Stockholm, alors que son meurtrier s’enfuit. Atteinte de prosopagnosie (elle reconnaît difficilement les visages), elle ne peut l’identifier. Elle apprend peu après que Vivianne lègue à ses descendants un manoir, à cent cinquante kilomètres au nord de la capitale. Elle s’y rend avec Sebastian, son petit ami, et y retrouve sa tante Veronika et un homme qui prétend être l’avocat de la famille. Au fil des pages, l’ambiance se détériore. Inhabité depuis quarante ans, le manoir serait-il hanté ? « J’ai l’impression que la maison est vivante. » Vivianne aurait-elle été la meurtrière de son mari ? « Vivianne, ma grand-mère, la seule personne qui m’aimait, la seule qui s’est occupée de moi. » Mais qui est vraiment qui ? Eleanor n’est-elle pas appelée Victoria par certains de ses proches ? Cette Vivianne, que sait-on à son propos ? Quant à ce prétendu avocat, pourquoi est-il là, en réalité ? Les pistes abondent, se croisent, jusqu’au dénouement, assez compliqué avec ses diverses usurpations d’identités... Pourquoi pas ?
* Camilla Sten, Le Manoir des glaces (Arvtagaren, 2020), trad. du suédois Anna Postel, Seuil (Cadre noir), 2023
Le Village perdu
« Je ferai ce film coûte que coûte », se dit Alice en arrivant à Silvertjärn, « le lac d’argent », avec une équipe de tournage, deux femmes et deux hommes aussi jeunes qu’elle. Silvertjärn : hier cité minière, dont la population a brusquement et mystérieusement disparu. « ...Comme si chacun des huit cent quatre-vingt-sept habitants (…) était parti en fumée. Les portes étaient ouvertes. Les fenêtres entrouvertes. La rivière coulait paisiblement vers le lac. Et la ville était déserte. » Camilla Sten (née en 1992) est la fille de Viveca Sten (Meurtre à Sandhamn...), avec qui elle a écrit une trilogie, L’Île des disparus, de bonne facture. Le Village perdu prend la Suède des lacs et des forêts pour cadre, quelque part dans la région de Sundsvall. L’ambiance est lourde, plus proche du fantastique que du polar. On n’est pas loin de la série télévisée Jordskött, avec le passé et le présent qui se mêlent sur fond de délire sectaire ; ou des romans de Åsa Larsson, dans les congrégations religieuses de Kiruna. Un roman pour se détendre, Le Village perdu, et pour avoir peur en même temps – sous l’influence donc de John Ajvide Lindqvist ou de Stephen King.
* Camilla Sten, Le Village perdu (Staden, 2019), trad. Anna Postel, Seuil (Thriller), 2020
Pistes noires
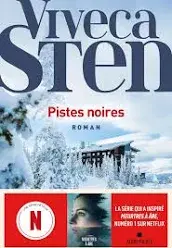
Ils sont six, Olivia et Fanny, meilleures amies, et Wille, Amir, Pontus et Emil, tous étudiants à Uppsala. Ils vont passer une semaines de vacances à la montagne, à Åre, dans la superbe maison que possèdent les parents de Wille, partis à l’étranger. Ils feront du ski. Mais l’ambiance est très vite pesante, renforcée par l’alcool à haute dose et la cocaïne. Quand Fanny est retrouvée morte, allongée dans la neige, devant le chalet, tous peuvent faire office de coupables. « Se pourrait-il que ces étudiants si propres sur eux soient mouillés dans la mort de leur amie ? » C’est la question que se pose le policier Daniel Lindskog, bientôt rejoint par sa collègue Hanna Ahlander. « Une jeune étudiante partie avec un groupe d’amis pour une semaine de ski retrouvée en sous-vêtements dans la neige le lendemain d’une soirée particulièrement arrosée. » Pour faire durer le suspens, les divers protagonistes vivent leur vie, Daniel à présent célibataire et père, la moitié du temps, de la petite Alice, et Hanna, embarquée dans un voyage de noce et d’anniversaire en Laponie avec Henry, son richissime prétendant. Lequel, parmi les cinq étudiants, pourrait avoir causé la mort de Fanny ? Tous ne possèdent-ils pas des motifs ? À la différence d’autres enquêteurs de romans policiers, ceux de Viveca Sten mènent ici l’enquête à l’envers : longtemps, les pistes ne convergent pas, au contraire chaque élément nouveau provoque l’apparition de nouvelles possibilités pour expliquer les faits. Remarquons aussi le ton de cette série adaptée sur Netflix, avec des personnages issus de diverses minorités mis en avant. C’est bien amené, l’auteure retombe à peu près sur ses pieds et c’est un tout petit peu plus profond que ses titres prenant l’archipel de Stockholm pour cadre.
* Viveca Sten, Pistes noires (Vilseledaren, 2023), trad. du suédois Amanda Postel et Anna Postel, Albin Michel, 2025
Chambre 505
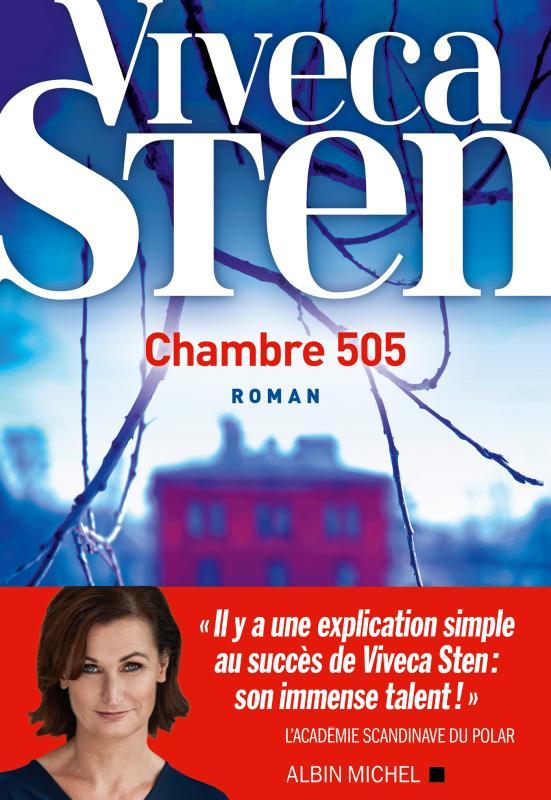
Certes, Viveca Sten sait raconter une histoire. Mais ce nouveau roman, Chambre 505 (après Une Écharpe dans la neige et Les Ombres de la vallée) est du déjà lu et relu. Ne dévoilons pas la précieuse intrigue, révélons juste ce que le lecteur comprend très vite : à la fin du siècle dernier, une pauvre jeune femme travaillant dans un hôtel est victime d’un client qui la viole et ne reconnaît pas l’enfant dont il est le père. S’ensuit une sinistre vengeance, avec comme toile de fond un luxueux projet immobilier à deux pas de la frontière norvégienne et la corruption d’un édile municipal. « Charlotte Wretlind a été poignardée plusieurs dizaines de fois, sur l’ensemble du corps. Le coup porté au niveau du cou était suffisant pour la tuer. » Comme il se doit et en dépit de propos féministes au long des pages, la victime est une femme et l’hémoglobine coule à flots. Hanna Ahlander et Daniel Lindskog, policiers du commissariat de Östersund détachés à Àre, vont enquêter tambour battant. De quelle nature sont les sentiments entre eux ? Ils s’attirent, ils s’ignorent – entameront-ils une relation ? Le suspens est grand et la réponse viendra sans doute dans un futur volume. En attendant, difficile de s’ennuyer avec Chambre 505, en dépit d’une intrigue déjà utilisée ces derniers temps dans d’autres polars (et nous nous en tenons aux pays nordiques) et de tournures qui pourraient figurer ailleurs : « Un homme prêt à tuer pour sauver sa peau », « ...Quelqu’un devait payer pour le crime de... » Faute de mieux... !
* Viveca Sten, Chambre 505 (Botgöraren, 2022), trad. du suédois Amanda Postel et Anna Postel, Albin Michel, 2024
Une Écharpe dans la neige
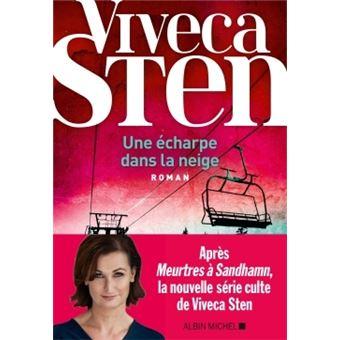
Après la série Meurtres à Sandhamn, romans policiers prenant l’archipel de Stockholm pour cadre, Viveca Sten entraîne ses lecteurs dans le Jämtland, plus précisément à Åre, où elle séjournait pendant la crise du Covid 19 et son confinement. La policière Hanna Ahlander, qui a mis en cause l’un de ses collègues de Stockholm coupable de violences sur son épouse (« Je bossais sur les violences intrafamiliales, ce genre de saloperies », explique-t-elle à ses nouveaux collègues) vient d’être mutée dans cette célèbre station de ski à peu de distance de la frontière norvégienne et va travailler avec l’inspecteur Daniel Lindskog. À peine s’est-elle installée dans la maison vide que sa sœur aînée, en déplacement, lui prête, qu’un cadavre est découvert sur un télésiège, celui d’Amanda, une jeune fille de dix-huit ans. Qui pouvait lui en vouloir ? Son ex-petit ami ou un adulte ? « ...Tout devient difficile à piloter quand le lieu du crime se trouve à Åre, la direction à Östersund et le central régional de communication à Umeå. » Les différents couples de ce roman sont tous mal en point : Hannah et Christian se sont séparés, c’est aussi pourquoi elle séjourne à Åre ; Daniel et Ida se querellent, elle ne supporte plus son emploi du temps si exigeant ; tout s’écroule dans la vie de Harald et Lena, les parents d’Amanda... Plusieurs pistes se chevauchent, mêlant diverses problématiques d’aujourd’hui : pédophilie, travail au noir, immigration... Viveca Sten est plus convaincante dans ce roman, où tout est moins nunuche et moins friqué, que dans ses précédents. (Difficile cependant de ne pas penser à l’écrivaine Aino Trosell, qui, il y a quelques années, a déjà balisé le terrain avec ses romans policiers prenant une femme de chambre pour enquêtrice à Åre.) Agréable divertissement.
* Viveca Sten, Une Écharpe dans la neige (Offermakaren, 2020), trad. Rémi Cassaigne, Albin Michel, 2022
Sous protection
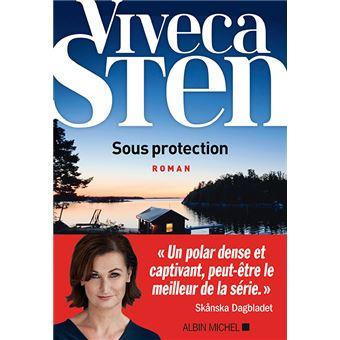
Pas de crime à proprement parler pendant une bonne partie du dernier roman de Viveca Sten, Sous protection, mais une femme, Mina, frappée par son compagnon. Une femme qui ne se résout pas à quitter ce salopard, par ailleurs trafiquant de drogue notoire, alors qu’elle n’a guère d’espoir de le voir se repentir. La police, représentée par Thomas Andreasson, et la justice par Nora Linde, procureure, s’efforcent pourtant de la convaincre de porter plainte contre lui, seule façon de l’empêcher de nuire. Lorsque Mina trouve une place dans un foyer, la situation se dégrade. Sous protection (le titre est parlant) tourne beaucoup moins autour de Nora et de Thomas (coucheront-ils un jour ensemble ? Ah, quel suspens !) que les volumes précédents de Viveca Sten et c’est tant mieux. L’ouvrage pose des questions de fond sur l’évolution de la société et des remarques à la Mankell sont prononcées : « La Suède avait changé de fond en comble ces dix dernières années. » L’ouverture des frontières a provoqué l’afflux de migrants qui ont été victimes de violences et qui les reproduisent ici, mettant en place « un monde où les représailles étaient la norme, la vie humaine une marchandise et où le trafic de drogue avait lieu en pleine rue ». Sous protection montre aussi les difficultés à rompre avec un homme dont la violence n’est que l’une des facettes. « Elle l’aimait tant, comment ignorer ses excuses et le quitter ? » Plutôt nunuche au début, la série « Sandhamn » de Viveca Sten s’améliore de volume en volume et celui-ci, le neuvième, se laisse lire avec plaisir.
* Viveca Sten, Sous protection (I fel sällskap, 2018), trad. Rémi Cassaigne, Albin Michel, 2021
Au nom de la vérité
« Curieux hasard que leurs chemins se croisent ainsi. » Oh, oui, des hasards et des coïncidences, les romans de Viveca Sten en sont remplis. Dans celui-ci, Au nom de la vérité (quel titre grandiloquent, pour une enquête qui s’inscrit dans la série prenant l’île de Sandamn pour cadre, avec ces deux nunuches, Nora et Thomas, pour héros récurrents), il fait encore une fois bien les choses, puisqu’il va permettre à deux récits parallèles de se rejoindre. « ...Il y avait parfois dans les enquêtes criminelles des coïncidences auxquelles on ne croirait jamais si on les trouvait dans un roman. » Et c’est ainsi. Benjamin, un jeune garçon en colonie sur l’île, pour apprendre à faire de la voile, disparaît au moment de la Saint-Jean (journée cruciale dans l’œuvre de l’écrivaine). Dans le même temps, son père passe en procès pour une affaire de détournement d’argent dans sa société. La procureure n’est autre que Nora Linde. Benjamin aurait-il fait une fugue ? Été victime d’un pédophile repéré sur les lieux ? Enlevé à cause des manigances de son père ? Quel suspens ! Le livre (quasiment 500 pages) est plaisant à lire, tout s’enchaîne bien.
* Viveca Sten, Au nom de la vérité (I sanningens namn, 2015), trad. Rémi Cassaigne, Albin Michel, 2020
Mauvaise graine
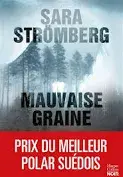
Vera Bergström exerce aujourd’hui la profession d’enseignante dans une petite commune à l’ouest de Östersund lorsque son ancien employeur la contacte. Un crime a eu lieu près de Åre (sur la E14, la célèbre station de ski). L’ex-journaliste du Jämtlandposten pourrait-elle reprendre du service ? Elle hésite et bien sûr accepte. Revenir à son métier d’autrefois et cogiter tout son soûl la stimulerait plus qu’un poste d’enseignante rivée à son programme dans un lycée. La jeune femme tuée semble avoir eu deux identités et plutôt mauvaise réputation. « La sanction et la culpabilité étaient deux choses bien différentes. Pendant combien de temps une personne devait-elle purger une faute ? » Écrire un article à son sujet alors que la polie piétine serait un bon tremplin pour le retour de Vera, vivement incitée à cela par Nils « Strömmen » Strömqvist, rédacteur en chef « mû par une soif de revanche contre presque tout dans la société. Le pire, à ses yeux, étaient ceux qui profitaient de leur position de dirigeant pour s’asseoir sur la vérité. » Divorcée, la cinquantaine bien entamée, sans enfant, sans véritable ami-e (sinon ce Thomas qui veille sur elle et qui, un jour peut-être...), Vera n’espère pas grand-chose de l’avenir. Signé Sara Strömberg (née en 1975), Mauvaise graine est un roman qui peut évoquer ceux de Lina Bengsdotter, avec une enquêtrice revenant sur les lieux de son enfance (plus au sud, pour Lina Bengsdotter, puisque situés à Gullspång). Pas follement original mais les personnages sont bien dessinés et le contexte actuel bien mis en valeur ne peut que parler aux lecteurs. Un deuxième volume a d’ores et déjà été publié en Suède et une série devrait suivre.
* Sara Strömberg, Mauvaise graine (Sly, 2021), trad. du suédois Anne Karila, HarperCollins (Noir), 2024
Terrain glissant

« Un hurlement abyssal poussé par la terre elle-même. De gros blocs d’argile se détachèrent et commencèrent à glisser, des canalisations et des câbles électriques furent expulsés du sol. (...) On aurait dit que Dieu balayait quelques miettes du revers de la main. » À Åre, un affaissement de terrain provoque le blocage de la route principale. En cause ? Sans doute les travaux de construction de nouvelles villas, un projet qui associe entrepreneur et politiciens véreux. Autrement dit, « le profiteur lui-même, Leif Tronde, à côté du maire social-démocrate Morgan Brodin. » Comme dans le volume précédent, Mauvaise graine, Vera Bergström tente d’en savoir plus. La journaliste du Jämtlandsposten relie l’événement à la disparition plus d’un an auparavant de Jonte Andersson, un éleveur de moutons par ailleurs DJ dans une boîte de nuit. « J’étais sur la bonne piste », se convainc-t-elle vite. À la frontière près de la Norvège, Åre voit sa population changer, la configuration de la petite ville en est affectée. « Ces messieurs-dames de la noblesse suédoise et de l’élite du show-biz m’avaient appelée plusieurs fois pour me soumettre leurs récriminations... » La montagne environnante est défigurée mais puisque cela se fait au nom de l’activité économique et de l’emploi...! Et que Leif Tronde, « un homme si charmant (...), le modèle du gendre idéal », se trouve aux commandes. Ne cherche-t-il pas leur bien à tous, comme il ne cesse de le déclarer ? Le lecteur doit attendre la moitié de l’ouvrage ou presque pour qu’enfin des pistes se profilent, fausses évidemment. Une silhouette apparaît, puis une main, un mouton est tué... Palpitant ? C’est poussif. Les personnages ne sont pas exaltants, l’action est minime, rien ne donne envie de tourner les pages. Quand le lecteur tombe (p. 448) sur cette petite phrase, « J’imagine qu’il pourrait difficilement passer la douane s’il est recherché par la police norvégienne », l’incompréhension surgit. La douane, entre la Suède et la Norvège, aujourd’hui et au niveau de Åre ? Prix du meilleur roman policier suédois, comme indiqué, vraiment ?
* Sara Strömberg, Terrain glissant (Skred, 2022), trad. du suédois Anne Karila, HarperCollins, 2025
Une vie de poupée
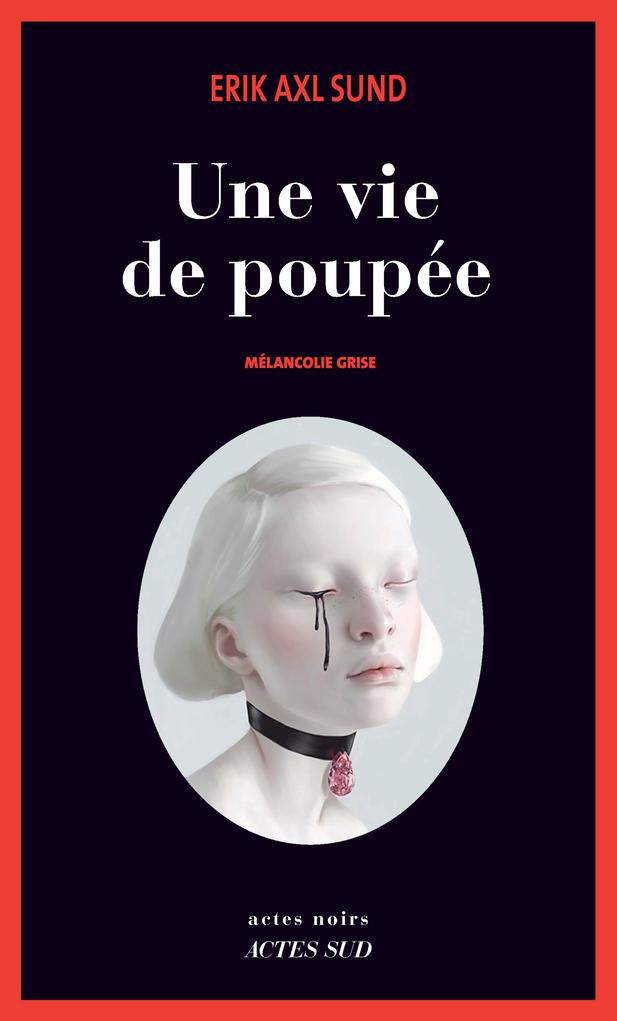
Il y a des romans policiers bien conçus, sans doute emplis de bons sentiments, mais qui peuvent insupporter le lecteur, tant un aspect glauque ou de voyeurisme s’en dégage. Une Vie de poupée de Erik Axl Sund est de ceux-là. Si nous comprenons bien les intentions du duo d’auteurs derrière ce pseudo (Jerker Eriksson, né en 1974, et Håkon Axlander Sundquist, né en 1965), les trafics d’êtres humains, et notamment de femmes contraintes de se prostituer, sont abjects. L’enquête menée à partir du suicide – ou de la mise en scène du suicide – d’une jeune fille le démontre. « L’homme qu’elle a devant elle est l’un des trois violeurs de Boko Haram, il est un médecin qui leur a volé leur maison, il est un Turc qui vendait d’inutiles gilets de sauvetage, tous les racistes qui leur ont craché dessus avec des insultes innommables, tous les gros types qui brisent les bras des fillettes et baisent des bouches de fillettes, et il est ces vieilles qui raflent l’argent pour elles, il est ces hommes qui tuent des chats. L’homme devant elle est tout ça à la fois rassemblé dans un seul corps. » Le policier qui remonte les pistes se nomme Kevin Jonsson, il conduit un vélomoteur, un Vespa, quand il n’emprunte pas un véhicule de fonction, et habite dans un cabanon de jardin – à l’année, en dépit du règlement. Électron libre au sein du commissariat de Kronoberg, il découvre que son propre père aurait peut-être été l’un des pédophiles violeurs mis en cause dans son enquête. Malaise ! Un roman sans originalité, il y a en tant sur ces thèmes, traité sans non plus de surprise. Les Corps de verre, le premier volume de cette série, Mélancolie, nous avait laissé sceptique. Celui-ci ne nous inspire pas plus.
* Erik Axl Sund, Une Vie de poupée (Dockliv, 2014), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noirs), 2021
Saison morte (Mélancolie blanche)
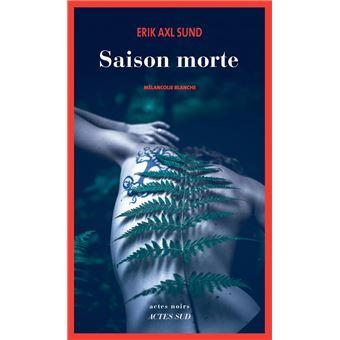
« Mon avis général est que le garçon a été battu pendant toute son enfance et que la violence physique contre son crâne est un facteur qui participe fortement au fonctionnement défaillant de son hippocampe. » Ainsi s’interroge un médecin policier après avoir observé Gaspard Hauser, un jeune homme pris d’abord pour une fille, arrêté à Stockholm et surnommé, faute d’identité vérifiable, du nom de son illustre prédécesseur. La vérité qui va émerger interroge sur la pratique de certains... écrivains, prêts à tout pour parvenir à conjuguer réalité et fiction. « La vision du monde qu’il s’était créée était inébranlable. Omnipotent, tyrannique et narcissique étaient les mots qui venaient spontanément à l’esprit de Jeanette. » Suède, de nos jours. Les incendies de forêts qui ont ravagé une partie du pays en 2018 sont encore dans toutes les mémoires. L’enquête menée par Jeanette Kihlberg et son équipe rompt avec la routine et l’entraîne jusqu’aux zones les plus désertes du pays, notamment dans le Härjedalen près de la frontière norvégienne. Avec Saison morte (Mélancolie blanche), le duo d’auteurs qui signent cette série (Jerker Eriksson, né en 1974, et Håkon Axlander Sundquist, né en 1965) plongent dans l’histoire relativement récente (la fin du XIXe siècle) de la Suède (relevons p. 57 une allusion à l’écrivain Stig Dagerman). Différentes raisons expliquent les liens que le présent entretient avec le passé, notamment le changement de sexe de l’un et de l’autre des personnages. Saison morte est un bon polar, peut-être un peu embrouillé dans les premières pages mais l’intrigue retombe vite sur ses pieds – faute d’être crédible : ah, tous ces psychopathes qui hantent jusqu’au monde de la culture !
* Erik Axl Sund, Saison morte (Mélancolie blanche) (Otid. Vit melankoli, 2022), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noirs), 2023
Victimes

Un corps est découvert dans une grange près de l’E18, à proximité de Rimbo, au nord de Stockholm. Carl Edson, commissaire de la police criminelle, se prépare à ouvrir une enquête pour meurtre, mais voilà que le corps n’est pas mort. Transféré à l’hôpital, l’homme est très gravement blessé. Il a été atrocement torturé. Pus il décède sans avoir pu parler. À la tête d’une petite équipe de policiers, Carl Edson « allait sur ses cinquante-et-un ans. (…) Il avait exercé le métier de policier pendant près de la moitié de sa vie, et au cours de cette carrière il avait quasiment tout vu. Sa fille âgée de seize ans le qualifiait régulièrement de facho sans cœur. (…) En vérité, l’adjectif qu’elle aurait certainement dû utiliser était ‘froid’. » Le commissaire essaie d’appréhender son métier avec recul mais les meurtres auxquels il est aujourd’hui confronté, puisque plusieurs autres ont lieu, le déroutent. « Le dénominateur commun entre toutes les victimes était constitué de viols et d’agressions sexuelles. En toute logique, cela pointait vers une volonté de se venger. Une vengeance personnelle et cruelle. » Bo Svernström (né en 1964, journaliste dans la presse écrite) signe, avec Victimes, donné comme son premier roman, un livre très prenant. La parole est alternativement offerte à l’assassin et aux enquêteurs – les policiers et une journaliste. En dépit du sort fait aux victimes, toutes affreusement torturées (avec sans doute trop de raffinements, le lecteur peut décrocher), difficile de les plaindre, à l’évocation de leurs crimes. On peut placer ce livre aux côtés des trois de Camilla Läckberg consacrés à la vengeance des femmes contre les hommes (La Cage dorée, Femmes sans merci, Des Ailes d’argent), à la série Millénium de Stieg Larsson et à d’autres parus depuis la vague #MeToo. Original dans sa forme plus que dans son thème, avec cette situation criminelle observée par la police, puis, deuxième partie de ce copieux roman, par l’auteur des crimes, il est très prometteur. Les personnages sont tous bien présents, l’intrigue se tient. D’un point de vue de la morale, il ouvre le champ à la discussion, puisque n’offrant pas de solution judiciaire dans les règles. Bo Svernström a publié d’autres romans. On attend avec impatience de les lire.
* Bo Svernström, Victimes (Offrens offer, 2018), trad. Lucas Messmer, Denoël (Sueurs froides), 2021
Froid mortel
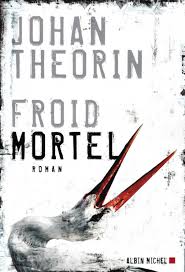
Dans Froid mortel, Johan Theorin (né en 1963) quitte l’île d’Öland (où il situe l’action de quatre de ses romans, très bons) pour la côte ouest de la Suède. Encore jeune professeur des écoles, Jan Hauger est embauché dans une maternelle qui accueille des enfants dont les parents résident à l’hôpital psychiatrique voisin. Le règlement est plutôt strict et surprenant mais il l’accepte volontiers. Peut-être parce que lui-même dissimule des secrets et qu’il ne tient guère à se faire remarquer ? Ou parce qu’il prépare l’évasion de celle qu’il a aimée des années auparavant et qui, croit-il, séjourne dans l’institution ? « Il sait que tous les fantasmes violents finissent de la même façon quand ils se réalisent : dans la terreur, les remords et la solitude. » Nul doute que Froid mortel, dont la fin peut sembler un peu expédiée, déconcertera les lecteurs qui ont apprécié les volumes précédents de Theorin. Non pas que ce roman soit sans qualités mais l’auteur rend si bien l’atmosphère propre à l’île d’Öland que le lecteur peut regretter de ne pas la retrouver ici.
* Froid mortel (Sankta psyko, 2011), trad. Rémi Cassaigne, Albin Michel, 2013




