Essais
Poétocratie/Les Écrivains à l’avant-garde du modèle suédois
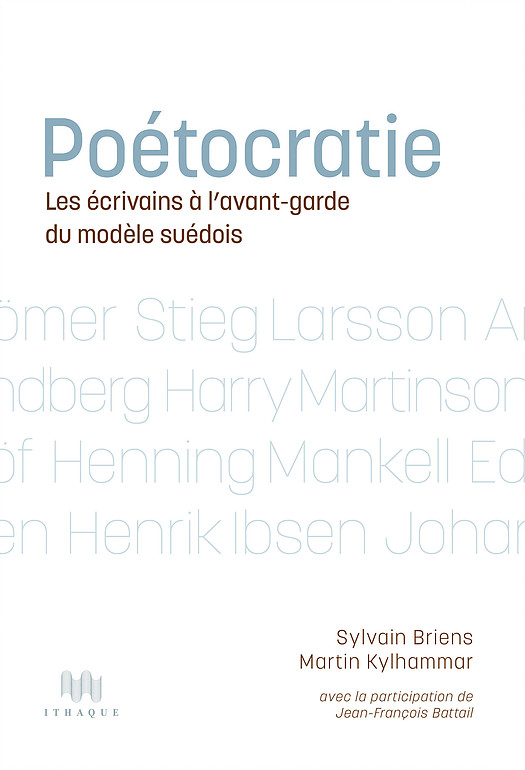
Les écrivains, comme représentants privilégiés d’un modèle de société ? Comme aiguillons d’orientations politiques éventuellement novatrices ? Il fallait oser y songer et c’est ce que font avec brio Sylvain Briens, Martin Kylhammar et Jean-François Battail dans un essai passionnant, Poétocratie/Les Écrivains à l’avant-garde du modèle suédois. « Les écrivains dont nous allons parler n’ont pas cherché à prendre le pouvoir (…), mais ils se sont tous engagés dans les débats politiques, technologiques, écologiques et sociaux. Ils ont participé chacun à leur manière à la construction d’une meilleure société, au projet national suédois du folkhem, à ce qu’on appelle communément le modèle suédois », expliquent en introduction les trois auteurs, relevant ensuite que « le terme poétocratie est créé par l’historien norvégien Ernst Sars pour qualifier une génération d’écrivains nordiques de la fin du XIXe siècle qui s’engageait dans les questions politiques ou sociales. » Nous parlerions ici, en France, d’artistes ou d’écrivains « engagés », sachant pertinemment qu’aujourd’hui ce qualificatif signifie neuf fois sur dix, abusivement certes mais c’est ainsi, « de gauche » et « humanistes ». « Les écrivains que nous avons sélectionnés ici sont-ils représentatifs de la culture suédoise ? » s’interrogent nos auteurs : « Non, du moins pas selon des critères sociologiques ou statistiques. Par leur originalité et spécificité, ils se différencient de la culture moyenne dominante et occupent une position d’avant-garde par rapport à la société. » Et tous trois de citer les noms retenus – excusez du peu : August Strindberg, Verner Von Heidenstam, Tomas Tranströmer, Stieg Larsson, puis, dans les « rôles secondaires », Harry Martinson, Eyvind Johnson, Karin Boye, Gunnar Ekelöf, Kerstin Ekman, Maj Sjöwall et Per Wahlöö, Henning Mankell, Jonas Hassen Khemiri, etc. On l’a compris, la plupart des auteurs suédois de quelque importance de ce dernier siècle sont intervenus directement dans la vie publique/politique suédoise, contribuant activement à la conscientisation de leurs lecteurs et, de fait, à la mise en place de ce fameux folkhem. Lequel folkhem, preuve incontestable de son succès en profondeur, est revendiqué de nos jours par l’ensemble des forces politiques suédoises, gauche et droite réunies. Il constitue le socle de la pensée, au sens large, de ce pays, une façon d’être dont les écrivains, pour beaucoup, ont été tant les acteurs que les témoins. Dans ce livre est également analysée la vision que les Français ont, ou ont eue, de la Suède. Dès les années 1930, lorsque les grandes réformes commençaient à porter leurs fruits, Serge de Chessin, Christian de Caters ou bien sûr Lucien Maury (notamment traducteur et éditeur d’ouvrages des Pays nordiques) les ont exposées à leurs lecteurs. Puis d’autres, après guerre (pensons à Henri Queffélec ou François-Régis Bastide), ont tenté de fournir une nouvelle vision. Jusqu’à aujourd’hui : ici ou là, n’ont cessé les commentaires plus ou moins pertinents sur le « paradis suédois », le « modèle suédois » ou, au contraire, le « totalitarisme suédois ». L’image que les Français ont de la Suède est en partie idéalisée, à tort ou à raison. Elle est extrémement positive ou, assez rarement il faut le reconnaître, démesurément négative, selon le curseur politique ou culturel employé ; elle n’est jamais neutre – pour beaucoup, la Suède n’est pas un pays comme un autre. Il y aurait énormément à dire encore sur ce livre, Poétocratie/Les Écrivains à l’avant-garde du modèle suédois, des citations à faire, sur lesquelles réfléchir, mais nous nous contenterons d’un conseil : si vous vous intéressez un tant soi peu à la Suède et à sa culture, lisez-le, il vous enrichira, vous le reprendrez souvent en main. Les littératures suédoise – et nordique – sont « à la conquête du monde » (avec le succès d’écrivains « transnationaux » comme Khemiri, Tranströmer, Stieg Larsson, Mankell et tant d’autres), nous ne nous en plaindrons pas. Puissent-elles, grâce à leur pertinence, à leur intelligence, apporter un peu plus de sagacité, pour ne pas dire de sagesse, dans la marche de ce monde… !
* Sylvain Briens/Martin Kylhammar/Jean-François Battail, Poétocratie/Les Écrivains à l’avant-garde du modèle suédois, Ithaque, 2016
Osons la nuit, Manifeste contre la pollution lumineuse
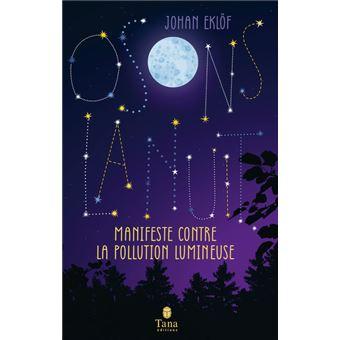
Quel est ce monde, dans lequel les humains ne respectent ni l’eau, ni l’air, ni le silence, ni l’obscurité... ? La vie est méprisée sous toutes ses formes, végétales ou animales, dès lors qu’elle ne s’intègre pas dans un commerce devenu mondial et, de fait, mondialement destructeur. « Dans les années 1980, deux tiers des églises de la province du Västergötland possédaient leur propre colonie de chauves-souris. Quarante ans plus tard (…), elles ne sont plus qu’un tiers. » Pourquoi ? interroge Johan Eklöf (né en 1973, chercheur et enseignant à Stockholm et spécialiste des chauves-souris) dans son livre, Osons la nuit, Manifeste contre la pollution lumineuse. Parce que la nuit, nombre d’églises sont aujourd’hui éclairées. Le constat s’applique à l’ensemble de la vie animale nocturne. La « pollution lumineuse » sévit tant à la campagne qu’en ville et les animaux qui profitent de la nuit pour sortir se cloîtrent et périssent. « ...Ces animaux qui, depuis 70 millions d’années, ont la nuit pour habitat, disparaissent lentement mais sûrement de ces lieux. Et peut-être même disparaissent tout court. » La pollution lumineuse n’est décriée depuis quelque temps qu’à cause de son coût énergétique et financier, raison pour laquelle nombre de communes éteignent l’éclairage public après minuit. Les nuisances à l’encontre de la nature apparaissent comme secondaires et sont peu perceptibles directement. Leur impact à moyen terme n’est pourtant pas négligeable, puisque une partie de la vie animale se trouve menacée. « ...Il y a de moins en moins d’insectes, peut-être pas en terme d’espèces, mais incontestablement en nombre d’individus. » Johan Eklöf fait œuvre utile en le rappelant, mentionnant dans son livre diverses anecdotes ou observations attestant du carnage. Animaux et végétaux sont liés au « cycle de l’obscurité », appelé le rythme circadien, le rompre c’est compromettre leurs chances de survie. « La lumière, ou plutôt l’absence d’obscurité, induit les insectes en erreur à tous les stades de leur existence. » Et ce, alors que partout faune et flore périclitent à cause des activités humaines. « Pour le dire en peu de mots : notre rythme circadien est immémorial, commun à tous les êtres vivants et absolument fondamental ». Osons la nuit, Manifeste contre la pollution lumineuse est l’un de ces ouvrages de vulgarisation scientifique qui nous permettent d’appréhender le monde autrement. « La pollution lumineuse du ciel brouille galaxies et systèmes solaires lointains, un peu comme si nous avions utilisé un torchon sale pour essuyer notre fenêtre vers l’univers. » L’eau, l’air, la lumière, la faune et la flore, le jour et la nuit... C’est bien un type de société – marchande, libérale, capitaliste, industrielle, appelons-la comme l’on veut : disons productiviste – qui dérobe les seuls biens de valeur dont l’être humain bénéficie de manière inconditionnelle à sa naissance. Osons refuser ce qui nuit.
* Johan Eklöf, Osons la nuit, Manifeste contre la pollution lumineuse, trad. Anna Gibson, Tana, 2022
Le Moderniste intemporel

Nous n’entreprendrons pas d’en faire une critique approfondie ici – tout simplement parce que nous avons lu cet essai de Martin Kylhammar il y a déjà un bon moment, avant la création de ce site, « Voyage dans les lettres nordiques ». Mais mentionnons tout de même Le Moderniste intemporel (sous-titré « Essais sur la dimension culturelle du modèle suédois »), excellent ouvrage consacré à, pour résumer, la place de la littérature dans notre société. Ou, en l’occurrence, dans la société suédoise contemporaine. Au long de chapitres conçus comme autant d’essais consacrés à des figures connues ou oubliées de la littérature suédoise (avec August Strindberg, Sten Selander et Verner von Heidenstam comme pivots), Martin Kylhammar expose une conception qui nous semble pertinente : « une fréquentation accrue de la littérature est hautement recommandable » pour les historiens. Car « si nous considérons les écrivains comme pourvoyeurs d’idées, et pas seulement comme objets d’études esthétiques, nous devons les prendre au sérieux en tant qu’analystes de la société… » Rappelant que toute lecture ne saurait se faire sans (parmi d’autres points) « connaissances historiques et vaste culture », il s’escrime à traquer ce qu’il nomme les « factoïdes », autrement dit des faits donnés pour vrais alors qu’ils sont contestables.
* Martin Kylhammar, Le Moderniste intemporel (Den tidlöse modernisten. En essäbok, 2004), trad. Jean-François & Marianne Battail, L’Harmattan (Questions contemporaines), 2009
Raconter la mer

« Une littérature qui s’inspire de la mer (...) doit être rebelle plutôt que servile, déracinée plutôt qu’enracinée, insoumise plutôt qu’obéissante, blasphématoire plutôt qu’élogieuse, nomade plutôt que sédentaire, exceptionnelle plutôt que tristement normale, découverte plutôt que confirmation, universaliste plutôt que tribale, métissée plutôt que monochrome, non conformiste plutôt que conformiste, sacrilège plutôt que sacralisation. » Ainsi, non sans lyrisme, Björn Larsson (né en 1953 à Jönköping) explique-t-il son goût tant pour la littérature que pour la navigation maritime dans Raconter la mer, ouvrage dans lequel il compile ses préfaces à ce que l’on appelle des romans de mer. L’écrivain suédois qui a vécu plusieurs années sur un bateau à voile, le Rustica, véritable personnage de son roman Le Cercle celtique, s’exprime ici directement en français, sans plus requérir l’aide de son compère traducteur Philippe Bouquet (récemment décédé). L’ensemble n’est pas homogène, les œuvres qu’il retient sont diverses, de Miroir de la mer de Joseph Conrad, à L’Énigme des sables de Erkine Childers, du Journal de bord de Christophe Colomb à Seul, autour du monde de Joshua Slocum. À chaque fois revient, sous-jacente, la question de savoir si, ou plutôt pourquoi, la mer inspire autant les auteurs. « La mer est-elle vraiment plus présente dans la littérature que "la terre ou le feu" ? Y a-t-il, pour ne prendre que quelques exemples, plus de marins dans la littérature que d’agriculteurs, plus de pêcheurs que d’ouvriers d’usine, plus de commandants que de PDG ? » Et Björn Larsson, auteur par ailleurs de La Sagesse de la mer (2002), essai au titre évocateur, de remarquer que le seul écrivain de la mer suédois, Ove Allanson (1932-2016), considéré comme auteur prolétarien, n’a jamais été traduit. Après une brève contextualisation des romans prenant l’espace maritime pour cadre, Björn Larsson nous livre donc ses préfaces, toutes débordant d’érudition. Sa « postface aux préfaces » est à ce titre éloquente et se termine sur une quasi profession de foi : « L’identité de la littérature n’est ni fondée sur le droit du sang, ni sur celui du sol, mais sur celui du cœur. Une littérature qui se soumet au pouvoir est une littérature morte. (...) La littérature de la mer doit viser plus loin que la seule mer. »
* Björn Larsson, Raconter la mer, Zéraq, 2025
Macron le Suédois

« Il peut s’agir, comme certains le suggèrent, d’une manière de faire passer la pilule de réformes impopulaires en se targuant d’imiter des pays qui connaissent une belle réussite économique et en même temps ont un système social enviable. Mais dans tous les cas, il est rare qu’un de nos dirigeants se disent attaché au modèle suédois ou au modèle nordique. » Livre d’humour ou essai qui se veut sérieux, comme tendrait à le laisser penser l’apparente respectabilité de l’éditeur (les Presses universitaires de France), que ce Macron le Suédois d’Alain Lefebvre ? Un président aussi omnipotent, dont l’anagramme est... « monarc », peut-il légitimement se revendiquer de l’héritage politique suédois – en grande partie, rappelons-le, social-démocrate ? Sa promiscuité feinte ou réelle avec le peuple de France saurait-elle cacher son autre promiscuité, plus grande, infiniment plus grande, avec le monde de la finance, autrement dit du pouvoir, de France ou d’ailleurs ? L’homme sait séduire, c’est évident. Entre lui et Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2017, le choix ne se posait pas. Pourtant, serait-il toujours opportun de lui tresser des louanges ? Pas sûr, rétorqueraient les zadistes matraqués et expulsés de Notre-Dame de Landes, relayés par les opposants au contournement autoroutier de Strasbourg, relayés par... tant d’autres citoyens qui ont mieux à faire de leurs maigres deniers que d’acheter un permis de chasse même à tarif réduit, faute de bénéficier des chasses présidentielles bientôt réouvertes. Alain Lefebvre (« ancien élève de l’Ena (…), journaliste et consultant spécialiste des questions sociales et des ressources humaines », comme le signale la quatrième de couverture) ne se référerait-il pas plus à l’action de Fredrik Reinfeldt qu’à celle de ses prédécesseurs sociaux-démocrates ? Reinfeldt, leader des Modérés (Moderaterna), parti « libéral centriste » rebaptisé les Nouveaux modérés (Nya moderaterna) après sa victoire comme Premier ministre (très jeune chef de gouvernement, comme Macron : à 41 ans pour le Suédois, 39 pour le Français), qui a privatisé diverses entreprises publiques durant son mandat (2006-2014) et levé le moratoire sur le programme nucléaire civil suédois (2009). Incontestablement à l’aise avec l’histoire du mouvement ouvrier et ses multiples branches, Alain Lefebvre connaît bien les Pays nordiques et notamment la Suède, où il a travaillé une quinzaine d’années « pour les services diplomatiques français et pour des agences européennes ». Contrairement à tant de prétendus analystes prêts à brocarder ce qui va à l’encontre de leurs théories ultra-libérales, il reconnaît que « le système social suédois fonctionne encore correctement, inégalités et pauvreté sont moins élevées qu’en France ; les fameuses émeutes dans les quartiers dont on parle en France datent de 2013 et consistent en quelques jours d’agitation qui n’ont rien de commun avec ce qui se passe de temps en temps en France (à relativiser, après les dizaines de véhicules incendiés dans la région de Göteborg en 2018, NDA) ; on peut difficilement qualifier de libéral un pays où la part des dépenses publiques dans l’économie est une des plus élevées du monde... » Alors, Macron le Suédois : le titre nous semble mal choisi (il manque au moins un point d’interrogation), pour ce livre intéressant, qui montre par ailleurs l’attrait de la social-démocratie chez nombre de nos gouvernants (de Jean-Jacques Servan-Schreiber à Michel Rocard, de Jacques Chirac à Ségolène Royal, si, si !). Vendeur, peut-être, mais inadapté, sinon à ne retenir que l’acceptation libérale incarnée par Fredrik Reinfeldt comme modèle du politicien suédois. « Le moment est favorable à une politique plus pragmatique qu’idéologique, menée par un président qui gagnerait à mieux connaître la Suède dont il semble vouloir s’inspirer », conclut gentiment, beaucoup trop gentiment, Alain Lefebvre (auteur en 2006, avec Dominique Méda, d’un essai, Faut-il brûler le modèle social français, dans lequel il préconisait déjà de se référer aux Pays nordiques), oubliant que la morgue dont le président français fait preuve (cf. son goût pour les honneurs – Versailles, Versailles ! – ou l’affaire Benalla) choquerait assurément nombre de Suédois si elle émanait de l’un de leurs élus. De quoi lui taper sur les doigts à coups de Toblerone... ! Dommage, nous semble-t-il, que ce livre accorde tant de crédit aux dires du Président de la république française – mais reconnaissons que des réserves sont émises (comme ce « tout au moins dans le discours » à propos de l’action gouvernementale à venir sur les prisons) et qu’Alain Lefebvre exprime clairement qu’Emmanuel Macron n’a pas pour ambition de « corriger les inégalités », élément clé de la cohésion sociale en Suède. Car sa présentation très poussée du fonctionnement de la société suédoise contemporaine, notamment du monde du travail, de la réforme du transport ferroviaire et des « prisons ouvertes » (dont le nom est en France « centres pénitentiaires de réinsertion »), n’a pas d’équivalent et peut largement combler d’aise des lecteurs soucieux d’informations précises.
* Alain Lefebvre, Macron le Suédois, PUF, 2018
Arthur
Mikael Lindnord est coach et organisateur d’événements sportifs sur la Höga Kusten, dans la région de Örnsköldsvik, où il vit avec sa femme et leurs enfants. Dans Arthur (coécrit avec Val Hudson), il trace le portrait du « chien errant » qu’il a ramené d’Amérique du Sud. Soulignons cette remarque, à la fin de l’ouvrage, à propos des chiens, véritablement maltraités dans nombre de régions du monde : « ...On n’a pas le droit de leur donner des coups. On n’a pas le droit de les battre et de les affamer. »
* Mikael Lindnord, Arthur (Arthur : the dog who crossed the jungle to find a home, 2016), trad. de l’américain David Rochefort, Belfond, 2019
Le Siècle des bombardements

« Le génocide est déjà inscrit dans les documents les plus anciens et les plus sacrés de notre culture. Lisez l’Ancien Testament. Lisez l’Iliade. Lisez l’Énéide. Ce qu’il faut faire y est écrit noir sur blanc. » Ainsi l’essayiste suédois Sven Lindqvist (1932-2019) commence-t-il son étude fournie sur Le Siècle des bombardements, autrement dit quand l’usage de l’aéroplane, qu’on appellera bientôt l’avion, a été mis au service de la guerre. On le connaît ici pour Exterminez toutes ces brutes (essai adapté en une série de quatre épisodes sur Arte) et d’autres ouvrages dans lesquels il s’est essayé à démontrer la violence intrinsèque de l’expansion colonialiste, que celle-ci parte du continent européen, comme trop souvent, ou d’ailleurs. Anéantir des villes et des villages, tuer d’autres soldats mais aussi la population civile et notamment des enfants et des vieillards en guise d’anéantissement total de l’ennemi, ainsi les militaires procèdent-ils. « Et n’est-ce pas cette manière de faire la guerre – que l’Europe s’est si longtemps autorisée contre les deux tiers de l’humanité – qui revient au XXe siècle nous frapper comme un boomerang ? » Sven Lindqvist parcourt l’histoire, qui n’est qu’une accumulation de guerres. Les raisons de celles-ci importent peu, elles se ressemblent toutes, elles sont liées au pouvoir et à la richesse, dont la conquête de territoires est un odieux prétexte, qui ne justifie rien. Les ouvrages scientifiques et historiques sont pour lui sources privilégiées de renseignements, mais, ici, il se réfère aussi abondamment aux romans de science-fiction – sources plus populaires mais non moins précieuses que des études universitaires tant elles en disent long sur l’état d’esprit du moment. À partir des dernières décennies du XIXe siècle et incités à cela par les immenses progrès technologiques, leurs auteurs imaginent des mondes futurs en proie à divers maux, que la science peut parvenir à soigner. Ainsi, avec l’aviation. Quand les hommes pourront voler et rejoindre divers points du globe en des temps ridiculement courts, l’idée de s’entre-tuer ne les affectera plus, ils ne songeront qu’à échanger leurs savoir, la fraternité humaine s’installera. Beaucoup d’auteurs de bonne foi le croient. D’autres pensent qu’une « superarme » supprimera l’idée même de faire la guerre (« libérant les forces les plus profondes de la matière, (elle) tue et détruit tout sur un très vaste territoire... ») ; son potentiel de nocivité sera tel, que nul n’osera l’utiliser ; la puissance détentrice exercera son pouvoir de manière indiscutable et de fait quasi-définitive. La bombe atomique a longtemps exercé cet effet repoussoir. Aujourd’hui, en sommes-nous encore vraiment sûrs ? La Russie, par exemple, menace régulièrement d’en faire usage si l’Occident apporte un soutien trop marqué à l’Ukraine. La Corée du Nord est-elle dotée de cet engin de destruction massive ? D’autres pays, notamment l’Iran, dirigés par des cinglés, ne manquent pas d’inquiéter. La fameuse dissuasion nucléaire semble avoir fait son temps. « L’esclavage a longtemps été considéré comme une évidence et une nécessité. La vendetta était jadis une affaire d’honneur. Les deux semblaient être des institutions inébranlables, des fondements sociaux profondément ancrés dans une histoire millénaire, et dans la nature humaine elle-même. Pourtant, avec le temps, ils sont devenus surannés, haïssables, et finalement impensables. Pourquoi la guerre ne prendrait-elle pas le même chemin ? » Le pacifiste Sven Lindqvist est mort peu de temps avant la résurgence de grandes guerres à l’ancienne – guerres de position très meurtrières et très destructrices, inscrites dans la durée, dont les civils pâtissent en premier lieu. Il expose des faits peu contestables mais hélas, qui en tire des conclusions ? « Dans le monde entier, ce sont les femmes, le moteur de la résistance. » Les hommes ne sont certes pas absents des luttes contre le militarisme et la course à l’armement mais, pour nombre d’entre eux, ils sont aussi les acteurs de ces fléaux. Regardons les images que nous renvoient les émissions de télé ou les réseaux sociaux : des hommes et quasiment toujours des hommes, en uniformes, belliqueux, prêts à détruire tout ce qui s’oppose à leur rage de pouvoir – « le paradis de la virilité ». Qui décide de faire la guerre ? Les hommes. Qui mène la guerre ? Les hommes. Qui interrompt les combats quand le repos du guerrier s’impose – ou quand les guerriers ne sont plus assez nombreux ? Les hommes. À quand un vaccin contre l’excès de testostérone ? À quand l’ablation du siège de la connerie et de l’agressivité dans le cerveau masculin ? Il fut un temps où Sven Lindqvist pensait, comme la plupart de ses contemporains, notamment suédois, que le recours non pas à la bombe atomique, mais à la menace de son utilisation, pourrait se révéler nécessaire. Il avoue humblement son rétro-pédalage : « Il m’est déjà arrivé d’avoir raison et de m’en réjouir, mais jamais je n’ai été aussi heureux qu’à ce moment-là, quand il est devenu évident que j’avais eu jadis complètement tort. » Ce livre prend place après d’autres brillants essais de l’auteur sur des sujets sensibles et d’une actualité que les années n’altèrent pas. Sa formule – de multiples réflexions appuyées à chaque fois sur des citations, des extraits de romans ou de journaux et des pages d’autobiographie – est efficace. « Il est juste de se révolter. Il arrive aussi que ce soit payant », écrit-il, rappelant les révoltes des Noirs aux États-Unis pour l’obtention de droits civiques équivalents à ceux des Blancs. Il est convaincant, évidemment, et pourtant... Pourtant rien ne change ou si peu, si lentement, les démocraties chancellent jusqu’en Europe, la Russie déploie des armes en direction de l’Ukraine et tente d’intimider d’autres pays qui ne se soumettent pas à ses diktats (ce que Lindqvist, à ce sujet trop optimiste, n’envisageait pas, convaincu que la fin de l’URSS signifiait la fin de l’impérialisme russe), des groupes terroristes comme le Hamas attaquent des populations civiles non armées (et des kibboutz, rassemblements humains par définition plutôt enclins à la paix), des ordures se retrouvent à la tête d’États avec pour projet la restriction des liberté, la production d’armes et le renforcement des forces militaires... Les beaux jours semblent encore loin d’arriver. Puisse tout de même Sven Lindqvist être lu et entendu !
* Sven Lindqvist, Le Siècle des bombardements (Nu dog du. Bombernas århundrade, 1999), trad. du suédois Marie-Ange Guillaume et Cécilia Monteaux, Payot (PBP/Essais), 2023
Le Voyage saharien
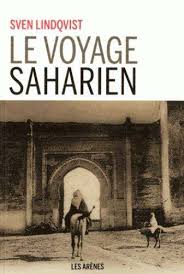
« ...Lorsque le désert commence à s’ouvrir autour de moi, quand les couleurs du sable prennent le relais avec leur million de variations monotones et que la lumière devient si intense qu’elle dissimule les formes, éteint les couleurs et nivelle les reliefs - alors le bonheur jaillissant de tout mon corps me submerge et je sens : ceci est mon paysage ! C’était ici que je voulais aller ! » Sven Lindqvist (né en 1932) affirme avoir toujours rêvé de traverser le Sahara, notamment après la lecture d’Antoine de Saint-Exupéry. Comme dans ses précédents ouvrages, il s’exerce, dans Les plongeurs du désert, à juxtaposer considérations personnelles (le pourquoi et le déroulé de son voyage), références culturelles et faits historiques. Il confronte les points de vue, cite politiciens, militaires ou artistes (l’exemple du peintre Eugène Fromentin, 1820-1876, est édifiant, tout comme celui d’André Gide), pour en arriver à sa propre conclusion : « L’histoire de l’impérialisme est un puits rempli de cadavres. » Le texte Les Plongeurs du désert, est suivi d’un autre, initialement publié en français en 1998, Exterminez toutes ces brutes (qui reprend une phrase du livre de Joseph Conrad, Voyage au cœur des ténèbres). Les titres, dans l’un et l’autre cas, ont une signification forte, brutale peut-on dire, que nous nous abstiendrons d’expliciter ici, renvoyant à la lecture de l’œuvre de Sven Lindqvist (et pas seulement de ce volume). « Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c’est le courage de comprendre ce que nous savons et d’en tirer les conséquences. » Le bruit des bottes contre le silence des pantoufles, toujours, pourrait-on ajouter en guise de commentaires. Lecture utile pour comprendre les origines et la complexité du monde d’aujourd’hui et pour se persuader, si besoin est, que « l’extermination par l’Europe des ‘races inférieures’ sur quatre continents a préparé le terrain pour l’extermination par Hitler de six millions de Juifs en Europe ».
* Sven Lindqvist, Le Voyage saharien (Les Plongeurs du désert/Exterminez toutes ces brutes !), trad. Hélène Hervieu, Les Arènes, 2018
Avis de tempête

Ce livre, Avis de tempête, est le quatrième titre d’Andreas Malm publié en France (après L’Anthropocène contre l’histoire, Comment saboter un pipeline et La Chauve-souris et le capital), sans oublier l’essai collectif, Fascisme fossile. Érudit, brillant, le maître de conférence en géographie humaine et militant pour le climat suédois peine ici, nous semble-t-il, à convaincre. Ou bien, peut-être n’en a-t-il pas vraiment l’intention, préférant régler ses comptes avec d’autres spécialistes politiques du climat (En l’occurrence Bruno Latour – mais les travaux de celui en valent-il la peine ? Son « nihilisme épistémologique se résume à une déclinaison assez vulgaire du machiavélisme ou nietzschéisme : rien d’autre que la force ne fait loi. ») et tenter de s’ériger en penseur incontestable – plus qu’incontesté. Cet aspect peut-être un peu trop virulent, un peu trop coup de gueule, ne remet pas en cause la pertinence de nombre de ses constats et/ou de ses analyses. « Plus on se retire dans un cocon virtuel, plus on se détache des choses qui se passent dans la nature. Si cette analyse est correcte, et si les technologies d’immersion électroniques continuent d’avancer, ce qui semble inéluctable, alors la condition postmoderne sera encore largement capable de protéger et même d’étendre son territoire. » Mais une bonne partie de son volume est absconse, au moins au début, volontairement sans doute (on imagine mal Andreas Malm parler dans sa vie quotidienne comme il le fait ici), et lorsque le lecteur finit par comprendre où l’auteur, malgré son « charabia » (il emploie ce mot à propos d’un autre universitaire) veut en venir, la réflexion qui parfois s’impose est tout ça pour ça ? Un tel vocabulaire pour une pensée somme toute quelquefois assez peu consistante ou d’une évidence frisant la tautologie ? (Qui sommes-nous, certes, pour dénigrer l’expression du grand penseur ? L’un de ces simples citoyens auxquels il prétend tout de même s’adresser – puisque changer l’ordre social en place, responsable du bouleversement climatique, ne saurait se faire sans une large participation des habitants de cette planète.) Cette réserve énoncée, observons que Malm poursuit son intéressant travail de sape du capitalisme ontologiquement destructeur. « Il y a cette impression perturbante que la seule chose sensée à faire désormais est de tout abandonner pour mettre fin physiquement à la combustion d’énergies fossiles, dégonfler les pneus, pénétrer sur les pistes de décollage, assiéger les plateformes pétrolières, envahir les mines. » Observons également qu’il persévère dans l’utilisation de ses outils dialectiques initiaux (« le matérialisme historique comme alternative »), un léninisme historiquement des plus productivistes et qui peut paraître eu égard à ses résultats bien désuet, même repeint en vert flashy. Le capitalisme est responsable du changement climatique – « qu’on leur donne le chaos », écrit-il dans l’une de ces formules choc qu’il apprécie et reprenant le titre d’un ouvrage de Kae Tempest, car « la classe capitaliste mérite bien un peu de haine », visant les tenants du capitalisme et omettant de dire que ce chaos frapperait en premier lieu les habituelles victimes de ce capitalisme : les habitants des pays pauvres, les salariés modestes des pays dits riches, les exclus de toutes sortes... Mais les pays qui se revendiquent, certes à tort, d’autres idéologies, n’entretiennent ou n’ont pas entretenu plus d’attention pour la nature. De tout temps, productivisme = mépris pour l’environnement. Lequel environnement est considéré uniquement comme un élément constitutif d’une richesse à obtenir. Jamais la nature n’est une valeur en soi, la nature n’a de sens que sous le contrôle et pour le profit de l’être humain. Selon les régions du globe et les époques, un animal peut être vu comme un outil de travail ou comme de la viande ; une plante comme de la nourriture, du bois de chauffage ou de construction, ou encore comme s’intégrant dans le décor – ce paysage à destination des humains. L’œil, si l’on peut dire, en tant qu’appareil de jauge, est celui de l’homme. Que l’on sache, au cours de leur glorieuse histoire, les marxistes se sont plus efforcés de piller et de saccager la nature, tout comme leurs frères ennemis capitalistes, que de la protéger. « Moins de Latour, plus de Lénine : voilà ce qu’exige l’état de réchauffement. » Les analogies, plus que les comparaisons, peuvent-elles servir à expliciter la complexité de la pensée de Malm ? Allons-y ! « ...À l’issue d’un processus visant à isoler le social du naturel (…), le protocole de Montréal a pu interdire aux entreprises de produire davantage de chlorofluorocarbure. À cet égard, le procédé est similaire à celui suivi par Trotsky ou par la résistance palestinienne : refusant la paralysie hybridiste, il s’attaque à la combinaison qui est à la source du danger. » Ah bon ? Effectivement, vu comme cela. Mais qu’en est-il de cet « avis de tempête » annoncé sur la planète ? Se résumerait-il à la progression constante des idées d’extrême droite dans les sociétés occidentales ? L’auteur, qui ne voit le « fascisme » qu’à sa porte, semble oublier la montée autoritaire de type incontestablement fasciste dans une bonne partie du Moyen-Orient et d’autres pays du fameux « sud global » - quid de l’art, de la pensée, sans parler de l’action politique critiques dans nombre de ces États ? « On peut donc brièvement résumer trois principes d’un réalisme climatique socialiste : 1) les rapports sociaux ont une véritable primauté causale dans le développement des énergies fossiles et des technologies fondées dessus ; 2) via des boucles de renforcement récursives, ces rapports ont été cimentés dans la structure persistante de l’économie fossile ; 3) à son tour, cette totalité a mis le feu au système terrestre en tant que totalité, et les humains ont de sérieuses raisons de s’en inquiéter. » Comment se fait-il, regrette l’auteur, que le mouvement écologiste soit aujourd’hui à ce point morcelé et inefficace – à peu de chose près comme le mouvement ouvrier ? Le transhumanisme nous sauvera-t-il ? Non, à l’évidence et, assurant non sans ironie que l’une des solutions serait que les partisans du transhumanisme « deviennent humanistes », Andreas Malm s’étend trop brièvement sur la question. Pourtant, celle-ci, d’une actualité chronique, est liée à l’IA et sa potentielle dangerosité – et pour l’être humain et pour la nature au sein de laquelle celui-ci continue malgré tout de vivre – chaque jour réaffirmée. Il y a beaucoup à dire sur le « chaos climatique », ses causes et ses conséquences, et Andreas Malm n’est pas en manque d’arguments mais là n’est apparemment pas le sujet premier de son livre. C’est dommage mais il est vrai que ses précédents travaux étaient très explicites. En résumé, notons que « l’expropriation totale des 1 à 10 % les plus riches constituerait une mesure efficace pour le climat. Elle permettrait d’éliminer d’un seul coup jusqu’à la moitié des émissions totales et de fiancer plusieurs transitions énergétiques mondiales. »
* Andreas Malm, Avis de tempête (The Progress of this storm, 2017), trad. de l’anglais Nathan Legrand, La Fabrique, 2023
L’Anthropocène contre l’histoire
L’histoire, la grande histoire, celle qui concerne les rapports entre les êtres humains, n’a rien d’une évidence. Le « sens de l’histoire » n’est qu’une vue de l’esprit. La roue, par exemple, avait été inventée depuis longtemps avant d’être utilisée et de devenir quasi-obligatoire pour les sociétés humaines. Dans L’Anthropocène contre l’histoire, Andreas Malm montre avec brio que, dans les premières décennies du XIXe siècle, l’énergie hydraulique avait de beaux jours devant elle pour alimenter les usines de coton sur le territoire britannique, mais que certains patrons en décidèrent autrement. L’utilisation de la vapeur permettait l’installation d’usines au cœur même des agglomérations. Ces usines n’étaient plus tributaires de la géographie ni, point véritablement important, elles pouvaient s’installer là où la main d’œuvre était abondante et habituée déjà au rythme de travail industriel. Ce qui signifie que l’usage de la vapeur, et par voie de conséquence d’un combustible fossile, le charbon, n’allait pas de soi mais résulta d’un choix – la rentabilité économique – au mépris des risques pour la nature (le « gaz carbonique » relâché) et par extension pour l’humanité, signalés dès les débuts de l’ère de la vapeur. Andreas Malm souligne aussi que cette décision, l’usage de la vapeur alors que celui de l’eau restait plus rentable, induisit un changement de société considérable, puisque toute la planète en fut affectée et ce, de cette époque à aujourd’hui, et qu’elle n’est le choix que d’un pourcentage infime de la population. « ...Une fraction infinitésimale de la population d’Homo sapiens sapiens au début du XIXe siècle. De fait, une petite coterie d’hommes blancs britanniques... » Autrement dit, aucune légitimité démocratique pour une décision qui mettra peut-être fin, s’il faut en croire certains collapsologues pas plus ridicules que les économistes patentés qui déblatèrent dans les médias, à la vie humaine et en grande partie animale sur la planète Terre. Envisager la destruction volontaire de l’environnement sous cet angle est intéressant et montre que la responsabilité ne saurait être diluée dans un collectif, l’espèce humaine, comme si tous les individus cultivaient le même type de relation avec leurs semblables, d’une part, et la nature, d’autre part. Laisser couler l’eau en se brossant les dents, ce n’est pas bien, mais quel rapport avec la destruction systématique et en toute conscience de la planète entreprise par des sociétés dirigées par les individus les plus riches ? S’il est accompli par des paysans dans l’ensemble peu fortunés, le saccage de la forêt amazonienne, par exemple, remplit les comptes bancaires d’individus répartis non seulement au Brésil mais aussi sur l’ensemble de la planète. À quand un gouvernement mondial pour empêcher que des malades mentaux à la Bolsonaro, à la Trump ou à la Poutine ou..., nuisent à leur pays, à l’humanité tout entière et à toute forme de vie animale et végétale ? Le gouvernement brésilien n’est pas propriétaire de la forêt amazonienne – le « poumon de l’humanité ». S’il use du droit de propriété pour la saccager, c’est que ce droit ne convient plus. Un droit d’ingérence écologique est à mettre en place de toute urgence. L’Anthropocène contre l’histoire nous semble être un bon élément d’analyse de la situation catastrophique en cours, avec une dizaine de pistes applicables dès aujourd’hui pour tenter d’y remédier et pour développer un « mouvement révolutionnaire pour le climat ».
* Andreas Malm, L’Anthropocène contre l’histoire, trad. de l’anglais Étienne Dobenesque, La Fabrique, 2017
Comment saboter un pipeline
À la différence des nombreux combats que Andreas Malm (né en 1977 et auteur d’un autre essai, L’Anthropocène contre l’histoire, La Fabrique, 2017) cite dans Comment saboter un pipeline et qui ont posé la question, à un moment ou à un autre, de l’emploi stratégique de la violence ou de la non-violence (apartheid en Afrique du Sud, droits des Afro-Américains aux USA, départs des colons britanniques de l’Inde, etc.), il est difficile de nommer un responsable unique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui explique sans doute l’absence de véritable succès du mouvement écologiste – puisque nous serions tous coupables, car tous consommateurs d’une énergie issue en grande partie de sources non renouvelables, contre qui s’élever ? Sinon l’affreux capitalisme, mais ce n’est même pas sûr, puisque des États prétendument communistes n’ont pas hésité à ravager leur territoire et celui d’autres pays au nom du productivisme industriel et de la consommation (URSS et bloc de l’Est, hier, Chine, etc.). Plus que le capitalisme, c’est donc l’industrialisation du monde, garante annoncée d’un mieux-être général (production de masse de biens de consommation courante), qui est cause du désastre en cours. Industrialisation et capitalisme sont liés, certes, et à propos des pays dits communistes on a pu parler avec raison de capitalisme d’État. Il nous semble qu’il manque une dimension dans le passionnant essai de Andreas Malm, maître de conférence en géographie humaine en Suède et militant pour le climat : le pourquoi de la constante opposition meurtrière entre l’être humain et la nature, ce contexte qui à l’origine est le sien, qui est peut-être toujours le sien, et qu’il n’a cesse de modeler et de remodeler jusqu’à le détruire. Car ce mépris manifesté par l’homme pour la faune et la flore ne remonte pas à une époque déterminée, il se retrouve dans les âges les plus anciens, dès les tout premiers temps de l’agriculture (ce que souligne sa concitoyenne Karin Bojs dans Ma grande famille, Les Arènes, 2020, riche essai sur le peuplement de l’Europe). Et ce mépris explique peut-être pourquoi la nature n’est, n’a jamais été et ne sera jamais qu’un terrain de jeu pour les êtres humains, et non une composante essentielle de son développement. Dès lors, l’interrogation au centre de ce livre, convient-il de préconiser l’usage, ou non, de la violence pour s’opposer à l’usage des combustibles d’origine fossile, paraît presque secondaire. Oui, bien sûr, pourrait-on répondre, à l’instar de l’auteur, puisque la violence, tout comme la non-violence, ne sauraient être des valeurs en soi, mais des éléments stratégiques d’un affrontement général. Hitler plus puissant que jamais, fallait-il réclamer « la paix à tout prix » (comme le philosophe Félicien Challaye, qui deviendra un partisan du régime de Vichy, et un certains nombre de pacifistes pour lesquels mieux valait « la paix désarmée face à Hitler » que la guerre) et se retrouver désarmé totalement, moralement parlant ? Autrement dit, désarmé, au premier degré, face à des hommes pour lesquels la violence n’était pas un souci – plutôt une façon de régner en instaurant la peur absolue – donc quelque chose de positif, ce que les pacifistes ont toujours eu du mal à comprendre. Si, la réponse, Andreas Malm la donne dès les premières pages de son livre, il compare ensuite, estimons-nous, des situations qui ne sont pas vraiment comparables. Alors que les publications sur les questions écologiques fleurissent, elles omettent très souvent la question fondamentale du pouvoir (la catastrophe climatique en cours est pourtant le résultat d’un pouvoir exercé par une classe sociale, celle des nantis, tant d’études le démontrent, notons en France les travaux, parmi d’autres, du couple Michel Pinçon-Monique Pinçon Charlot), comme si chaque individu détenait la même part de responsabilité et accusant le conducteur d’une vieille voiture diesel au même titre que le directeur de l’usine automobile ou les actionnaires. Songeons, ce n’est qu’un exemple, au mouvement Colibri et à tous ces auteurs qui nous vantent l’adéquation entre la préservation de la nature et le bien-être individuel. Et la lutte des classes ? Définitivement reléguée dans les poubelles de l’histoire ? Malm, lui, essaie de mettre les points sur les i, tant mieux. « Il y a une corrélation très étroite entre le revenu et la richesse d’un côté et les émissions de CO2 de l’autre. » Ajoutant : « ...Il ne fait aucun doute que les classes dirigeantes sont foncièrement incapables de répondre à la catastrophe autrement qu’en la précipitant. » Les travaux du Français Jacques Sémelin sur la « résistance civile », les différentes façons de répondre à l’oppression, même s’ils datent quelque peu pour certains et ne concernent pas directement la lutte contre le changement climatique, peuvent être lus en parallèle, mais bizarrement (souci de langue ?), Malm ne les mentionne pas. La question du pouvoir incite à dépasser un élément aujourd’hui de principe, quasi-religieux, brandi par une organisation comme Extinction Rebellion – XR, contre lequel s’insurge Malm. Dans le même ordre d’idées, rappelons le « paradoxe de la tolérance » énoncé en son temps par Karl Popper : une société tolérante doit-elle tolérer l’intolérance ? Aussi paradoxal que cela paraisse, répond le philosophe autrichien, défendre la tolérance nécessite de ne pas tolérer l’intolérance. Il en va de même avec le respect de la nature. La non-violence nécessite l’emploi éventuel de la violence pour pouvoir être affirmée. L’apparent paradoxe n’est qu’une règle de survie. Que Andreas Malm vient rappeler fort à propos, évoquant le mouvement du Général Ludd (on ne sait si ce personnage a réellement existé) de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles en Grande-Bretagne, et appelant à des actions de sabotage ciblées et massives. Il ne s’agit alors pas de « terrorisme », observe-t-il, mais de « vandalisme », ou, plus justement, de « sabotage ». Les écologistes officiels, élus ou souhaitant l’être, devraient se féliciter, note-t-il non sans un certain cynisme, de « l’influence bénéfique d’un flanc radical » – en s’empressant de le dénoncer, bien entendu, pour rester crédibles face à leurs interlocuteurs, les gens de pouvoir. Distinction sémantique d’une importance extrême car les nantis (pollueurs, militaires, actionnaires, chefs de tous ordre) ont vite fait d’imposer à leurs ennemis des étiquettes infamantes afin de les réduire plus facilement au silence. Nos quelques réserves énoncées doivent donc surtout donner à penser combien ce livre est un outil pour ne plus stagner dans la lutte écologique. « ...La résistance est la voie de la survie par tous les temps », conclut Andreas Malm. À lire avec l’excellent roman Le Zoo de Mengele, du Norvégien Gert Nygårdshaug, avant, enfin, de passer aux travaux pratiques.
* Andreas Malm, Comment saboter un pipeline (How to blow up a pipeline, 2020), trad. de l’anglais Étienne Dobenesque, La Fabrique, 2020
La Chauve-souris et le capital
« Il y aura des camps de réfugiés où les agents pathogènes ravageront les corps entassés. L’air sera trop chaud et trop contagieux dehors pour qu’on puisse sortir. Les champs se crevasseront sous le soleil sans personne pour les travailler. » Ainsi, dans son essai intitulé La Chauve-souris et le capital, Andreas Malm voit-il le Covid-19 se répandre dans les pays de l’hémisphère sud. Une prospective très proche, hélas, de la réalité déjà observée. Le capitalisme détruit la planète, avec l’aval de l’ensemble des gouvernants, certains trop intéressés à s’emplir les poches et d’autres, au nom de prétendues stratégies politiques, détournant délibérément le regard de la catastrophe qui est en cours. Pourquoi ne réagissons-nous pas ? interrogeait le maître de conférences en géographie humaine dans son précédent volume, Comment saboter un pipeline. « Les agents pathogènes ont (…) un lien bien réel avec certains des moteurs de la crise climatique, qui, à son tour, leur ouvre de nouvelles perspectives », affirme-t-il. « ...Le réchauffement mondial comme une tendance à long terme, le Covid-19 comme un choc. » À l’instar d’un Élysée Reclus, Andreas Malm désigne non pas un point déterminé, mais une situation, dans son contexte, renforçant la pertinence de sa réflexion. La pandémie qui affecte l’espèce humaine depuis la fin de l’année 2019 n’était pas inéluctable. Et, à présent, chercher à anéantir les multiples espèces de chiroptères, comme certains l’ont réclamé, ne résoudra pas le problème, bien au contraire. L’appauvrissement de la biodiversité est une cause sérieuse de la propagation des maladies, lesquelles, on peut raisonnablement le supposer, se multiplieront. Cet appauvrissement est directement lié à l’approvisionnement en café, thé, sucre, bœuf et huile de palme des pays les plus riches. Le capitalisme, « business-as-usual » selon le terme utilisé par Malm, est l’agent pathogène responsable de la fameuse sixième extinction. Nous dirons quant à nous que notre espoir d’en sortir est, hélas, inversement proportionnel à sa nécessité... Comme les précédents essais de Andreas Malm, La Chauve-souris et le capital pose des questions d’une importance cruciale. Un livre pour se défendre (l’espèce humaine non pas contre la nature, mais au sein de celle-ci, en harmonie avec elle), pour tenter d’obvier au pire – s’il en est encore temps. Car, Covid-19 ou pas, réchauffement climatique alarmant ou pas, tout semble continuer comme avant. Merdre alors ! comme dirait Zazie.
* Andreas Malm, La Chauve-souris et le capital (Corona, climate, chronic emergency, 2020), trad. Étienne Dobenesque, La Fabrique, 2020
Le Dîner d’Adam Smith
« Le libéralisme est sans doute dangereux pour la planète ; Katrine Marçal nous prouve, très sérieusement mais avec humour, qu’il l’est aussi pour les femmes », indique la quatrième de couverture de l’essai de Katrine Marçal, Le Dîner d’Adam Smith. Les choses sont claires, la journaliste ne va pas servir la soupe habituelle, comme quoi le libéralisme serait le stade ultime de développement de la société humaine. Non, le libéralisme est une voie parmi d’autres, sans doute pas la meilleure. « Le marché ne témoigne d’aucun égard. » Mais aujourd’hui, puisque, sous un nom ou sous un autre, il règne sur la planète entière, nul ou presque ne saurait en faire abstraction. Correspondante du quotidien suédois Dagens Nyheter en Grande-Bretagne, Katrine Marçal (née en 1983) explique ici que, pendant qu’Adam Smith couchait sur le papier ses thèses économiques, sa maman le choyait. La vision du monde du monsieur excluait totalement les femmes. Sans elles, sans leur travail de chaque jour, de chaque instant, l’économie telle qu’il la désignait et l’analysait n’aurait pas fonctionné. Sans leur travail de fourmi, pas d’échanges commerciaux. Pourtant, dans ses écrits, elles n’apparaissent pas. Jamais. Et aujourd’hui, le slogan « à travail égal, salaire égal », reste un objectif à atteindre, bien lointain. « Mettre au monde des bébés, élever des enfants, cultiver un potager, faire la cuisine pour la maisonnée, traire la vache de la famille, confectionner des vêtements pour ses proches ou prendre soin d’Adam Smith de sorte qu’il puisse écrire La Richesse des nations : rien de tout cela n’est comptabilisé comme une ‘activité productive’ dans les modèles économique standard. » Un essai intéressant et original, que ce livre de Katrine Marçal, intelligemment critique, voire souvent très critique, qui nous rappelle que, sauf exception, « l’homme économique n’est pas une femme ». Et que le libéralisme n’est pas automatiquement associé au bonheur de l’être humain. « Gagner de l’argent est le signe que l’on est quelqu’un de bien. C’est pourquoi il convient de baisser les impôts sur les hauts revenus. » Encore à méditer ? L’état de notre planète, humains, faune et flore confondus, donne pourtant à penser que le libéralisme est idéologie non moins homicide que d’autres. Katrine Marçal met ici les points sur les i. « On pourra toujours se raconter des histoires, mais pas échapper au fait que nous formons un tout. »
* Katrine Marçal, Le Dîner d’Adam Smith (2012), trad. Hélène Hervieu, Les Arênes, 2019
« C’est bien une idée de fille ! »

Dans « C’est bien une idée de fille ! », la journaliste Katrine Marçal (qui avait déjà publié il y a quelques années un intéressant essai, Le Dîner d’Adam Smith : sans femmes pour s’occuper de lui, le célèbre économiste aurait-il pu rédiger son œuvre ?) s’interroge sur l’origine de certaines inventions. Ainsi, commence-t-elle, pourquoi la valise à roulettes a-t-elle envahi gares et aéroports si tardivement ? Tout bêtement parce que les hommes, qui voyageaient beaucoup plus que les femmes jusqu’à une époque récente, répugnaient à se faciliter la tâche. Et quand des femmes se déplaçaient, les époux portaient leurs bagages. On est viril ou on ne l’est pas ! « Autrement dit, la résistance à laquelle se heurtait la valise à roulettes sur le marché était une affaire de sexe. » Aberrant, non ? « Les idées de notre société sur la masculinité comptent parmi les préjugés les plus obstinés, les plus enracinés... » Et nous ne sommes pas en Afghanistan ni en Syrie ! Dans ce livre, c’est toute une série d’inventions que l’auteure examine à l’aune du statut de l’homme et de celui de la femme. Pourquoi un toit aux véhicules automobiles ? Pour ne pas que les femmes qui conduisaient des voitures électriques aient leur coiffure mouillée en cas de pluie. Pour les hommes, ce n’était pas important. Comme la manivelle, qu’ils étaient capables de tourner avec suffisamment de force pour démarrer leur véhicule, quitte parfois à s’en démonter la mâchoire ! « ...Pourquoi est-on parti du principe que les hommes désiraient avoir une voiture bruyante et qui sentait mauvais ? » Au-delà des anecdotes, c’est une philosophie de l’existence qui se dégage de la suprématie masculine, ce patriarcat qui façonne nos sociétés, et qui nous a conduits à la catastrophe en cours, le réchauffement climatique. « Les partis et leaders politiques qui actuellement font des pieds et des mains pour nier l’urgence climatique se trouvent être presque toujours ceux qui veulent remettre les femmes à leur place. À leurs yeux, les deux sont liés. Maîtriser la nature relève du genre masculin, et ni la femme, ni la nature – et certainement pas Greta Thunberg – n’ont à lui dire ce qu’il peut faire ou pas. » Les conclusions de Katrine Marçal rejoignent en partie celles de Zetkin Collective dans l’essai Fascisme fossile : L’extrême droite, l’énergie, le climat. Des hommes sont prêts à user de leur pouvoir, autrement dit à mettre en branle la machine de la répression et à instaurer un État totalitaire, pour continuer à régner – cf. Trump, Poutine, Orbán, etc., etc. Ce n’est même plus en tant qu’individus jouissant d’avantages démesurés qu’ils agissent, mais en tant que membres d’une caste qu’ils estiment menacée. « Il y a un chevauchement de plus en plus manifeste entre nationalisme, antiféminisme, racisme et une résistance envers tout ce qui représente le mouvement climatique. » Les exemples fournis par Katrine Marçal sont éloquents. Dommage peut-être que dans la seconde moitié du livre elle s’égare dans des considérations socio-économiques certes justes, mais déjà rabâchées ; et dommage aussi que ses démonstrations pertinentes soient accompagnées d’une vision bien limitée de la résorption des problèmes pointés : « L’innovation et les nouvelles technologies sont des éléments clés de la solution à l’urgence climatique. » Le développement dit durable comme solution crédible ? On peut être sceptique, à l’instar de nombreux écologistes qui ne voient là que du greenwashing. Un détail, pourtant, car « C’est bien une idée de fille ! » est un livre qui a l’intérêt de présenter la question homme-femme sous un jour relativement inédit et de l’inscrire au centre même de l’agitation humaine.
* Katrine Marçal, « C’est bien une idée de fille ! » (Mother of invention : how good ideas get ignored in an economy built for men, 2020), trad. Hélène Hervieu, Autrement, 2021
Non ce n’était pas mieux avant
Il y a des livres dont la lecture fait du bien – mais est-ce une finalité, pour un livre ? Dire que le monde ne va pas si mal et que les alarmistes ont tort, pourquoi pas, mais la démarche peut être périlleuse car elle oblige à jouer avec les arguments. « Plus un pays est riche, plus il est sain », affirme le journaliste suédois Johan Norberg (né en 1973) dans son essai Non ce n’était pas mieux avant, « la quantité de richesse générée a donc un effet plus important que sa répartition », omettant de souligner que plus les richesses de ce pays sont équitablement distribuées, plus la santé de ses habitants dans leur ensemble sera bonne. À l’encontre de ses détracteurs, il reprend cette antienne, « c’était mieux avant », pour montrer combien elle est fausse. « La vérité, si nous voulons remonter dans le passé, c’est que le bon vieux temps était épouvantable. » Tout n’était pas mieux, à l’évidence, et il le prouve très bien, passant en revue des thèmes comme l’éducation, la santé, l’espérance de vie, l’alphabétisation, la violence, mais le « mieux » d’aujourd’hui se fait payer au prix fort. L’impact écologique de la croissance est indéniable et ses conséquences n’entament pas son optimisme. Johan Norberg est un libéral, un libéral convaincu, pas un réactionnaire. Il ne nie pas l’apport positif des Lumières dans notre conception du monde. Son optimum est une société démocratique – mêmes droits pour tous, culture et liberté partagées, échanges commerciaux à outrance, mondialisation. De fait, pour lui, une croissance exponentielle dans un monde qui ne peut pas grandir à sa guise n’est pas un leurre.
* Johan Norberg, Non ce n’était pas mieux avant (Progress. Ten reasons to look forward to the future, 2016), trad. de l’ang. Laurent Bury ; préf. Mathieu Laine, Plon, 2016
L’Ambition suédoise pour le développement
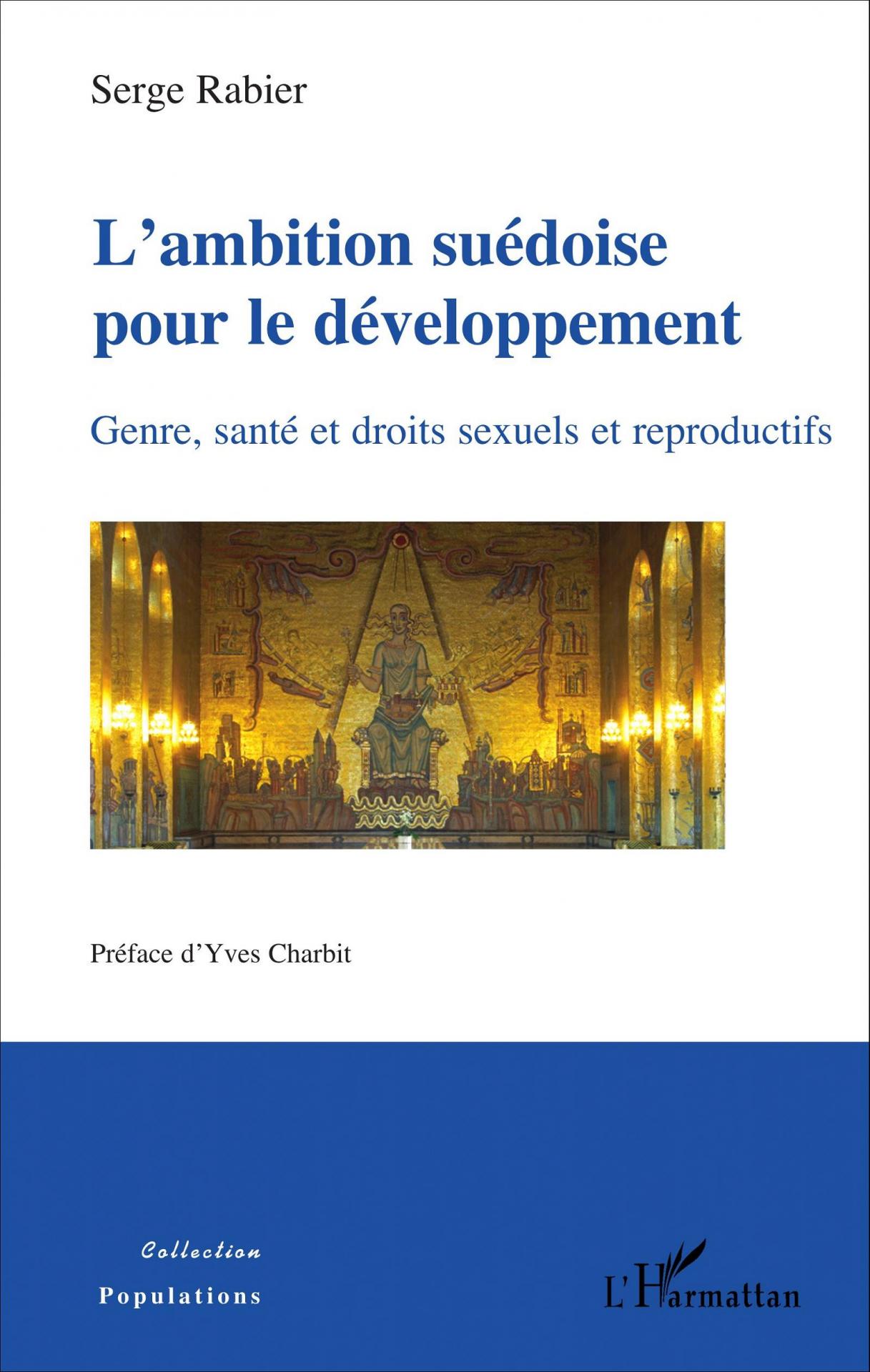
Dans cet essai qui porte en sous-titre : « Genre, santé et droits sexuels et reproductifs », Serge Rabier, diplômé, parmi diverses autres fonctions, de l’Institut d’études politiques de Paris, s’interroge sur la place du genre dans le dispositif de la Suède pour le développement. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Suède, observe-t-il, « a adapté son neutralisme traditionnel pour se positionner en tant qu’acteur jouant l’influence plus que la puissance, assumant un rôle particulier dans une conception ‘multilatérale’ de la gouvernance mondiale (et européenne) tout en choisissant des thématiques transversales (genre, biens publics mondiaux, droits humains, paix et sécurité) et des modalités et des partenaires d’interventions jusque-là ignorés ou sous-estimés, en particulier les mouvements d’ONG globaux, régionaux et nationaux. » Le résultat a été un incontestable succès, alliant développement national à tous les niveaux à une solidarité réitérée en direction des pays pauvres. Qu’en est-il aujourd’hui ? Alors que le nationalisme n’est pas du tout en berne en Europe, que l’intégrisme religieux se répand partout dans le monde, que la question de l’environnement, loin de se limiter à une hausse des températures, exige des solutions non pas État par État mais au niveau planétaire, Serge Rabier souligne que la Suède « réaffirme avec force la nécessité d’une gouvernance mondiale ». Puisse-t-elle être entendue.
* Serge Rabier, L’Ambition suédoise pour le développement (préf. Yves Charbit), L’Harmattan (Populations), 2016
Lettre à Greta Thunberg

D’un côté comme de l’autre de l’échiquier politique on s’est moqué d’elle : si jeune, si inexpérimentée, même pas une femme, une si jeune fille, atteinte du syndrome d’Asperger qui plus est, qui prétend faire la morale aux grands de ce monde... ! « ...Même dans les franges du spectre politique les plus vouées à l’horizon d’émancipation et à la question environnementale, on vous refuse le droit à la parole, soit au titre d’une connaissance qui vous ferait défaut, soit à celui de votre personne. » Sa détermination ne peut pourtant que forcer l’estime. Greta Thunberg est révoltée par l’inaction de tous et surtout des puissants face au réchauffement climatique et utilise les moyens à sa portée (la grève scolaire, la prise de parole lors d’événements internationaux) pour tenter l’impossible. Comment ne pas lui dire bravo ? C’est ce que fait Laurent de Sutter (né en 1977), professeur de théorie du droit à l’Université libre de Bruxelles, dans ce petit volume, Lettre à Greta Thunberg. « Pendant trop longtemps, nous avons considéré l’urgence climatique comme si elle était encadrée par des guillemets, alors que ces derniers n’étaient que l’alibi que nous nous donnions pour justifier notre inaction. » Greta Thunberg quitte les postures habituelles – elle se prive volontairement de ce savoir prodigué par l’institution scolaire puisqu’il ne mène qu’à une impasse : à quoi lui servira-t-il si le monde devient invivable ? On pourrait parler d’automutilation. Greta Thunberg dérange. Elle en fait trop – ou pas assez ; elle est impertinente : « Comment osez-vous ? » scande-t-elle devant les sommités étatiques, ces responsables irresponsables. Elle s’affronte, dit Laurent de Sutter, aux « représentants de la culture hyper-lettrée », qui « se satisfont très bien de ce monde actuel, puisqu’il est soit ce qui assure le confort de leur situation, soit ce qui justifie leur critique impuissante – (…) forme de rente de situation. » Elle se met beaucoup de monde à dos – n’est-il pas plus facile de l’accuser d’alarmisme que de réagir enfin au danger qu’elle dénonce ? Un petit livre utile, cette Lettre à Greta Thunberg, pour soutenir un combat indispensable.
* Laurent de Sutter, Lettre à Greta Thunberg, Seuil (Anthropocène), 2020
Le Dernier alchimiste à Paris
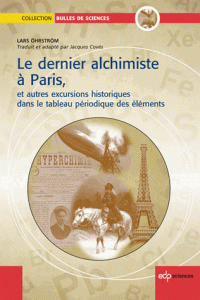
« Pour les initiés et les fanatiques, le tableau périodiques (des éléments) est une source de fascination sans fin, et pour les apprentis chimistes l’apprenant par cœur, c’est le baptême du feu. Pour le commun des mortels, il représente juste le paysage chimique où nous flânons tous », affirme Lars Öhrström (né en 1963) en préambule de son livre, Le Dernier alchimiste à Paris. Professeur de chimie inorganique à l’École polytechnique Chalmers de Göteborg, il entend, sinon simplifier les choses, tout au moins montrer que ce qui relève quasiment du langage codé pour les non-initiés (que nous sommes), est en constante interaction avec notre vie quotidienne. Il puise pour cela dans une série d’exemples concrets, souvent amusants, parfois consternants, convoquant certains de ses compatriotes, dont l’éclectique August Strindberg (c’est lui, « le dernier alchimiste à Paris » ou, tout au moins, « le dernier alchimiste célèbre »), en quête de la fabrication de l’or. Il évoque aussi la Deuxième Guerre mondiale, l’épisode de l’eau lourde et la résistance norvégienne ou nous emmène au Groenland. Abstraction faite, si l’on peut dire, des divers schémas et équations dont l’érudit Lars Öhrström parsème son texte, on a l’impression, à la lecture de cet essai brillant, d’être plongé dans un ouvrage d’espionnage. Volontiers touche-à-tout, l’auteur ne manque d’ailleurs pas de faire référence au genre, sans oublier celui du policier ou du fantastique, dès que l’occasion s’en présente.
* Lars Öhrström, Le Dernier alchimiste à Paris, et autres excursions historiques dans le tableau périodique des éléments (The Last alchemist in Paris & other curious tales from chemistry, 2013), trad. de l’ang. Jacques Covès, EDP Sciences, 2016





