U-V-W
Le Vieil homme et le chat

« Je suis médecin de formation, bardé des titres de docteur en psychiatrie et en philosophie empirique. (…) Je me considère comme un auteur. » Ainsi Nils Uddenberg (né en Suède en 1938) commence-t-il Le Vieil homme et le chat, récit (une réédition) dans lequel il explique comment un chat errant s’est installé dans son garage, puis chez lui, le choisissant pour maître. « Depuis peu, je suis propriétaire d’un chat. Enfin, je crois plutôt que c’est le chat qui me possède. » Professeur en philosophie aux universités de Lund et d’Uppsala, l’auteur a reçu le prix August pour son ouvrage Idéer om livet (Idées sur la vie), inédit en français. Ce volume-ci, Le Vieil homme et le chat, ravira les amis des bêtes. « Source inattendue de bonne humeur », l’animal prend sa place dans la famille l’air de rien. Le train-train se modifie, chacun, adulte comme enfant, se réjouit de cette présence. (Relevons, page 131, que Findus, le chat du père Pettson, est mentionné – mais dans les albums de Sven Nordqvist traduits en français ce héros est rebaptisé Picpus, ce qui aurait pu être signalé.)
* Nils Uddenberg, Le Vieil homme et le chat (Guben och katten, 2012), trad. du suédois Carine Bruy, Nami (Poche), 2024
Les Scélérats

Les Scélérats, ce recueil de neuf nouvelles de la romancière suédoise Anna Wahlenberg (1858-1933), possède un ton étonnamment moderne et bien des situations présentes ici (le recueil a initialement été publié en 1906) peuvent être transposées de nos jours. La première, « Le Testament », montre une femme « entre cinquante et soixante ans, des cheveux poivre et sel, l’air d’appartenir à la toute petite bourgeoisie » mais qui « portait les marques d’une vie de dur labeur ». Elle vient quémander sa part de l’héritage auquel elle pense avoir droit auprès de « Monsieur le Pasteur », frère du défunt. Elle était la bonne de celui-ci, sans jamais être devenue son épouse légitime. Elle ne touchera donc rien, se fait fort de lui démontrer l’homme d’église au nom de la charité chrétienne. Qu’il bénéficie de cet héritage, lui, ne saurait évidemment changer son regard, en défaveur de la veuve. Scélérat ? La nouvelle suivante, « La Nouvelle lumière », relève presque du genre policier. Ou comment une simple petite bonne manipule son couple d’employeurs... ! « ...Pouvait-on vraiment se réjouir de reprendre confiance en soi aux dépens de la confiance qu’on pouvait accorder aux autres ? » Puis « La Cure d’isolement », qui évoque nos dealers d’aujourd’hui. Les diverses formes de mystification apparaissent dans plusieurs nouvelles (ainsi « Algot Stare » ou « ‘Chère Tantine’ »), donnant à voir un affrontement larvé entre classe privilégiée et classe laborieuse. La première, pétrie de certitudes, est vite abusée car « ...ces gens-là, très infatués d’eux-mêmes, étaient de ceux qui se croient entourés d’imbéciles et de poules mouillées. » Romancière, nouvelliste et auteure de drames et de livres pour la jeunesse, partisane de l’autonomie financière des femmes, Anna Wahlenberg ne brandit pas de drapeau. Mais, pince-sans-rire de talent, elle donne l’occasion aux lecteurs de comprendre les situations, parfois à l’avantage des plus faibles – qui ne sont pas toujours les plus stupides. Son œuvre s’inscrit dans le courant défendu par Georg Brandes à la fin du XIXe siècle, une littérature au ton moderne et à l’esprit contestataire. Bien que, observons-le, Anne Wahlenberg flirte souvent avec une vision conservatrice – les lois sont les mêmes pour tous et doivent être appliquées à la lettre. Et de fait, on ne vole pas, même quand on a faim, on ne cherche pas à se venger, même quand on a été frappé ou victime d’une injustice. Que les travailleurs du bas de l’échelle sociale soient rigoureusement punis lorsqu’ils tentent de profiter des richesses des nantis ne la dérange pas. Où irait le monde, si les pauvres se mettaient à tromper les riches ? (« Entre les mains de la justice ») Les classes sociales doivent rester à leur place – au mieux, les plus riches peuvent-ils faire un geste de mansuétude en direction des malheureux : « ...Elle éprouva un désir ardent de faire quelque chose pour atténuer le poids qui pesait sur les épaules de cette pauvre petite qui n’était pas à la bonne place sur cette terre. » (« Le Flacon compte-gouttes ») Éventuellement convient-il de dénoncer l’activité des créanciers, usuriers et autres huissiers. (« Le Père Mårtensson ») Issue d’un milieu bourgeois, Anna Wahlenberg ne rompt pas avec la pensée de sa classe ; mais comme en France une George Sand ou un Balzac, elle parvient et peut-être quelque peu malgré elle à en exposer l’intrinsèque perversité, d’autant que sa plume sait faire monter la tension jusqu’au suspens et que toutes ces nouvelles sont très bien construites. Encore une belle découverte éditoriale, dont on ne peut que remercier Vincent Dulac, traducteur et éditeur.
* Anna Wahlenberg, Les Scélérats (Förbrytare : skildringar, 1906), trad. Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2022
Le Trésor de Monsieur Isakowitz

Suédois d’origine juive polonaise, Danny Wattin (né en 1973) relate, dans Le Trésor de Monsieur Isakowitz, le voyage effectué en compagnie de son fils et de son père sur la terre de leurs aïeux. Ainsi est présenté ce roman : comme autobiographique. À en croire l’histoire familiale, le grand-père de l’auteur, vendeur de vêtements, aurait enterré un trésor au pied d’un arbre en Pologne, lors de la Deuxième Guerre mondiale. « …Trois générations d’hommes – moi, mon fils et mon père – effectueraient des recherches sur les origines de notre famille. Ce serait une thérapie. Un voyage sous le signe de la compréhension. » Mais mettre le pied en Pologne ravive bien des craintes pour le père de Danny – grand-père de Léo. Quel confort dans les chambres d’hôtel ? Dormir dans une voiture, en Pologne, n’est-ce pas prendre le risque de « se faire égorger » ? Les Polonais sont-ils tous antisémites ? Danny Wattin profite de ce road trip pour retracer l’histoire des siens. On peut songer au livre de Göran Rosenberg, Une brève halte après Auschwitz. Mais les deux livres diffèrent, en dépit de la gravité de leur propos. Le roman de Danny Wattin se veut en effet plus léger, il convoque régulièrement l’humour pour rappeler l’Histoire : l’histoire familiale qui se mêle à la grande Histoire. Les souffrances des uns et des autres en Pologne, l’arrivée des Allemands, l’exil, pour ceux qui le peuvent. La Suède, terre d’accueil ? Il fait froid dans ce pays et certains réfugiés noircissent exagérément le tableau. « De nombreux Suédois étaient ouvertement nazis. Ils trouvaient Hitler très bien. Et beaucoup de gens faisaient des affaires avec les Allemands. Les autres ne comprenaient rien. » Mais finalement, la neutralité affichée de la Suède profite aux réfugiés. Le Trésor de Monsieur Isakowitz hésite entre divers genres (essai, autobiographie, mais peu roman) et l’alternance de propos durs (à commencer par l’extermination d’un peuple) et de choses bien plus futiles (les flatulences du fils) ne convainc pas. Avec Le Trésor de Monsieur Isakowitz, l’auteur nous semble avoir quelque peu raté son objectif qui était, comme il le consigne à la fin de l’ouvrage, « de raconter l’histoire de (ses) grands-parents et de leurs amis, qui fuirent l’Allemagne pour échapper à la Shoah ». Un livre touchant, certes, mais inachevé, peut-être. Dommage, avec un tel sujet, d’autant que les autres ouvrages de Dany Wattin (non traduits en français) ne semblent pas inintéressants.
* Danny Wattin, Le Trésor de Monsieur Isakowitz (Herr Isakowitz skatt, 2014), trad. Laurence Menerich, Presses de la Cité, 2015
La Fille du Hälsingland (Destinée suédoise, 1)

Le personnel de maison, ce personnel dit domestique, a inspiré un certain nombre d’écrivains. Parmi d’autres ouvrages, on peut penser au célèbre Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau ou au Cocher du Boiroux de Michel Ragon. La Fille du Hälsingland, premier volume d’une « saga » (Destinée suédoise) annoncée de Katarina Widholm, s’inscrit dans cette lignée, insistant cependant beaucoup plus sur la sortie de Betty, l’héroïne, de sa condition d’employée sous-considérée. L’abondance de détails sur son travail est vraiment à mettre à l’actif de l’auteure et permet de comprendre sa dureté au quotidien. Septembre 1937, Hudiksvall. Si Betty, dix-sept ans, a le cœur gros de quitter les siens, elle se réjouit de partir pour Stockholm où une place de femme de chambre chez un médecin lui est proposée. La capitale lui permettra-t-elle de s’émanciper ? Elle l’espère, elle qui adore lire et n’aspire qu’à une vie banale de travailleuse. L’homme semble aimable, sa femme, en revanche, est une vraie vipère. Et Betty va bientôt s’apercevoir que le couple a des sympathies nazies très affirmées. « ...Elle avait rarement vu des sous-vêtements d’une saleté aussi répugnante que celle de ses patrons. Il était difficile d’imaginer que des gens aussi raffinés s’essuient aussi mal quand ils se rendaient aux toilettes. » Idéologie puante et prétendues bonnes manières... ! Mais c’est elle, Betty, qui est accusée : « N’avez-vous aucune éducation ? » lui lance sa maîtresse parce qu’elle ignore (on ne le lui a pas dit) où faire la lessive. « Une femme narcissique bouffie d’orgueil et un nazi geignard et stupide... » Heureusement, Betty est amie avec Viola, une femme de chambre à peine plus âgée qu’elle, qui exerce à proximité. Et surtout, elle a fait connaissance durant son trajet en train avec sa tante Helmi d’un homme séduisant qui lui conseille des lectures. Martin devient son fiancé et son amant, il est même le père de son enfant à naître. Mais il est juif et disparaît, apparemment, dans les tourments de l’histoire. Betty se retrouve enceinte, seule, expulsée de chez ses employeurs. Unique solution : épouser Carl-Axel, leur fils, homosexuel, qui peut ainsi prétendre fonder une famille et récupérer l’entreprise de son oncle. Ce dernier, Mauritz, est un démocrate ; ravi du goût pour la lecture de Betty, il lui donne des manuscrits à lire et à annoter. Publié chez un éditeur plutôt porté sur les romances dites féminines, et visant de fait des lectrices plus que des lecteurs, ce roman est plutôt intéressant. Bien construit, sa narration linéaire nous entraîne dans la Suède des années d’avant-Seconde Guerre mondiale, dans deux milieux sociaux fort différents et cependant complémentaires : celui d’un prolétariat corvéable presque à merci, les employées de maison, et celui des employeurs, patrons ou avocats et autres gens de biens, pour qui les « petites gens » sont à leurs yeux quasiment invisibles. Betty, le personnage principal, accepte ce qui semble être son sort sans tenter de se révolter – comment le pourrait-elle ? se dit-elle –, avant, poussée par les événements, de lentement prendre en main les rênes de sa vie. Elle lit autant qu’elle le peut et fréquente les bibliothèques, notamment la superbe bibliothèque municipale de Stockholm : « Des rangées d’étagères disposées dans un jardin de lumière circulaire. (...) Il flottait une divine odeur de papier. » Peu encline à se mêler de politique, elle sympathise cependant avec une responsable syndicale qui la prend brièvement sous son aile. « Il est naturel de s’entraider », lui dit celle-ci. « Tu m’aideras à ton tour si l’occasion se présente, ou tu rendras service à quelqu’un d’autre pour nous remercier. » On peut reprocher au roman de Katarina Widholm (née en 1961 dans le Hälsingland et d’abord auteure de livres pour la jeunesse) d’être un peu trop gentillet, tout se passe peut-être un peu trop bien pour Betty (« Fais attention, ma fille, à ne pas laisser l’orgueil te monter à la tête », la prévient tout de même sa tante, très respectueuse des règles sociales), quoi que... Mais on attend évidemment la suite avec impatience, devinant que derrière les pièces du puzzle qui se met en place se cachent sans doute ce que nous pourrions appeler les aspects sombres de l’âme humaine. « J’essaie juste de survivre », explique Betty.
* Katarina Widholm, La Fille du Hälsingland (Destinée suédoise, 1) (Räkna hjärtslag, 2021), trad. du suédois Carine Bruy, HarperCollins (Au gré du monde), 2024
La Nouvelle vie de Betty (Destinée suédoise, 2)

Nous sommes à présent en 1942, Betty Molander travaille pour une maison d’édition, sous l’aile bienveillante de « tonton Mauritz » qui la considère comme sa fille. La guerre fait rage en Europe mais la Suède affiche sa neutralité. Son époux, Carl-Axel, boit, joue et fréquente de sales individus, dilapidant ses deniers et les économies de Betty, mais également celles, dissimulées dans une tirelire, de leur fille Martina. Son brusque décès, un suicide camouflé en accident, ne peine guère ses proches à l’exception de Louise, sa mère. Betty se retrouve seule à élever sa fille, en réalité l’enfant de Martin Fischer, son amour disparu. Jeune, intelligente, jolie, capable de forcer le destin, elle suscite des jalousies, ce dont elle s’accommode malgré elle, et les sentiments de son beau-père, qui les lui avoue et la contraint à se donner à lui. Ainsi, autour d’elle, certains sont prêts à lui venir en aide sans retenue, tandis que d’autres entendent profiter de ses faiblesses. Ce deuxième volume de Destinée suédoise met quelque peu à l’écart l’aspect professionnel du personnel de maison, et pour cause, puisque l’héroïne a changé de monde. Mais si elle figure maintenant dans la petite bourgeoisie de Stockholm, elle refuse cependant de faire appel à du personnel domestique : « Ça tient aux tâches à accomplir en elles-mêmes. Ramasser les affaires des autres, faire la lessive, nettoyer les toilettes d’étrangers, changer leurs draps souillés, essuyer des miroirs constellés de taches... » Elle estime que c’est humiliant. « L’employée de maison (…) n’a pas le choix. Pas par amour, mais par devoir. C’est ça qui est problématique entre les maîtres et les domestiques. » L’intrigue est bien ficelée, trop peut-être car à diverses reprises tout s’arrange quelque peu miraculeusement pour Betty. Vaillante, elle surmonte les épreuves les unes après les autres, finissant par retrouver Martin, qui enseigne à Gävle et est aujourd’hui époux et père. Échec. Le temps a passé. Elle se sent seule, quel homme peut s’attacher à une femme aussi indépendante, aussi capable ? La Nouvelle vie de Betty relève beaucoup plus du feel good book que le précédent volume. Tout est trop beau. C’est un peu dommage car ce roman est informatif, il présente bien la Suède de l’époque. « J’aimerais pouvoir faire mes courses sans coupons de rationnement, boire un verre au restaurant le soir et mettre des moustiquaires aux fenêtres l’été au lieu de rideaux occultants. Et à nouveau manger des oranges ! », songe tout haut Viola, l’ami de Betty. La guerre se terminera-t-elle bientôt ? Vite, la suite.
* Katarina Widholm, La Nouvelle vie de Betty (Destinée suédoise, 2) (Värma händer, 2022), trad. du suédois Carine Bruy, HarperCollins (Au gré du monde), 2024
La Ritournelle des rêves (Destinée suédoise, 3)

Après La Fille du Hälsingland et La Nouvelle vie de Betty, voici donc le troisième volume de la saga Destinée suédoise de Katarina Widholm : La Ritournelle des rêves. Nous sommes en 1949 et Betty, qui adore lire, fête ses trente ans. À la tête maintenant d’une librairie et d’une maison d’édition, elle est mariée avec Olof et a deux enfants, Martina (fille de Martin, son premier amour), onze ans, et Anders (fils de Olof), quatre. C’est elle qui fait largement tourner le ménage, toujours présente dans la cuisine à peaufiner de bons petits plats, comme lorsqu’elle n’était qu’une femme de chambre, toujours à suppléer aux manquements des uns et des autres. Betty « s’occupait donc toute seule des courses, de la lessive, de la préparation des repas et de la vaisselle... » Katarina Widholm expose les multiples tâches auxquelles se livre son héroïne, une femme finalement comme beaucoup d’autres, qui n’arrête jamais de travailler. « Betty secoua la tête en riant et en vidant l’eau de la casserole des pommes de terre pour qu’elles s’égouttent. Elle sortit le gratin de chou-fleur du four, et le délicieux fumet envahit la cuisine. Il ne lui restait plus qu’à préparer les steaks et à sortir la confiture d’airelles, et le repas serait prêt. » Et ainsi de suite. Betty est toujours sur le pont, d’une bonne volonté qui quelquefois désarçonne. Remarquons le nombre d’auteurs mentionnés dans ce roman, de Stieg Trenter à Maria Lang, de Moa Martinsson à Wilhelm Moberg (La Saga des émigrants) et à Astrid Lindgren : « Fifi (Pippi) prend toujours le parti des plus faibles ». Personnage attachant, Betty s’efforce de faire le bien autour d’elle, quitte à importuner son frère Pelle avec ses conseils ou son mari Olof, « socialiste et défenseur des travailleurs », qui ne voient pas toujours ses efforts d’un bon œil. Heureusement, Anders lui dit « quand je serai grand, maman, je serai comme Fifi Brindacier ». Ce troisième volume de Destinée suédoise est de nouveau une réussite. Katarina Widholm entraîne les lecteurs au sein même d’une famille ni très riche ni très pauvre, assez représentative de la Suède de cette époque, quand tout marchait plutôt bien. Le travail souvent éreintant et sans guère de droits du personnel de maison est une nouvelle fois mis en avant. Si tout ne se passe pas toujours comme elle le souhaite, Betty parvient à s’en sortir quelles que soient les embûches et sans doute le lecteur peut-il estimer que les faits réels ne sont hélas jamais aussi positifs. Une très bonne série, toutefois, qui évite les pièges du genre (non, sa lecture n’est pas l’apanage des seules femmes), avec un quatrième titre d’ores et déjà annoncé (Les Choix de Betty).
* Katarina Widholm, La Ritournelle des rêves (Destinée suédoise, 3) (Käraste vänner, 2023), trad. du suédois Carine Bruy, HarperCollins (Au gré du monde), 2024
Le Dernier choix de Betty (Destinée suédoise, 4)
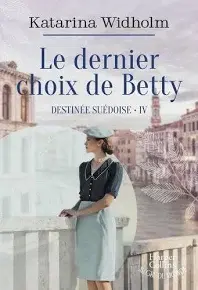
Nous sommes maintenant en 1955. Olof est mort et Betty élève seule ses deux enfants, Anders et Martina. Si ce n’est pas toujours facile, elle y parvient, le tempérament ne lui manque pas. Elle a abandonné sa maison d’édition mais tient toujours sa librairie au cœur de Stockholm, ce qui lui laisse peu de temps pour s’occuper de son foyer. « Elle avait enfin réussi à finir la vaisselle et à tout ranger. Une pâte allait passer la nuit à lever dans le garde-manger, et elle avait lavé à la main et accroché quelques vêtements dans la salle de bains. Les enfants se trouvaient chacun dans leur chambre, et elle leur avait demandé de ne pas lire trop longtemps. » Âgée d’à peine plus d’une trentaine d’années, elle a de plus en plus l’impression de passer à côté des choses importantes. Doit-elle, comme son ami Georg le lui conseille, renouer avec Martin, son amour de jeunesse et le père de Martina, le seul véritable amour de sa vie ? Ses ex-beaux-parents, naguère ses honteux employeurs, la couvrent de biens, sans oublier Martina et Anders. Le docteur Alex Molander lui fait part de son amour pour elle... ! Un sale bonhomme, prêt aujourd’hui, son épouse décédée, à l’épouser pour lui laisser son héritage. « Était-elle si sûre de n’éprouver que du dégoût et de la haine pour lui ? Du mépris et de l’écœurement ? » Les sentiments que Betty cherche à contenir sont complexes, voire contradictoires. Idem avec Martin, qu’elle aime toujours. Ce volume (le quatrième d’une trilogie... !) vient donc clore la passionnante odyssée de Betty au cours du XXe siècle. Dommage que les atermoiements et les grands sentiments abondent ici, trop c’est trop ! Quant au portrait de Martina... Disons que la jeune fille, qui ne manque certes pas de talent, peut-être future chanteuse lyrique, est une véritable enfant gâtée, que ses deux parents (Martin est de retour) cajolent à outrance. Réserves minimes : cette Destinée suédoise est un plaisir de lecture. Comme le dit justement Matin, par ailleurs « professeur de littérature », « la lecture doit aussi être source de détente ». Mais trois volumes suffisaient !
* Katarina Widholm, Le Dernier choix de Betty (Destinée suédoise, 4) (Äskalde Betty, 2024), trad. du suédois Carine Bruy, HarperCollins (Au gré du monde), 2024
La Mort moderne
Entre la réflexion prospective et le complotisme, il y a un monde, dans lequel prend place cet intelligent roman – presque un essai – de Carl-Henning Wijkmark (1934-2020), La Mort moderne. Publié en France pour la troisième fois (un record pour ce type d’ouvrage), il est plus que jamais d’actualité, à l’heure où le coût des vaccins anti-Covid 19 pose la question du choix, s’il doit y avoir choix, des patients à traiter en priorité. Il part d’une idée simple : puisque nous naissons tous au même âge, ne pourrions-nous pas mourir également au même âge ? Quelque part dans le sud de la Suède, des responsables du monde médical et des experts politiques, sociaux et économiques se réunissent pour aborder, sans crainte de cynisme, le coût de la fin de vie. Toutes les vies sont-elles équivalentes ? « L’un est un arriéré mental, l’autre un prix Nobel. » Qui soigner en priorité ? Voici la première question qu’ils se posent, tentant, ou le prétendant, de ménager humanisme, considérations économiques et prestige social. Le but affiché est « la mise en condition psychologique des personnes âgées, afin qu’elles décident elles-mêmes d’en finir ». À la lecture de ce livre, il n’est pas interdit de songer au célèbre film Soleil vert (1973) de Richard Fleischer. Les thèmes sont proches, au-delà de la question de l’euthanasie. L’hypocrisie de nos sociétés démocratiques contemporaines, ici mise en exergue, pour lesquelles les vies ne se valent que sur le papier, laisse au lecteur, même s’il le savait déjà, un goût sacrément amer.
* Carl-Henning Wijkmark, La Mort moderne (Den moderna döden, 1978 ; postface inédite), trad. Philippe Bouquet, Rivages, 2020
Les Amants polyglottes

Roman assez fou que nous propose Lina Wolff, avec Les Amants polyglottes. Ellinor, la narratrice, conte au lecteur ses aventures sexuelles – ou non, selon affinités. Si elle ne s’étend pas sur les détails, elle présente en revanche les divers candidats, tous, un peu, beaucoup siphonnés. Le ton est rapide, les anecdotes s’accumulent, sans apporter grand-chose au lecteur. Ellinor, « un vrai thon », tombe d’abord amoureuse de Johnny, qui l’initie au combat au corps-à-corps, puis elle fait la connaissance d’un critique littéraire obèse, Calisto Rondas, dont elle s’éprend. Mais, sur un coup de colère, elle brûle le manuscrit qu’il détenait, ce roman justement intitulé Les Amants polyglottes, que Max Lamas, un écrivain qu’il adule, lui avait confié. Max Lamas apparaît alors et explique sa quête des femmes, au centre de son écriture. « - Écrire c’est une chose. Soigner en est une autre. - On peut guérir par la lecture. - À condition de trouver le bon livre… » Max Lamas s’était épris de Mildred Rondas, l’épouse aveugle et au physique superbe de Calisto. Et puis, ça repart avec… un personnage féminin nommé Lucrezia Latini Orsi. Une intrigue vite lassante, un questionnement futile ou pédant, des personnages prétentieux. Quel micmac sans grand intérêt ! « Le problème, c’est que si l’on veut écrire une histoire, il n’y a qu’un seul point de vue neutre, c’est celui de l’homme blanc, hétérosexuel. Pour prendre une image, c’est le seul papier qui ne soit pas coloré par avance. » Ah ? Serait-ce de l’ironie ? Difficile de dire que nous avons été séduit par ce roman, le second de Lina Wolff (née en 1973 et traductrice) et le premier traduit en français, qui se veut « houellebecquien » et peut-être est-ce le cas. Mais ce n’est en rien une qualité en soi, nous semble-t-il, que d’énoncer des platitudes ou des contrevérités et de les enrober dans une sexualité sans attrait, afin de jouir de la reconnaissance surfaite d’un public en mal de soubresauts littéraires… La lecture de ce roman terminée, un seul cri nous vient : ouf !
* Lina Wolff, Les Amants polyglottes (De Polyglotta älskarna, 2016), trad. Anna Gibson, Gallimard (Du monde entier, 2018)
Bret Easton Ellis et les autres chiens
Qui est vraiment Alba Cambó ? Une écrivaine ? Araceli, étudiante traductrice qui vit avec sa mère, l’observe – la surveille même. Alba habite à l’étage du dessous de ce vieil immeuble de Barcelone. Araceli relate ici la vie dans ses détails d’une inconnue qui peu à peu est percée à jour. « Les premiers temps, il nous fut donc difficile de nous faire une opinion sur Alba Cambó. D’un autre côté, son plafond était notre plancher, nos vies n’étaient séparées que par l’épaisseur d’une poutre... » Lina Wolff avait déjà publié Les Amants polyglottes. Qui ne nous avait pas transporté. Elle récidive, autrement, mais toujours avec un foisonnement de vies diverses. Quelle ligne directrice ? Tout s’imbrique mais l’ensemble paraît bien artificiel. Nous demeurons sceptique.
* Lina Wolff, Bret Easton Ellis et les autres chiens (Bret Easton Ellis och de andra hundarna, 2013), trad. Anna Gibson, Gallimard (Du monde entier), 2019
La Ligue de Norrtull
Premier volume publié de Elin Wägner (1882-1949), La Ligue de Norrtull, « classique du roman d’employées de bureau » selon un journaliste des années 1930, est un journal tenu par une jeune femme, à Stockholm, au tout début du XXe siècle. On ne trouvait en français, de Elin Wägner, qu’un roman, épuisé depuis longtemps : Les Hirondelles volent haut (1950), ainsi qu’un essai biographique sur Selma Lagerlöf. Excellente idée, donc, d’éditer La Ligue de Norrtull, d’abord publié en feuilleton dans le quotidien Dagens Nyheter, d’autant que les notes accompagnant le texte sont nombreuses et l’éclaircissent toujours avec érudition. Si l’on parle de littérature prolétarienne, genre dans lequel la Suède a excellé, ce texte est sans doute l’un des plus vivants, des plus frais pourrait-on dire, parmi ceux qui en relèvent. Quatre jeunes femmes de condition modeste décident de partager un appartement, Norrtullsgatan, au pied de l’Observatoire, et vont se faire part de leur découverte (amoureuse, professionnelle et autre) de la vie : « Les choses ne se font pas comme on les imagine ! » Notons, dans la revue Nordiques (n°38, 2019), un long article de Lise Froger-Olsson : « Elin Wägner, une pionnière de la prise de conscience écologique ». Car, en effet, par la trentaine de livres qu’elle a publiés, l’écrivaine s’engagea en faveur de différentes causes : celle des femmes (et notamment leur droit de vote et l’égalité homme-femme), le pacifisme, la protection de la nature. Sa voix est l’une des premières à prévenir du danger d’exploiter inconsidérément l’environnement. La publication de cet ouvrage, La Ligue de Norrtull, prouve, s’il en était besoin, que la littérature prolétarienne n’est pas l’apanage des hommes, pas plus que la lutte écologique – ou politique. La Ligue de Norrtull ? « Un refuge à la fois pauvre et imparfait, qui apportait tout de même une protection contre le monde, où des personnes solitaires étaient venues chercher du réconfort auprès d’autres personnes plus solitaires encore. »
* Elin Wägner, La Ligue de Norrtull (Norrtullsligan, Elisabeths krönika, 1908), traduction et annotation Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2020
Babetta

Les pages se tournent rapidement, Nina Wähä sait conter l’histoire de cette amitié entre Katja et Lou, deux jeunes femmes qui ont fait connaissance durant leurs cours de théâtre dans un lycée de Stockholm. Aujourd’hui, Lou est une star du cinéma, notamment après son rôle-phare dans Babetta, « tableau de la Hongrie historique », un film en costumes, un grand succès. Katja demeure sa meilleure amie. N’est-ce pas celle-ci, par ses conseils avisés, qui a permis à Lou d’être sélectionnée lors d’un casting ? Lou, si belle, si capable de tout... qui vit aujourd’hui dans une luxueuse villa du sud de la France, avec le richissime Renaud, photographe, petit ami deux fois plus âgé qu’elle, pour qui le monde entier n’est qu’un objet à consommer. Un jour, Lou invite Katja à séjourner là. Pour quelle raison ? Juste pour renouer une amitié qui s’est un peu relâchée ? s’interroge Katja. « Peut-être est-ce aussi simple que ça. Une amie vous manque, vous lui demandez de venir. Mais plutôt que mon absence, n’est-ce pas plutôt un vide, l’absence de tout le reste, qu’elle voulait combler ? » La relation entre les deux femmes est déséquilibrée. Sont-elles vraiment toujours amies ? Sœurs ? Amoureuses l’une de l’autre ? La relation entre elles est complexe, d’autant que Renaud abuse sexuellement de Katja. La tension monte imperceptiblement. Après Au nom des miens, roman dense qui l’avait propulsée sur la scène littéraire suédoise, Nina Wähä récidive avec Babetta. Roman complètement différent, quoi que les liens entre les individus soient au centre de l’un et de l’autre ; roman qui montre que l’auteure est en train d’écrire une véritable œuvre.
* Nina Wähä, Babetta (Babetta, 2022), trad. du suédois Anne Postel, Robert Laffont (Pavillons), 2024
Au nom des miens

« Parfois les journées se succèdent, les années aussi, sans qu’il se produise grand-chose. La vie passe, tout simplement, et l’on flotte avec elle, on est satisfait, assez pour rester. Et puis, soudain, comme ce jour-là, tout semble survenir d’un seul coup. » Douze (plus deux, décédés en bas âge) frères et sœurs et les parents, autrement dit une famille en Tornédalie finlandaise, les Toimi (le patronyme signifie « fonctionnel » !), sont au centre de ce roman de Nina Wähä, Au nom des miens. Ce best-seller, en Suède, de cinq cents pages, est une saga, parfois pas très loin de l’étude anthropologique, qui prend la région de Tornio et le nord de la Finlande pour cadre. « Dans le Norrland, la nature impose le respect, c’est un élément dont on ne peut faire abstraction. » Années 1980. Dans une exploitation agricole, Pentti, le père, se conduit comme un tyran domestique, avant de carrément sombrer dans la folie. Ses enfants ont peur de lui ; Siri, son épouse, a pris son parti de son malheur. Mais un jour, les enfants et leur mère décident de réagir : elle va demander le divorce. « Même pour Siri, il y a des bornes à ne pas dépasser. » Coup dur, pour le père, qui n’a pas l’habitude d’être contredit. Il est évincé, perd ce qui était sa maison, laquelle brûle. Incendie volontaire ? Autrement dit, assassinat ? Quand tout le monde s’en porte mieux, pourquoi pas. « Dieu accomplit enfin une bonne action. Enfin, le Bon Dieu, on s’en fout. Appelons ça... l’univers. C’est l’univers qui essaie d’arranger les choses, pour une fois. » L’émancipation des femmes est au cœur de ce roman : celle de Siri, bien entendu, après une vie de soumission ; celle d’Annie, l’aînée de la fratrie, qui vit à présent à Stockholm et attend un enfant ; de Helmi, qui aimerait profiter de la vie mais que la maladie rattrape ; de Lahja, qui se débarrasse vite fait bien fait de son lourdaud de petit ami. L’émancipation des femmes et aussi celle des hommes, car devant un personnage comme Pentti, tous sont logés à la même enseigne et les problèmes psychiques les frappent. Née à Stockholm en 1979, actrice, chanteuse, Nina Wähä signe un roman déconcertant et séduisant (que l’on pourrait rapprocher, hasard des parutions, au roman intitulé Résine, de Anne Riel, sorti récemment ; ou encore à Comment cuire un ours, de Mikael Niemi). Seule réserve, cette référence à l’astrologie, mentionnée comme une science exacte ! « Le Bélier est un signe de feu... Il y a évidemment de grandes différences d’une personne à l’autre, comme pour tous les signes astrologiques... » Pas de Dieu ici, au pays de Lars Levi Læstadius, mais les astres et les étoiles pour guider la vie. Un détail, cependant, car Au nom des miens est un roman qui fera date, sur une région excentrée de l’Europe, à cheval entre contemporanéité et poids du passé.
* Nina Wähä, Au nom des miens (Testamente, 2019), trad. Anna Postel, Robert Laffont (Pavillons), 2021


