E-F
Les Princes de l’étang aux Finnois

Norvège, milieu des années 1980. Oslo. Au lycée, Filip rêve d’une carrière artistique. Quelque peu décousue, sa famille est dirigée par le « Vieux », le grand-père Arnstein. De l’autre côté du jardin, il y a Truls, le frère cadet dudit Arnstein, ils ne se parlent plus. À la maison : la mère, aujourd’hui alcoolo, et le « Chef », le père. Filip, qui souffre dans ce milieu, « a souvent l’impression que sa manie du dessin est une tare. Un défaut qu’on tolère en attendant un projet plus réaliste. On espère sans doute que ça lui passera. » Le roman de Lars Elling, Les Princes de l’étang aux Finnois, oscille entre la période quasi-contemporaine, avec Filip et ses espoirs, et le début du XXe siècle, plus précisément l’été 1914, quand « la chaleur bat des records » comme si la paix allait bientôt n’être plus qu’un souvenir. Arnstein et Truls sont enfants, sous l’autorité d’un père, dit le « Kaiser » à cause de ses moustaches. Pour lui « la discipline allemande, le sens du sacrifice, la culture générale et l’esprit de corps, alliés à une connaissance et un respect profonds des lois de la nature, constituent le fondement de l’éducation qu’il dispense à ses fils ». Complices, Arstein et Truls grandissent en profitant des bienfaits d’une nature omniprésente, parfois accompagné de « Totem », Tom Even, leur aîné qui n’a pas toute sa tête et dont la disparition tragique entraîne la dislocation définitive de la connivence des aînés. Lars Elling (né en 1966, artiste peintre qui expose à Oslo et à New York, auteur de livres pour enfants) distille les anecdotes comme autant de souvenirs heureux d’un temps irrémédiablement disparu. Les efforts toujours recommencés du jeune Filip pour accéder au monde de l’art ne peuvent que toucher les lecteurs : ce ne serait pas mal d’inventer une « machine à air » pour conserver les souvenirs, se dit-il ! À défaut, il y a les riches descriptions de la nature dont ce roman est parsemé.
* Lars Elling, Les Princes de l’étang aux Finnois (Fyrstene av finntjern, 2022), trad. du norvégien Françoise & Marina Heide, Gallmeister (Fiction), 2024
Je refuse d’y penser
Hedda Møller, trente-trois « bibliques années », est enceinte. Elle a la ferme intention d’avorter au plus vite. Mais elle a beau vivre en Norvège aujourd’hui, ce n’est pas aussi simple qu’elle le pensait. Le médecin consulté lui demande de revenir, trois jours de réflexion sont nécessaires, et avec les jours non-ouvrés, le délai est doublé. Elle pourrait se débrouiller seule, Internet offre quantité de remèdes, mais ne préfère pas. Journaliste et essayiste, Lotta Elstad (née en 1982), livre avec Je refuse d’y penser un roman qui s’inscrit dans l’air du temps, un peu trop parfois car usant d’un vocabulaire très à la mode ; certaines pages (rien moins que la première moitié de l’ouvrage), truffées de noms propres et d’anglicismes, sont proprement indigestes. L’héroïne, piètre héroïne, gardera-t-elle ou non cet enfant non désiré, dont le volubile papa a été lui aussi un enfant qui n’aurait « jamais dû naître » ?
* Lotta Elstad, Je refuse d’y penser (Jeg nekter å tenke, 2017), trad. Aude Pasquier, La Belle étoile/Marabout, 2019
Une Pièce à soi

« On pouvait dire bien des choses d’Anna Louisa mais pas qu’elle était un génie artistique. » Un important lot de toiles lui revient pourtant à la mort de son père, des croûtes d’un peintre suédois devenu aveugle et dont l’heure de gloire est passée depuis longtemps. Professeure émérite de philosophie aujourd’hui à la retraite, Ana Louisa Millisdotter, soixante-dix ans, habite dans son grand appartement au cœur d’Oslo avec un certain Harold. Deux cent cinquante mètres carrés, qu’ils se partagent. Ils vivent ensemble depuis près de quinze ans tout en ignorant à peu près tout l’un de l’autre. Jusqu’à sa fin, Harold s’interrogera en secret sur « l’être indolent qu’elle était ». Quant à elle, « elle ne le connaissait absolument pas ». Bien que les approches soient largement différentes, on peut penser au récent roman de Vigdis Hjorth, Une Maison en Norvège, pour le cadre (un lieu à soi) et les questions que celui-ci suscitent. Ici, Anna Louisa observe tout du spectacle de la rue, autrement dit les multiples petits faits du quotidien, du haut de son logement. Après avoir hérité de son père d’un premier appartement, elle a pu faire l’acquisition de celui voisin, pour n’en faire plus qu’un, grâce à une valise pleine de coupures récupérée à Londres. Que le fils de son colocataire (sûrement pas son compagnon, se récrie-t-elle), l’aide à blanchir, en quelque sorte. Une Pièce à soi (le deuxième ouvrage de Lotta Elstad traduit en français, après Je refuse d’y penser, 2019), est un roman guilleret, riche de petites remarques que le lecteur peut facilement faire siennes. Difficile d’y voir « une implacable satire féministe » comme indiqué sur le rabat de la couverture (parce que le rôle principal est tenu par une femme ?), mais Anna Louisa ne s’en laisse pas conter, c’est sûr.
* Lotta Elstad, Une Pièce à soi (Et eget rom, 2014), trad. Aude Pasquier, Marabout (La Belle étoile), 2021
Inféodée
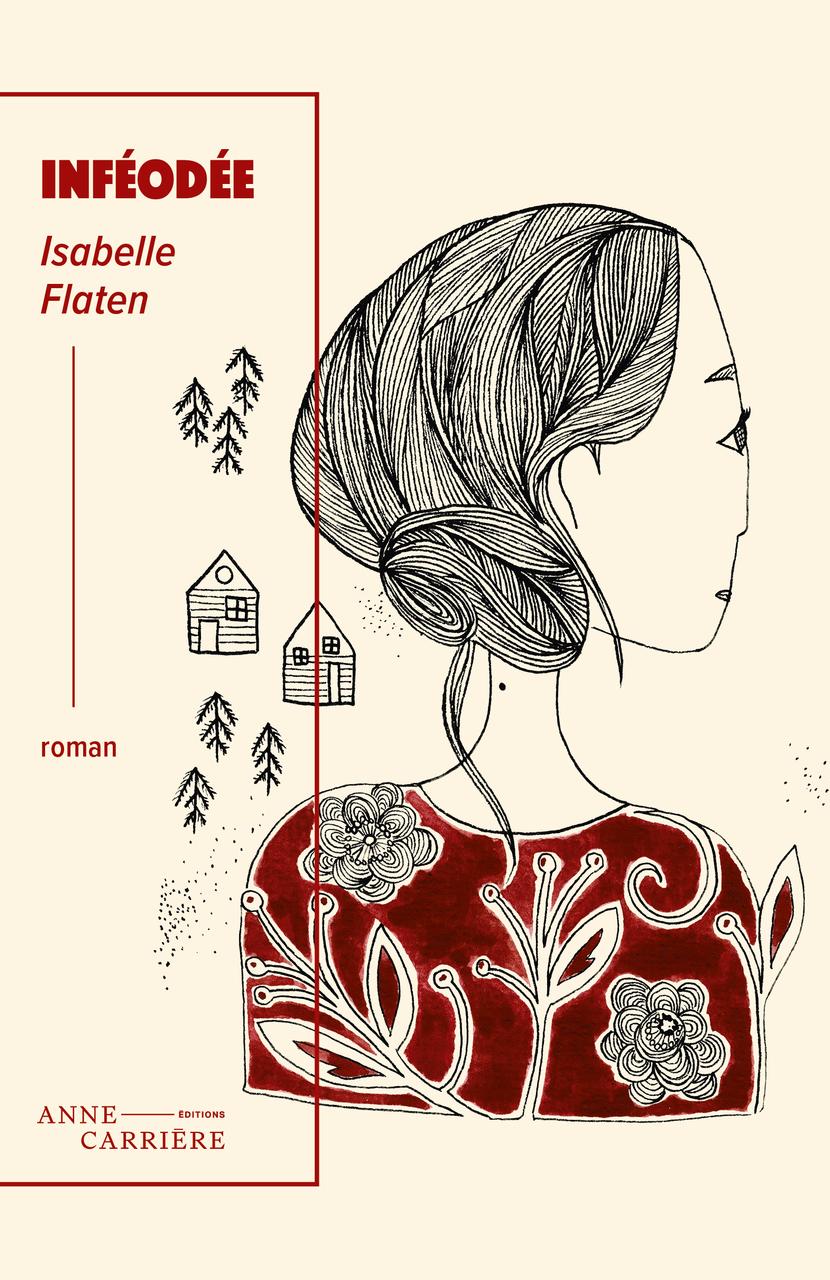
Les contrées nordiques inspirent les écrivains français, en cette rentrée 2024. Après la Finlande pour Olivier Norek avec son excellent Les Guerriers de l’hiver, voici Isabelle Flaten et la Norvège, avec Inféodée. Quel roman, là aussi ! Une histoire finalement banale et pourtant, un véritable turn-over. Isabelle Flaten (née en 1957 à Strasbourg) conte l’histoire d’une jeune femme, Hjørdis Løkkeberg, dans la Norvège d’aujourd’hui, qui s’éprend de Morten Dahl, un homme d’une dizaine d’années de plus qu’elle et membre des Témoins de Jéhovah. Pas de souci, il a quitté l’église, lui dit-elle d’abord pour la séduire. Elle ne demande pas mieux que de le croire, elle qui s’ennuie à Stavanger et rêve de rencontrer le grand amour. Il vit dans le nord du pays, gère un élevage de chèvres pour produire du fromage, est travailleur, honnête, il semble solide. Ne veut même pas coucher avec elle avant le mariage. Un peu hors-d’âge, comme un vieil alcool, mais pourquoi pas ? Hélas, la vie avec lui se révèle très vite pénible. « En dépit du cocon douillet dont elle est enveloppée, un curieux vague à l’âme s’empare d’elle parfois jusqu’à la plonger dans des terres brumeuses, un temps suspendu, une oscillation entre terre et mer... » Morten ne parle pas, ne s’intéresse à rien. Il est quelqu’un d’important dans la communauté religieuse, avec laquelle il avait fait semblant de rompre. Lorsque naît leur premier enfant, une fille, elle n’en peut plus. Est-elle devenue « un genre de bécasse qui se satisfait de briquer son intérieur », comme l’affirme l’un de ses prétendants ? Elle fait en sorte de retourner vivre chez son père. Mea culpa de son mari, qui l’accompagne, trouve un nouvel emploi. Un second enfant naît, la famille déménage. Mais Morten a l’impression que les codes lui manquent, il ne trouve pas sa place dans son travail ni auprès de Hjørdis. Comment se sortir d’une emprise intellectuelle qui s’étend sur des générations ? Ce livre part de l’exemple d’un témoin de Jéhovah mais la situation peut évidemment être transposée, toutes les religions procèdent selon des règles assez similaires. La religion catholique, ou musulmane ou ce que l’on veut d’autre, n’est qu’une secte qui a réussi. Mieux vaut éviter de s’y trouver mêlé. Un roman presque à suspens, à recommander.
* Isabelle Flaten, Inféodée, Anne Carrière, 2024
Et si la vie triomphait

Et si la vie triomphait vient après Une Famille moderne, Reste si tu peux, pars s’il le faut, et Tout le monde veut rentrer chez soi. Tarjei, Kristian et Trygve sont des jeunes hommes d’une même commune, morts comme soldats en Afghanistan. Björn, seul survivant parce qu’il était malade le jour de l’attentat, est rentré chez lui, empêtré dans sa culpabilité. Ragnhild, la médecin de famille, assiste au bouleversement causé par cet événement. Elle les connaît tous, ici peu ont des secrets les uns pour les autres. Son action est constante mais forcément limitée, d’autant que certains acceptent difficilement ce qu’ils voient comme de l’intrusion. « Je la tiens à l’écart, de plus en plus, je ne supporte plus qu’elle soit aussi étroitement proche de moi », songe ainsi Karine, pourtant sa plus fidèle amie. « Quand Tarjei est mort, Karin s’est noyée dans un chagrin que je n’avais jamais rencontré de toute ma vie professionnelle. D’un certain point de vue, c’était fascinant, comme tout le reste de sa vie », songe Ragnhild, non moins en souffrance que Karin et que les autres parents et amis des victimes. Cinq ans après, les trois soldats morts envahissent toujours le quotidien de leurs connaissances, au point que la vie dans la commune s’en ressent. « Je restais des heures dans le fauteuil devant la fenêtre, je regardais les montagnes, je pensais que Tarjei était mort. Tarjei est mort ? Tarjei est mort ? Oui, Tarjei est mort. » Ragnhild préserve son intégrité dans son professionnalisme, jusqu’au jour où elle comprend qu’elle n’a pas su déceler le cancer de l’un de ses patients, Hallvard, compagnon de Karin et père de Tarjei. Les symptômes étaient pourtant sous ses yeux. Ces quatre volumes forment une photographie de la Norvège d’aujourd’hui, comme un portrait de groupe d’une population astreinte à subir des événements qui la dépassent. Un regard très juste, empreint de sensibilité. Avec une question récurrente : la Norvège a-t-elle eu raison de s’engager sur le terrain afghan ? Que de douleur, pour quel résultat ? (Regrettons juste les titres en français de ces volumes de Helga Flatand, notamment celui-ci, Et si la vie triomphait, qui évoque plus un roman à l’eau de rose qu’une œuvre réaliste.)
* Helga Flatland, Et si la vie triomphait (Det finnesingen helhet, 2013), trad. du norvégien (bokmål et néo-norvégien) Dominique Kristensen, L’Aube, 2025
Tout le monde veut rentrer chez soi

C’est un roman fort, un roman troublant de sincérité. Signé Helga Flatland, Tout le monde veut rentrer chez soi vient après Reste si tu peux, pars s’il le faut. Il peut être lu comme sa suite ou, plutôt, son reflet, une même histoire relatée autrement, par d’autres personnages, avec d’autres points de vue. 2007. Julie, la narratrice principale, vient de perdre son frère cadet, Tarjei, militaire engagé mort en Afghanistan. Avec lui, deux autres soldats, originaires de la même commune, un trio d’amis proches, ont été victimes d’une bombe sur une route du pays. Bouleversés, les parents de Julie décrochent de la réalité, sa mère dort dans l’ancien lit de Tarjei et, délaissant son élevage bovin, son père finit par être interné. « Ma famille (…) est en train de s’effondrer de toute part », songe-t-elle. Elle caressait l’espoir de reprendre la ferme familiale, mais son père voyait Tarjei comme son unique successeur. Une histoire d’hommes, qu’une ferme. Elle est effondrée, d’autant plus que son compagnon, Mats, vétérinaire pour les vaches et les moutons, père de leur fille Julie, cinq ou six ans, s’impatiente. Leur couple ne résiste pas. Elle fait pourtant le forcing, affligée d’observer que la ferme part à vau-l’eau. Quant à son voisin Sigurd, qui était secrètement amoureux de Trygve, autre soldat mort chez les talibans, il s’enfonce dans la dépression, jouant bien malgré lui l’hétérosexuel avec Silje. Tout le monde veut rentrer chez soi n’est pas un ouvrage intimiste, en dépit du sujet. La famille en est au centre, mais Helga Flatland parvient à donner à sa réflexion une ampleur plus large. Ce n’est pas seulement ses liens avec ses parents que la mort de son frère vient perturber, c’est aussi ceux avec son compagnon et, par rebond, avec l’ensemble de la communauté villageoise. La mort des trois « héros », comme ils sont désignés, affecte le pays. Julie et les proches de ces soldats sont en quelque sorte des victimes collatérales. Comment continuer à vivre après un tel drame ? Un livre subtil, qui appelle forcément une suite.
* Helga Flatland, Tout le monde veut rentrer chez soi (Alle vil hjem. Ingen vil tilbake, 2011), trad. du norvégien (bokmål et néo-norvégien) Dominique Kristensen, L’Aube (Regards croisés), 2024
Reste si tu peux, pars s’il le faut

Premier roman de la norvégienne Helga Flatland, dont Une Famille moderne avait déjà été publié en traduction française en 2022, Reste si tu peux, pars s’il le faut relate les amitiés de quatre jeunes hommes dans un bourg à l’écart d’Oslo. Ils se connaissent depuis leur prime enfance, sont allés au lycée ensemble. « La confirmation a été notre grand sujet de conversation au printemps. » À l’issue de leur service militaire, ils décident d’un commun accord de s’engager dans l’armée pour aller combattre en Afghanistan. Trois n’en reviendront pas. Helga Flatland ne s’arrête pas sur cet épisode, mais remonte le temps, s’attachant à suivre chacun d’entre eux, observant également les réactions de leurs parents. Trygve, Kristian, Tarjei et Bjørn possédaient tous de bonnes raisons de vouloir quitter leur famille et leur village, ce qui pouvait ressembler à un cocon peut-être trop étouffant. L’un était dévoré par la culpabilité après avoir involontairement tiré sur un voisin et en avoir laissé porter la responsabilité à son père ; un autre vit mal son homosexualité : « Je suis jeune, ça va passer. Un mot que je ne veux pas entendre, et que je ne pense pas non plus. »... Un beau roman, sans prétention – mais justement.
* Helga Flatland, Reste si tu peux, pars s’il le faut (Bli hvis du kan, reis hvis du må, 2010), trad. du norvégien (bokmål) et du néo-norvégien (nynorsk) Dominique Kristensen, L’Aube (Regards croisés), 2023
Une Famille moderne

C’est une famille norvégienne tout ce qu’il y a de plus classique, ou presque, qui décide, de nos jours, de partir en vacances en Italie. Liv, la narratrice au début du récit, et Olaf, son époux, leurs deux enfants Agnar, adolescent, et Hedda, la cadette, plus Ellen, la sœur de Liv, et Simen, son compagnon, et enfin Håkon, le petit frère longtemps sur-protégé car né avec un problème au cœur. Sans oublier Sverre, « papa », « les cheveux gris et épais », et Torill, « maman ». « Je ne crois pas m’être demandé une seule fois si vous étiez heureux quand vous étiez petits (…), mais vous vous en êtes quand même sortis », lance cette dernière sans mesurer la portée de ses paroles. Tous sont ravis de passer quelques jours dans la propriété que le frère de Olaf met à leur disposition. Mais comment les enfants et petits-enfants s’attendraient-ils à ce que leurs parents/grands-parents s’apprêtent à leur annoncer ? Ils vont divorcer. « Sérieusement, vous avez soixante-dix ans ! » leur réplique Ellen lorsqu’elle apprend la nouvelle. Puis ils rentrent en Norvège et la vie continue. Mais plus tout à fait comme avant. « ...Un voile de mensonge est jeté sur tous les souvenirs, les expériences et les points de vue de la sphère familiale, puisque maman et papa peuvent apparemment se dégager de quarante ans de mariage d’un simple claquement de doigts, abandonner aussi facilement l’union qui nous a créés », regrette Ellen. Håkon, lui le partisan de l’amour libre, voit les choses autrement : la vie de couple est foncièrement contre-nature, estime-t-il, et ne saurait se prolonger bien longtemps. Helga Flatland (née en 1984 à Oslo) a déjà signé plusieurs romans. Celui-ci, Une Famille moderne, est le premier traduit en français. S’il n’est pas désagréable à lire, s’inscrivant après plusieurs titres en provenance des Pays nordiques, ces derniers temps, dans la même veine (par exemple La Vie est pleine d’hippopotames, de Annette Bjergfeldt, La Vérité sur la lumière, de Auður Ava Ólafsdóttir, Les Survivants de Alex Schulman, etc.), on se lasse assez vite des pensées bien banales des uns et des autres. Une Famille trop ordinaire ?
* Helga Flatland, Une Famille moderne (En Moderne familie, 2017), trad. Dominique Kristenen, L’Aube, 2022
La Nouvelle saison
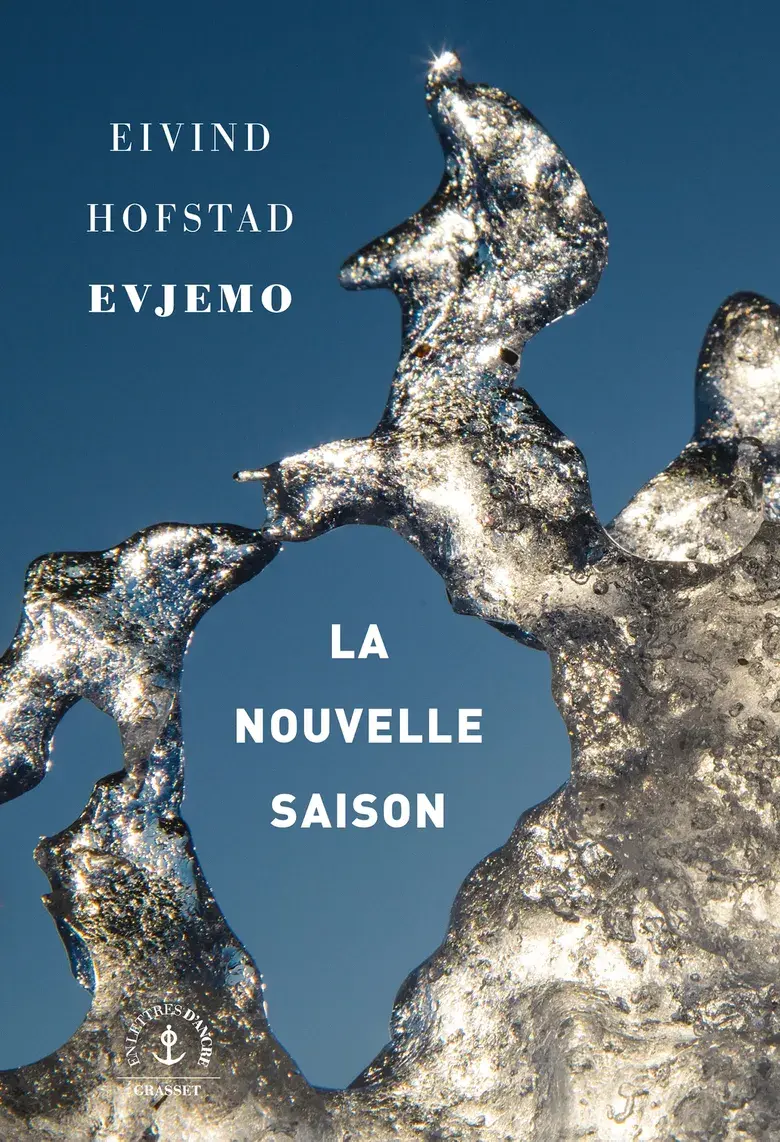
Les quatrièmes de couverture sont souvent excessives, ainsi celle-ci, pour La Nouvelle saison de Eivind Hofstad Evjemo : « À la fois roman écologique et magnifique histoire d’amour, La nouvelle saison donne à voir une nature dont l’harmonie se trouve menacée en seulement deux générations. Une bouleversante variation sur la solitude contemporaine, aux confins de l’Europe. » La mère de Hans est morte alors qu’il était très jeune. Il reprend l’exploitation agricole avec son père, quelque part au nord de la Norvège. Quand celui-ci décède à son tour, il tente de la moderniser, plantant notamment des épicéas, arbres à la croissance rapide, et veillant à donner à ses vaches et à ses bœufs de bonnes conditions de vie. Un jour, Sylvi, une vétérinaire de son âge, survient pour vérifier si la ferme est aux normes. Une histoire commence entre eux, peut-être pas si puissante qu’indiquée en quatrième de couverture, mais qu’importe. « Comment tu as fait ? » l’interroge une ex-collègue. « Comment tu as fait pour attraper l’amour ? » La ferme s’ouvre au monde mais le quotidien demeure difficile. Sorti de son travail Hans n’est pas très causant et Sylvi se prend à penser qu’il leur manque un enfant. Hans « mâchouillait un bout de paille. Des brindilles étaient accrochées à sa veste. Il avait le dos tordu et les mains rugueuses. Il savait la masser, la serrer dans ses bras, changer les pneus de sa voiture. Il mangeait de maquereaux à la tomate directement dans la boîte et se retrouvait avec les lèvres couleur corail et les poils de barbe pleins de gras. » Inscrit dans un cadre rural et maritime, ce roman, La Nouvelle saison, est une page de vie, une vie banale. Qu’on lit non sans plaisir, qu’on oublie peut-être vite aussi.
* Eivind Hofstad Evjemo, La Nouvelle saison (Den nye årstiden, 2022), trad. du norvégien Terje Sinding, Grasset (En lettres d’ancre), 2024
Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls

Parler intelligemment de la mort n’est pas facile, encore moins quand il s’agit de la mort d’un enfant. De son enfant. C’est à cette tâche que s’est attelé Eivind Hofstad Evjemo dans Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls, un roman déroutant qui peut se résumer autrement : comment vivre les uns avec les autres ? Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls commence peu après le 11 juillet 2011, lorsqu’un couple apprend que ses voisins ont perdu leur fille adolescente dans la tuerie de l’île d’Utøya. Comment réagir ? Montrer de la compassion ? Faire comme si de rien n’était, avec « des gestes de paix venant de très, très loin » ? Ce couple connaît déjà ce type de malheur. Le très jeune Philippin qu’ils avaient adopté a voulu retrouver sa mère, à l’âge adulte, et a été victime d’un attentat. Inutile de l’attendre, il ne reviendra pas ; il était parti en réalité depuis longtemps déjà. On ne peut pas passer sa vie dans le deuil : tous de continuer, alors, bringuebalants, les souffrances au coude comme un filet trop lourd. « Le plus important, c’est de cultiver la solidarité (…). Un de nos amis nous a fait cadeau d’une toile où il a calligraphié cette phrase : ‘Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls.’ » Non, peut-être. Un roman qui prête à méditer.
* Eivind Hofstad Evjemo, Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls (Velkommen till oss, 2014), trad. Terje Sinding, Grasset (En lettres d’ancre), 2017
Nous sommes cinq

Roman complètement farfelu et cependant presque crédible tant il est ancré dans notre monde, que celui-ci, Nous sommes cinq, de Matias Faldbakken. L’action se situe en Norvège mais elle pourrait prendre n’importe quelle autre région du monde occidental ou d’ailleurs pour cadre. Composée de Tormod, le père autrefois génie des maths et de l’informatique mais malheureusement à la limite de la toxicomanie, de Siv, la mère, à la tête d’un salon de coiffure et qui ne cesse de manger pour améliorer son moral, de Alf, l’aîné, les yeux rivés sur ses écrans, et de Helen, la cadette, plus futée que son frère, la famille Blystad est heureuse de choyer un chien nommé Snusken. Mais un jour celui-ci s’enfuit, semble-t-il, et le chagrin la ronge. Tormod confectionne dans son atelier jouxtant la maison familiale qu’il a construite de ses mains, une créature à base de glaise et de diverses autres substances. Quand elle prend vie, c’est un nouvel animal de compagnie qui ravit les enfants, emmenés par leur père qui n’en revient pas. « Mais ce n’est pas un chien », prévient-il tout de même. Le « pâton » d’argile est capable d’effectuer la plupart des tâches ménagères, il se comporte aussi comme un animal domestique. Mais ce « pâton » disparaît à son tour et le voisinage s’enflamme. Tormod est sidéré. « Que fait un type lorsque tout ce qu’il entreprend, ses activités, ses efforts et sa besogne ne le mènent à rien, ou encore pire, à sa perte ? Il reste là, tendu, les traits tirés, les bras ballants, exactement comme Tormod Blystad à ce moment, le vide personnifié. » Nous sommes cinq est un roman étonnant, une version revisitée du mythe du Golem, avec une fin déroutante. Après Le Serveur (publié en France en 2020), Matias Faldbakken livre un nouveau roman original et sujet à réflexion. Il serait dommage de passer à côté.
* Matias Faldbakken, Nous sommes cinq (Vi er fem, 2019), trad. du norvégien Marie-Pierre Fiquet, Fayard (Littérature étrangère), 2023
Le Serveur
« Au Hills, nous nous appliquons tous. C’est un lieu où l’on fait les choses avec soin. Application et soin vont de pair, j’en suis convaincu. » Le serveur, dont nous n’apprendrons pas le nom, de ce prestigieux restaurant du centre d’Oslo possède une haute idée de son métier. Matias Faldbakken (né en 1973, artiste et écrivain, fils de Knut Faldbakken) montre, dans ce roman en huis-clos, Le Serveur, ce qu’il peut avoir de singulier. Chaque client possède ses habitudes, dont il faut tenir compte. Le luxe se cache dans les détails, n’est-ce pas ? Mais, professionnel jusqu’au bout des ongles, le narrateur n’en reste pas moins homme et l’arrivée d’une jeune femme, qui « n’a rien de spécial, et c’est en quelque sorte ce qui fait sa beauté », va le perturber et déstabiliser l’honorable établissement. Original.
* Matias Faldbakken, Le Serveur (The Hills, 2017), trad. Marie-Pierre Fiquet, Fayard, 2020
Une Vie de homard
Quel plaisir de lecture, ce roman signé Erik Fosnes Hansen (né en 1965), Une Vie de homard ! « L’un des problèmes auxquels on est confronté quand on doit écrire ses Souvenirs, c’est que les choses ne se déroulent pas toujours dans l’ordre où elles le devraient. (…) Beaucoup s’imaginent que les auteurs d’histoires captivantes n’ont qu’à s’asseoir à leur table de travail pour pondre aussitôt la première histoire captivante qui leur passe par la tête. Mais ce n’est pas aussi simple. » Sedd, le narrateur de ce roman, s’y met tout de même et nous livre là un tableau des années 1980 en Norvège, où la nostalgie n’est jamais pesante. Son père, un médecin d’origine indienne, est mort avant sa naissance, sa mère a disparu, « emportée par le temps », ce sont ses grands-parents maternels qui s’occupent de lui. Monsieur Zacchariassen, le grand-père, dirige avec poigne un hôtel réputé en pleine montagne ; l’établissement a connu ses heures de gloire mais aujourd’hui, les touristes préfèrent le « sud » et l’argent vient à manquer. C’est le roman d’une époque, que Erik Fosnes Hansen a écrit là, celui d’un milieu également, une bourgeoisie prospère qui se relève les manches, d’abord aveugle aux changements en cours. Tout est suggéré plus qu’affirmé, et sans doute est-ce ce qui rend si attachant la personnalité des divers personnages : de Sedd, quatorze ans et déjà jeté dans la vie active, à Karoline, la fille du nouveau directeur de la banque, qui recherche sa présence alors qu’il ne la voit que comme une gamine trop collante ; de Jim, employé considéré comme le second fils de la maison, à Madame Zacchariassen, une « grand-mère » directement importée de Vienne... Le roman commence par une mort, si bien que le lecteur plonge aussitôt dans une intrigue à vraie dire toute simple, et se termine également par une mort, mais là, c’est une véritable tragédie. Les personnages n’ont rien d’exceptionnel et pourtant, on ne peut que souhaiter une suite (qui ne viendra probablement pas, puisque ce n’est pas dans les habitudes de l’auteur de Cantique pour la fin du voyage ou de Les Anges protecteurs), histoire d’apprendre comment la vie traite ceux qui ne veulent pas voir la transformation de leur monde. « Ce que tu es bête », répète Karoline à Sedd. Peut-être. Ou peut-être Sedd est-il réfléchi. Très réfléchi, et c’est pourquoi Karoline... N’en disons pas plus ! Contentons-nous de recommander vivement Une Vie de homard, assurément l’un des meilleurs romans nordiques de ces dernières années.
* Erik Fosnes Hansen, Une Vie de homard (Et hummerliv, 2016), trad. Hélène Hervieu, Gallimard (Du monde entier), 2019
Les Carnets du Congo

Branches obscures, le dernier roman de Nikolaj Frobenius nous avait laissé un bon souvenir. Celui-ci, Les Carnets du Congo, est une nouvelle fois très bien mené et ouvre la porte à de multiples réflexions, relatant une histoire qui a bouleversé la Norvège ces dernières années. À Oslo, en 2013, un jeune écrivain au parcours tumultueux est contacté pour rencontrer dans leur geôle congolaise Joshua French et Tjostolv Moland, deux ex-soldats norvégiens, à présent mercenaires, accusés notamment d’avoir assassiné leur chauffeur quatre ans plus tôt. Moland décède en prison, French est lui condamné à la prison à vie par un tribunal des plus corrompus. Mais sa culpabilité n’est pas évidente. « Les soupçons, les rumeurs et les explications fallacieuses s’infiltraient dans le dossier par toutes ses failles. » Dans le but de faire le scénario d’un film, l’écrivain se rend à Kinshasa et les interviewe, mais ils se dérobent, refusent d’indiquer pour qui ils travaillaient, prétendent avoir été « en mission secrète ». Il comprend que pour les deux hommes, « Guerre = élément fondamental de la vie humaine et de la civilisation ». Il se persuade également que lui-même est un pion. « Comme si je m’imaginais naïvement en train d’écrire une vérité déguisée en mensonge, alors qu’en réalité je débiterais des mensonges déguisés en vérité. » Mais qui se sert de lui ? Il persiste, se rend régulièrement dans leur cellule. « La Norvège leur paraissait trop étriquée », saisit-il. Leur vision d’extrême droite s’accommode mal du libéralisme ambiant. « Cet ‘État féministe, antiblancs et antimecs’ qu’était la Norvège » leur déplaisait, « les deux jeunes hommes s’assumaient comme réactionnaires ». Le narrateur (une « autofiction », comme indiqué en quatrième de couverture ?) finit par rentrer en Norvège et tenter de reprendre la vie auprès de Vilde, sa compagne. Mais il n’est plus le même. Trop de souvenirs sont remontés, de sa jeunesse, lorsqu’il était lui-même un petit malfrat prêt à tout pour gagner de l’argent et du pouvoir. Aucun personnage de ce livre ne rattrape l’autre, sauf peut-être Vilde. Tous se démènent avec leurs testostérones et considèrent le monde comme un gigantesque champ de bataille. Ces individus-là, qui pourraient sembler plus à l’aise dans la Russie d’aujourd’hui qu’au pays du prix Nobel de la paix, sont aussi ceux qui s’agitent, pour une part, dans l’Europe d’aujourd’hui. Ne pas l’oublier.
* Nikolaj Frobenius, Les Carnets du Congo (Kongonotatene, 2018), trad. du norvégien Françoise Heide, Actes sud, 2024
Branches obscures

Quatre titres de Nikolaj Frobenius (né en 1965) ont déjà été traduits en français, chez Actes sud : Le Valet de Sade, Le Pornographe timide, Je est ailleurs et Je vous apprendrai la peur. Assez modérément convaincus par ces ouvrages, avouons-le, nous avons toutefois été séduits par son nouveau roman, aux allures de thriller, Branches obscures. Comment, à son propos, ne pas évoquer la toile du peintre Jean Hélion (1904-1987), « Le peintre piétiné par son modèle », que la Poste française avait utilisée dans les années 1980 pour illustrer un timbre. De la même manière, Branches obscures conte l’histoire d’un écrivain, Jo Uddermann, rattrapé, si l’on peut dire, par l’un des personnages de son dernier ouvrage. « J’avais écrit un roman autobiographique sur mon enfance, un chapitre sombre et dérangeant de mon histoire personnelle. (…) Jamais je n’avais osé écrire quelque chose d’aussi personnel, vrai et authentique. » Sa maison d’édition et les critique le félicitent mais le livre à peine paru, Jo Uddermann est la proie d’un inconnu qui se met à le menacer et à le harceler. Sa maîtresse est assassinée. Le coupable serait-il le personnage au centre de son roman, hier un enfant qui a joui du « plaisir du destructeur » en incendiant une école et que Jo Uddermann croyait mort depuis longtemps ? Voilà qu’il refait surface après avoir purgé une longue peine de prison en Irlande. La tension monte, l’écrivain Jo Uddermann ne maîtrise plus rien. Il est surveillé, des actes de malveillance sont commis à son encontre. La police ne le croit pas et ne veut pas intervenir. Et bientôt, elle le suspecte. Le lecteur, lui, ne sait plus si le narrateur est de bonne foi ou s’il le mène en bateau. L’écrivain, le narrateur, le personnage central… Qui est qui ? Un roman habile et dérangeant sur ces étrangers et ces doubles qui nous habitent parfois et qui, de gré ou de force, notamment chez les artistes toujours en proie à leurs démons intérieurs, peuvent finir par s’installer à la place de notre propre personne… !
* Nikolaj Frobenius, Branches obscures (Mørke grener, 2013), trad. Céline Romand-Monnier, Actes sud, 2016
Des Hommes ordinaires

(article paru dans la revue Nordiques n°27, 2014)
On ne sait pas forcément très bien, ici, quel théâtre militaire fut l’extrême nord européen durant la Seconde Guerre mondiale. Le froid aurait-il anesthésié la violence des combats ? Loin de là et deux ouvrages récents nous permettent d’en savoir plus sur l’occupation allemande en Norvège et la menace constante de l’invasion des troupes soviétiques. Le foisonnant roman de Kjartan Fløgstad, Des Hommes ordinaires relate le parcours (des années 1930 à aujourd’hui) de différents personnages qui se retrouvent acteurs de cette tragédie. L’intérêt de ce roman est de montrer la complexité des enjeux, et, de fait, des engagements, sans pour autant relativiser les responsabilités. Les questions abondent donc. Au-delà des crimes commis par leurs partisans, le nazisme et le stalinisme ont représenté pour beaucoup d’individus de la première moitié du XXe siècle de véritables modèles de société, dont l’instauration minimisait, sinon justifiait n’importe quelle barbarie. Rappelons que du Norvégien Kjartan Fløgstad, écrivain prolixe qui a exercé différents métiers et par ailleurs traducteur d’auteurs d’Amérique du sud, trois traductions en français existent déjà : Grand Manila (Stock, 2009), Pyramiden (Actes sud, 2009 ; récit prenant pour cadre l’archipel du Svalbard) et Le Chemin de l’Eldorado (Esprit ouvert, 1991).
* Kjartan Fløgstad, Des Hommes ordinaires (Grense Jakobselv), trad. Céline Romand-Monnier, Stock (La Cosmopolite), 2012


