C-D
La Solitude selon Lydia Erneman

Le personnage central du roman de Rune Christiansen, La Solitude selon Lydia Erneman (prix Brage en 2014), est une vétérinaire originaire de Frankrike, « la France », un village du Jämtland, aujourd’hui installée dans la campagne norvégienne. Elle vit seule et ne s’en désole pas. « Comment savoir avec certitude d’où l’on tient les choses ? Comment sait-on ce qui nous appartient ? Elle songea qu’elle faisait partie de ces voyageurs qui ont l’art d’oublier chez eux des bagages importants. » D’un naturel cordial, elle prend sous son aile Johan, un jeune garçon délaissé par ses parents, une « curieuse amitié » rabrouée par la mère de l’enfant. Des hommes cherchent à entamer une liaison avec elle, dont Bård, un collègue stagiaire, ou peut-être Edvin, divorcé. Dans ce livre intelligemment mené, genre littérature introspective à la Vigdis Hjorth, le lecteur suit le quotidien d’une vétérinaire dans un milieu d’élevage. « D’un seul coup, elle fut révoltée par sa propre profession : tant d’euthanasies, tant de mandats impossibles : un chien souffrant d’un cancer de la gorge, une brebis atteinte d’une mastite avancée, une vache au pis gangrené. Que pouvait-on faire à part abréger leurs souffrances ? » Des extraits de poèmes de Johan Ludvig Runeberg, de Jonas Lie ou de Bo Carpelan parsèment la narration. C’est simultanément léger et profond, il n’y a rien d’extraordinaire et c’est sans doute ce qui peut toucher les lecteurs. À partager.
* Rune Christiansen, La Solitude selon Lydia Erneman (Ensomheten i Lydia Ernemans liv, 2014), trad. Céline Romand-Monnier, Noir sur blanc (Notabilia), 2025
L’Affaire des lubies du temps perdu
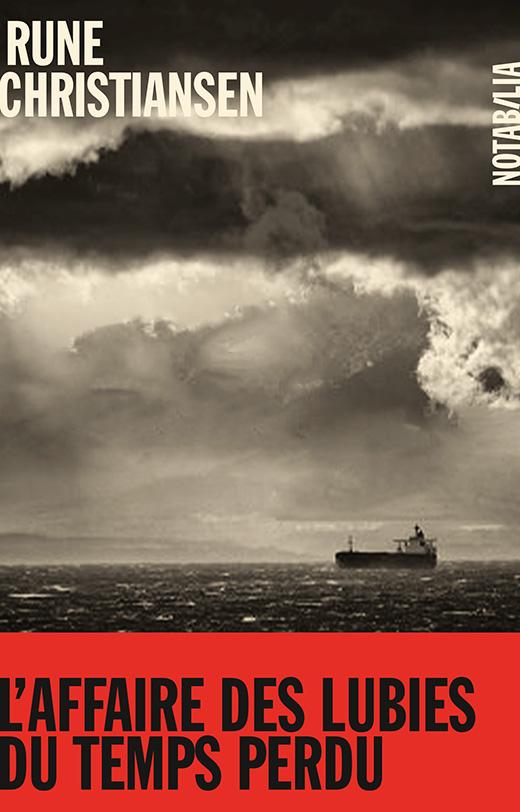
« Selon toute vraisemblance, sa mère était en passe de s’abandonner au bruissement aigu de la mort. » Norma redoute sa disparition, qui finit par survenir. Peu après, Jonathan et elle se séparent, ils garderont leur fille Edith à tour de rôle. Norma se rend sur une petite île de Norvège, là où habite son père, Torsten, lui-même séparé depuis longtemps de la mère de la jeune femme. « Elle voulait s’éloigner, de tout, de son appartement à moitié vide, de ce qui lui rappelait ce qui n’était plus. » Son retour dans la maison familiale, où elle n’avait pas mis les pieds depuis des années et qu’elle peine à reconnaître, l’affecte. Le passé remonte de manière désordonnée. L’actrice de bientôt trente-sept ans se sent trimballée entre hier et aujourd’hui. Torsten la déconcerte, avec sa façon de taire tant de choses. Cette Anna-Stina, par exemple, qui est-elle ? La fille de la maîtresse de son père ? Donc... sa demi-sœur ? Comme Fanny et le mystère de la forêt en deuil, précédemment paru, ce roman – ou ce récit – est intimiste. Rune Christiansen (poète et romancier, né à Bergen en 1963) promène ses personnages, sans leur infliger sa volonté d’auteur. « Rien n’est tout à fait si grave ni si bien qu’on croit. »
* Rune Christiansen, L’Affaire des lubies du temps perdu (Saken med den tapte tidens innfall, 2021), trad. Céline Romand-Monnier, Noir sur blanc (Notabilia), 2023
Fanny et le mystère de la forêt en deuil
Fanny a dix-sept ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle demeure dans la maison qui était la leur, la sienne, elle en a le droit. « ...Elle se sentait toujours très maîtrisée, très équilibrée, malgré ce qui lui faisait mal (…) et quand elle les revoyait, en rêve, (…) c’était alors elle, une vivante, qui hantait les morts... » Elle va au lycée, s’amourache d’un camarade de classe, devine que ses journées passent sans prendre de direction précise. Elle s’interroge – sur elle sur le monde. Noue des contacts, sans suite sauf avec Alm, un pasteur, et Karen, une voisine un peu plus âgée, qui rénove une maison à proximité. Les deux femmes découvrent qu’elles s’entendent bien, elles entament une relation amoureuse. Le ton de ce roman de Rune Christiansen, Fanny et le mystère de la forêt en deuil, n’est pas sans rappeler celui de certains titres de Tarjei Vesaas (non pas forcément Palais de glace, plutôt La Blanchisserie ou Les Ponts). Un être jeune, déboussolé à la suite d’un événement dramatique, qui tente de ne pas se laisser emporter par l’existence. « ...Fanny n’avait pas peur de mourir. Elle avait plutôt peur de ne pas mourir. D’être empêchée de disparaître un jour, de fuir, d’être décomposée – ça, ça lui faisait peur. Être de nouveau abandonnée, voir le navire partir, errer ensuite comme une âme en peine dans son existence vide : c’était le plus affreux. » Subtil, émouvant.
* Rune Christiansen, Fanny et le mystère de la forêt en deuil (2017), trad. Céline Roland-Monnier, Noir sur blanc (Notabilia), 2020
La Neige noire d’Oslo

« Je pris la décision d’émigrer, en Norvège parce que je n’avais pas assez de sous pour un voyage plus long... » Ainsi l’Italien Luigi Di Ruscio (1930-2011) expose-t-il les raisons de sa venue dans la capitale norvégienne, dans son récit autobiographique, La Neige noire d’Oslo. « Communiste et sans emploi », « révolutionnaire et entretenu par (sa) pauvre mère » à Fermo, dans la région des Marches, il cherche du travail. On lui propose un poste dans une usine de clous, dans cette ville lointaine. Les conditions sont plus correctes qu’ailleurs, un logement est mis à sa disposition pour lui, sa femme Mary, une Norvégienne rencontrée dans une boite de nuit, et leur petite fille (avant d’autres enfants). « ...Nous habitons un deux-pièce et je ne sais plus où planter ma machine à écrire mes romans consécutifs ni quand taper sur les lettres métalliques qui se ruent sur la feuille sans réveiller le peuple amoncelé au-dessus de nos têtes et même en-dessous... » Luigi Di Ruscio apprend vite le norvégien mais écrit en « italique », c’est-à-dire en italien – son jardin secret, ce qui le rattache au sol natal. Il est un autodidacte dont les textes rencontrent un certain succès. Les éditeurs italiens les snobent mais plusieurs revues, certaines confidentielles et d’autres cotées, les publient. Dès avant la Deuxième Guerre mondiale, notamment à cause de la montée du fascisme mais aussi de la situation économique, de nombreux Italiens sont partis dans le nord chercher un emploi. Certains publieront leur témoignage. En France (cf. François Cavanna), en Belgique (on peut penser à Rue des Italiens de Girolamo Santocono, ce roman autobiographique qu’avaient publié les éditions du Cerisier en 1986) ou plus au nord, comme Luigi Di Ruscio. Son ouvrage possède une écriture qui dénote avec ce que l’on appelle la littérature prolétarienne. « Poète fou non homologable et métallo », « communiste et poète blasphérique », l’homme est un lettré qui travaille de ses mains, avant d’être un prolétaire qui écrit. Il aime écrire, il aime parler et s’écouter parler. Ses propos sont pertinents quelquefois et quelquefois, relèvent plus du bavardage savant. Sa vision du monde du travail est iconoclaste. « ...Je lisais l’Enfer comme si c’était un atelier de l’usine d’Oslo de la seconde moitié tout entière du XXe siècle et en tant que poète italique résidant en Norvège (…), je reste une absolue curiosité. » Son vocabulaire est riche, d’autant plus qu’il n’hésite pas à inventer les mots qu’il ne trouve pas dans le dictionnaire ou à malmener ceux qui ne le satisfont pas. Dans sa préface, l’écrivain Angelo Ferracuti évoque à son propos Joyce, Céline, Hrabal, voire Hašek : « Loin de l’intellectualisme stérile et abscons de la néo-avant-garde, les témoignages de cet écrivain des Marches sont d’un réalisme puissant et d’un effet de vérité bouleversant. » Luigi Di Ruscio est en effet une individualité placée dans la collectivité de l’usine. « Je rêvais d’être métallo car en tant que communiste je considérais l’usine comme le centre du monde. » La réflexion, suivie d’une démarche conséquente, peut faire bondir, être qualifiée d’auto-aliénation ; elle a toutefois pour elle d’être cohérente. Il avoue pourtant que son emploi dans l’industrie ne l’inspire que peu : « en quarante ans, je n’ai écrit que deux ou trois poèmes sur l’usine, j’aurais peut-être pu les écrire même si je n’avais pas été ouvrier... » Mais il baigne dans un cadre spécifique, avec des machines, des odeurs, des bruits, des collègues et des supérieurs, bien sûr, et ses écrits s’en imprègnent. « ...Il était pourtant inévitable que le travail en usine devienne un des centres de mon travail poétique. » Sa vision du monde n’est pas que – mais est aussi – une contestation de l’ordre capitaliste en place. Il agace sa femme, amuse ses collègues (« les ouvriers savent que je suis italique et par conséquent pas très normal »), intrigue ses chefs et surtout, exaspère les tenants de l’orthodoxie révolutionnaire pour lesquels un poète n’a aucun intérêt puisque affecté à aucun usage précis. Il se complaît dans ce rôle. Luidi Di Ruscio est un révolutionnaire sage, n’appelant nullement à l’assassinat des puissants, ni même à la restitution de leurs biens au fameux peuple souverain. Il faudrait juste, selon lui, « ...trouver un système pour rendre les patrons superflus, notre vie ne vaudra pas un clou tant qu’ils existeront... » Il ne sait « manier que les armes verbales qui finissent toujours par faire rire... » Son regard est désabusé, façon vieux sage, philosophe amateur de bonne chère, jamais il ne prône la violence, juste peut-être la colère. « Autrefois, j’avais l’impression en écrivant que les opprimés, les écrasés se tenaient là, derrière moi (…), je les sentais si proches qu’il m’arrivait d’entendre leurs battements de cœur. » La Neige noire d’Oslo est un récit plus qu’un roman, presque un pamphlet plus qu’un poème. Un texte très nombriliste et néanmoins très prenant. Il ne relève qu’incidemment de la littérature prolétarienne, en dépit du statut de son auteur, ouvrier tout au long de sa vie. Intéressant.
* Luigi Di Ruscio, La Neige noire d’Oslo (La Neve nera di Oslo, 2010), trad. de l’italien Muriel Morelli ; préf. Angelo Ferracuti, Anacharsis, 2014
