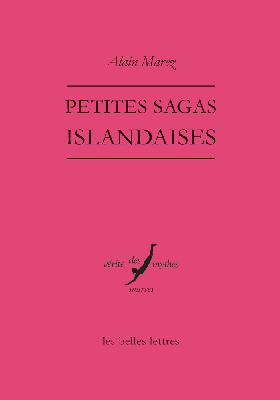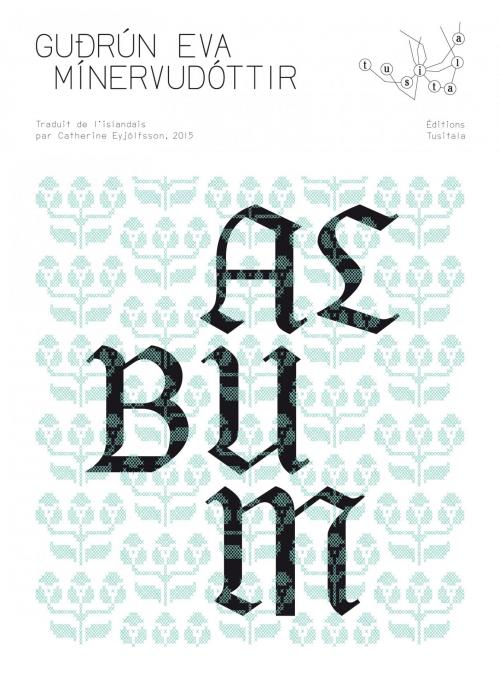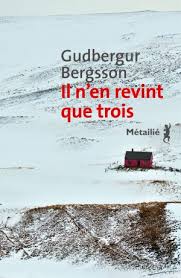M-N
À Islande !
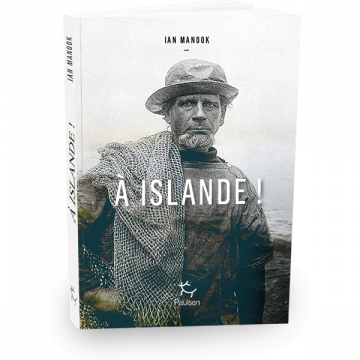
Ian Manook (Patrick Manoukian, né en 1949) a eu une vie de routard, avant de se mettre à écrire et d’exercer le métier de journaliste. D’où un riche bagage d’expériences diverses. On se demande, à la lecture des premiers chapitre de À Islande (les pêcheurs de son roman vont « à Islande, pas en Islande »), s’il a lui-même connu des tempêtes comme celle évoquée ici. « Les hommes de l’étal éventrent, décapitent et tranchent les poissons tant que l’équipage en remonte. (…) Le pont tout entier est visqueux de sang et de viscères. On croirait des bourreaux extatiques du Moyen Âge. C’est un carnage. Une boucherie. Un champ de bataille. » Le travail des hommes d’équipage de ce bateau de pêche est très méticuleusement décrit ; chaque geste explicité, chaque outil examiné. « Le bateau empeste le sang et la saumure. (…) Ils boettent, hissent, gaffent et égorgent à tour de bras les morues qui se débattent. » Des considérations écologiques attestent de l’impact de cette pêche déjà industrielle sur le milieu marin. Ce roman relate l’arrivée en Islande de plusieurs personnes, simultanément et pour des raisons différentes. Marie Brouet est la nouvelle infirmière, qui secondera le docteur Gunnarsson à l’hôpital français. Elle arrive de France avec la conviction de s’opposer à l’obscurantisme religieux. Kerano a failli mourir, lui, sur son navire qui s’est échoué dans un fjord et une main lui a été amputée. Instituteur en Bretagne, il entend demeurer ici, d’autant plus qu’il tombe amoureux de Eilin, qui exerce le même métier. Lequéré, lui, son ami, rencontre une sœur, laquelle oublie vite Dieu. Il souhaite rentrer au pays, mais les pêcheurs ne souhaitent pas appareiller avec un récalcitrant tel que lui. La vie quotidienne sur l’île est présentée dans ses détails. À Islande est un roman historique, ancré au tout début du XXe siècle. S’il montre la population islandaise de l’époque, il s’attache plus particulièrement à suivre les Français qui se retrouvent, pour quelques jours ou quelques années, sur ce territoire perdu dans l’Atlantique. Un très beau roman, en dépit d’une certaine tendance au pathos, lequel est toutefois tempéré par de fréquents rappels des conditions de vie des pêcheurs : « ...Vous comprendrez que seul l’abrutissement par l’alcool leur permet de supporter non seulement ces conditions, mais surtout l’image d’animal corvéable à merci que cela leur renvoie d’eux-mêmes. » Ou encore : « Se plaindre de ce que nous endurons, ce serait reconnaître que nous acceptons de l’endurer. »
* Ian Manook, À Islande !, Paulsen, 2021
Petites sagas islandaises
C’est un ouvrage savant et plaisant à la fois que nous propose Alain Marez (né en 1938 et professeur honoraire de linguistique germanique et scandinave à l’université Michel-de-Montaigne Bordeaux 3) avec ces Petites sagas islandaises. Un ouvrage dédié à Régis Boyer, dont Alain Marez poursuit ici le travail d’érudition. « La prodigieuse floraison des lettres islandaises entre le XIIe et le XIVe siècle s’explique en partie par la passion des Islandais pour l’un de leurs divertissements qui semble avoir concerné toutes les couches de la société : la composition, la transmission et la réception de récits de toute nature », relève l’auteur dès les premières lignes de son essai, avant de nous proposer plusieurs « dits ». Des « dits » islandais anonymes, d’autres « autour d’Óláfr Tryggvason », « autour d’Óláfr Haraldsson Helgi », etc., jusqu’à ceux « autour de Magnús Erlingsson ». Tous épiques, comme il se doit, et toujours agréables à découvrir.
* Alain Marez, Petites sagas islandaises, Les Belles lettres (Vérité des mythes), 2017
Dans nos pierres et dans nos os
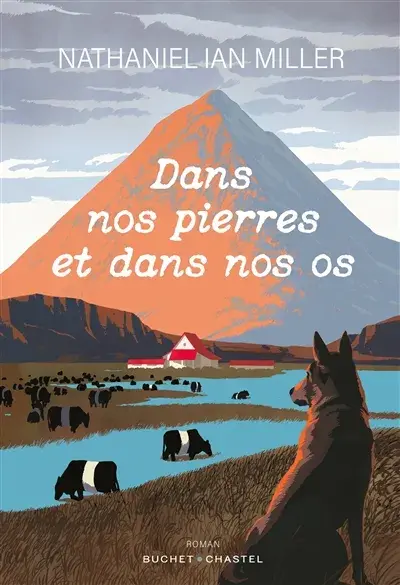
« Nous ne devenons pas tous nos parents, mais leurs vies et leurs blessures bâtissent les maisons que nous habitons. Elles sont les marteaux, les mains rêches et gercées qui fixent les fenêtres et les portes de traviole. » Après L’Odyssée de Sven, dont nous avions dit ici le plus grand bien, l’Américain Nathaniel Ian Miller publie Dans nos pierres et dans nos os, un roman qui prend pour cadre l’Islande. Orri est étudiant à Reykjavík. La ville ne lui réussit pas et la santé défaillante de son père lui fournit le prétexte pour revenir à la ferme. Pabbi ne lui épargne pas les difficultés du métier de fermier mais Orri s’accroche. La figure paternelle est séduisante, le bonhomme, considéré comme un original, a son caractère. Éleveur de vaches, il veille à leur bien-être, même lorsqu’il les conduit à l’abattoir. « Pabbi n’était pas quelqu’un de résigné. Il ronchonnait, s’indignait, trépignait. » Il est quelqu’un d’humain, comme sa femme, Amma, une Litvak, autrement dit juive originaire de Lituanie, qui se fait appeler « Emma Goldmansdottir » ! Orri, lui, vit une relation d’amitié avec Rúna, qui se dit lesbienne et qu’il a connue et défendue à l’école lorsqu’elle était enfant, qu’elle subissait les sarcasmes des gamins. Par les réseaux sociaux, il se lie avec Mihan, une jeune femme d’origine philippine qui habite à Akureyri, « un volcan qui puisait en continu dans les failles des plaques terrestres, sans jamais refroidir ». Tout ce petit monde vit dans une sorte d’harmonie bon enfant. C’est une Islande contemporaine que présente Nathaniel Ian Miller, ne négligeant pas l’œuvre des auteurs passés, comme Halldór Laxness, plusieurs fois cité, une Islande ouverte sur le monde. « Les Islandais ne sont pas particulièrement enclins à s’épancher. Pour nous soutirer quelque chose, mieux vaut tenter sa chance quand notre taux de caféine est à son pic. Des moments où nous sommes susceptibles de nous laisser aller et de nous montrer plus loquaces, sans risquer les grands déballages liés à l’alcool. » Comme dans L’Odyssée de Sven, une famille brinquebalante et néanmoins sympathique fournit ici la trame de l’intrigue. Un très bon roman.
* Nathaniel Ian Miller, Dans nos pierres et dans nos os (Red dog farm, 2025), trad. de l’anglais (États-Unis) Emmanuelle Heurtebize, Buchet-Chastel, 2025
L’Odyssée de Sven
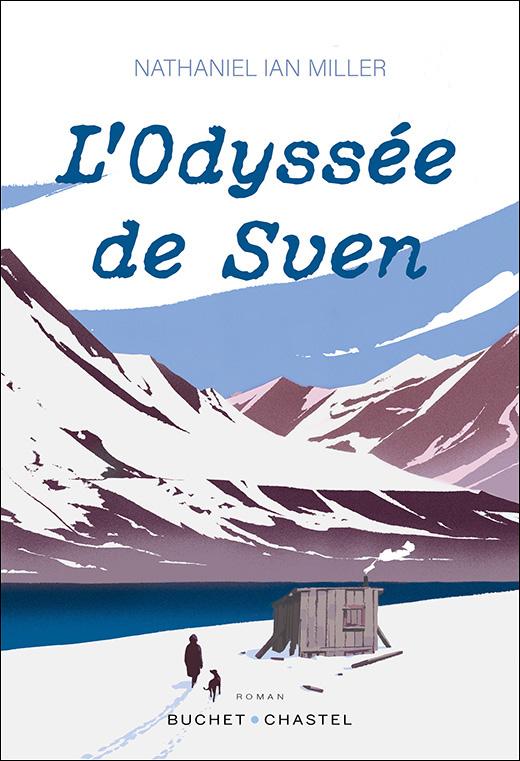
« Je m’appelle Sven. Certains me connaissent sous le nom de Stockholm Sven, d’autres sous celui de Sven le Borgne ou Sven le Baiseur de Phoques. Je suis arrivé au Spitzberg en 1916. J’avais trente-deux ans et pas grand-chose à mon actif. » Ainsi débute le roman de Nathaniel Ian Miller, « éleveur de bétail dans le Vermont » selon son éditeur français, L’Odyssée de Sven. Sven Ormson, « le Suédois taciturne », débarque sur l’archipel pour travailler comme mineur. Un accident le laisse entre la vie et la mort. Il est défiguré. De bonnes âmes lui viennent en aide, Tapio, par exemple, socialiste finlandais, ou Charles MacIntyre, homme aisé et plein de bon sens qui « travaille pour les mines ». Il peut rester sur l’île, rendre service à qui l’héberge. L’Odyssée de Sven est un roman traité avec humour. Le personnage principal ne brille par aucune qualité particulière – il est plutôt calme, à rebours de pas mal de ses contemporains, et ne vise qu’à se faire une petite place dans une société où la violence n’émane pas que des ours. Quelque peu à la façon des récits de voyages d’Admudsen ou de Nansen auxquels il est souvent fait référence, Nathaniel Ian Miller livre son héros au froid arctique et à la solitude, avec la présence réconfortante d’Eberhard, un vieux chien, ou de Bengt, un morse presque apprivoisé. « ...On peut seulement diminuer ou ignorer le désespoir, mais non l’exorciser. Il vit en soi comme un ver. » À l’âge de trente-neuf ans, Sven se sent toujours désemparé. L’obligation de devoir se débrouiller seul le remplit d’effroi. « ...Perspective si menaçante que mon souffle devenait court et superficiel, que mes poumons refusaient de se remplir et que ma vision se brouillait. » Mais comme, à cause de son visage ravagé, il exclut de retourner en Suède, le voici toujours au Spitzberg, devenu Svalbard lorsque la Norvège fait entendre ses droits. Sa nièce Helga le rejoint, avec un nouveau-né, Skuld, sa fille. Les rustres de l’archipel jouent presque des coudes pour l’aider. L’Odyssée de Sven est un roman très agréable à lire. La famille, notre véritable famille, illustre-t-il, n’est pas celle que l’on reçoit à notre naissance mais celle que l’on se choisit. Un optimisme improbable en l’être humain se dégage de ses pages.
* Nathaniel Ian Miller, L’Odyssée de Sven (The Memoirs of Stockholm Sven, 2021), trad. de l’anglais (États-Unis) Mona de Pracontal, Buchet-Chastel, 2022
Album
Album, de l’Islandaise Guðrún Eva Mínervudóttir (née en 1976), est un livre d’une centaine de pages. Comme son titre l’indique, il pourrait s’agit d’un recueil de photographies : clichés du quotidien d’une petite fille qui lentement grandit et s’étonne, sans jamais vraiment le montrer, de ce qui se passe autour d’elle. Mais à la place de photos, des textes, courts, comme des instantanés. Tendresse, étonnement et cruauté alternent.
« Le soir de la Sain-Sylvestre, je consentis à revêtir une robe pour le réveillon, mais je me changeais ensuite en enfilant un pantalon vert bouteille et un pull bordeaux, comme si j’avais idée de ce qui se préparait. On me donna du vin mousseux dans un petit verre et comme je trouvais chouette de voir les bulles jaillir du verre quand il était plein, je le remplis après chaque gorgée. Le mousseux était doux et bon mais il me donna un hoquet terrible… »
De Guðrún Eva Mínervudóttir, on trouve également en français Pendant qu’il te regarde, tu es la Vierge Marie (Zulma, 2008) et Le Créateur (Autrement, 2014).
* Guðrún Eva Mínervudóttir, Album (Albúm : skáldsaga, 2002), trad. Catherine Eyjólfsson, Tusitala, 2015
Heimska/La Stupidité
« À la fois nouveaux Vikings et mendiants » : voici comment apparaissent Áki et Lenita Talbot, les principaux personnages, l’un et l’autre romancier et aujourd’hui en voie de divorce, du livre de Eiríkur Örn Norðdahl, Heimska/La Stupidité. Poète et traducteur, né en 1978, Eiríkur Örn Norðdahl avait déjà publié Illska, Le Mal (2015). Il signe à présent une « dystopie nommée surVeillance » quasi-contemporaine et prenant l’Islande pour cadre. « Le monde est un réseau touffu de webcams, de caméras de surveillance, de drones et d’images-satellite, l’atmosphère est saturée de transparence et la vie privée a été sacrifiée à des fins de sécurité et de distraction. » Áki et Lenita viennent chacun de sortir un roman, intitulés tous deux Ahmed. Qui se serait inspiré de l’autre ? Plagiat ? Pour se venger, non pas tant de ce quiproquo littéraire que de l’échec de leur couple, ils copulent avec divers partenaires devant les caméras qui fourmillent dans le pays et s’envoient « poke » sur « poke » pour informer l’ex. Car il n’y a plus grand-chose à cacher dans ce monde où les pannes d’électricité sont les seuls moments de répit dans la surVeillance constante qui rassure tout un chacun. Mais des terroristes ont peut-être l’intention de perturber cet ordre décérébrant et la police veille, omniprésente. Roman écrit quelque peu à la façon feuilletonnesque d’autrefois, avec des personnages grandguignolesques et des événements qui se succèdent sans grand souci de logique, Heimska/La Stupidité surprend d’abord, sans vraiment convaincre ensuite.
* Eiríkur Örn Norðdahl, Heimska/La Stupidité (Heimska, 2015), trad. Éric Boury, Métailié, 2017